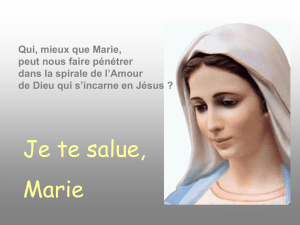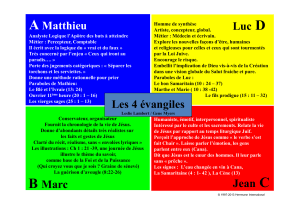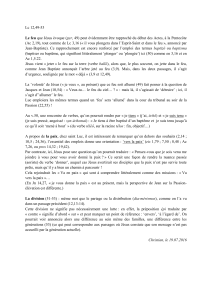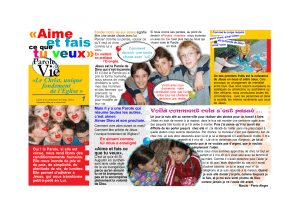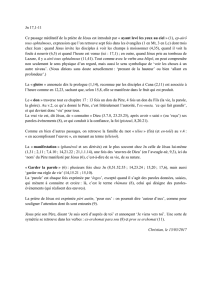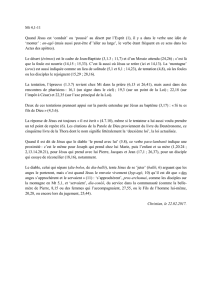Bibliothèque Moment Présent

Fioretti de textes partagés autour du module 1 : le moment présent 1
Bibliothèque Moment Présent
Gilles et Sophie nous partagent
Seigneur d’éternité,
Tu choisis le temps pour nous rencontrer.
Donne-nous de venir à Toi
sans mesurer notre temps,
Tu tiens dans ta main
tous les instants de l’univers,
Dis-nous comment tenir dans nos mains
le sable de nos vies.
Apprends-nous à tenir le passé
sans nous bercer de souvenirs idéalisés,
à rester fidèles sans crispation,
à conserver les signes de tes passages
sans les momifier en reliques.
Apprends-nous à tenir le présent
sans nous laisser absorber par lui,
à saisir les moments favorables
sans nous agripper à l’occasion perdue,
à discerner les signes de ta présence.
Apprends-nous à tenir l’avenir
sans redouter sa venue
ni l’enfermer dans le cortège des illusions.
Aide-nous à vouloir sans forcer le destin,
à nous disposer à l’appel de l’Esprit
sans nous brûler dans les attentes stériles.
Dissipe les nuages de l’inquiétude
qui tuent le soleil de la surprise.
Dieu du passé, du présent, de l’avenir,
aide-nous chaque jour à Te découvrir.

Fioretti de textes partagés autour du module 1 : le moment présent 2
Claude Bernard
Quatre saisons pour prier, éd. du Levain
Sur le chemin d’Incarnation
D’abord, nous avons à partir, à quitter, à nous mettre en marche, à nous arracher à l’habituel,
à prendre ce chemin sans savoir où il nous mène, sinon au pays où Jésus pourra naître.
L’avenir ne nous est pas connu. Nous ne savons guère les obstacles que nous rencontrerons,
la longueur de la route, le temps que nous mettrons, mais nous cherchons le lieu que le Père a
choisi pour que Jésus puisse être vivant parmi ses frères. Il faudra peut-être laisser ce qu’on a
toujours fait, ce qu’on comptait continuer à faire, ce que les autres attendaient de nous, pour
porter la Parole un peu plus loin. C’est là geste d’incarnation. Nous savons que quelqu’un a
déjà fait le voyage avant nous.
Cette décision de partir, Il faudra la reprendre sans cesse, car très vite, on se retrouve assis sur
le bord du chemin... ou au maximum avec quelques béquilles de secours, rampant
découragés.
Mais, sur ce chemin, il nous est demandé de VIVRE intensément ce moment présent qui est
le seul moment favorable. Depuis l’Incarnation, l’instant revêt un prix inestimable, on peut
patiemment y mettre de l’amour et y échapper à l’angoisse. Si nous fixons dans le présent
toutes nos forces vives, nous y trouvons Dieu, et une lumière, un dynamisme Inconnus
jaillissent de notre nuit. Accueillir ce qui vient (ou Celui qui vient) dans le quotidien actuel,
c’est là geste d’incarnation. Renoncer aux idées trop arrêtées sur ce que doit être l’avenir,
accueillir l’imprévu, déconcertant de nouveauté. Accepter de ne pas contrôler, ni dominer
l’inconnu de demain, de ne plus pouvoir prendre de mesures, autant pour moi que pour les
autres, de ne plus savoir où j’en suis, sans appui et pourtant appuyée.
Là me semble pouvoir seulement se situer l’adoration : appauvries de tout l’imaginaire,
libérées de dissertations hypothétiques sur le futur, accordées avec le plus profond de nous-
mêmes, nous pouvons nous laisser absorber par l’Unique nécessaire. En voyageant, nous
adorons. Sœur Hélène Marie - Supérieure générale
Chapitre de Noël 1976
Peur du futur?
Comment ne pas être pris dans l'angoisse par rapport à l'avenir? Nous trouvons des forces dans et
pour le présent mais nous ne recevons jamais la force à l'avance pour l'avenir.
Dieu est dans le JE SUIS.
Jean Vanier, Lettre à des amis, éd. Le livre ouvert, p.88

Fioretti de textes partagés autour du module 1 : le moment présent 3
L’ENJEU SPIRITUEL DU MOMENT PRESENT
Conférence du père Henri LAUX sj
Recollection de l’association Socrate Saint Paul du 26/11/2016 – Paris
« Nous ne nous tenons jamais au temps présent », écrivait Pascal il y a déjà plus de trois
siècles. Préoccupés que nous sommes par ce qui a été ou sera peut-être, nous finissons par être
absents du temps qui est le nôtre. Mais alors, où sommes-nous en réalité ? Quelle est cette vie à ce
point inquiète d'elle-même qu'elle s'épuise entre tant de moments qui lui échappent ? N'y a-t-il pas
à revenir à son présent ? A retrouver toujours ce point unique d'où procède le renouvellement de
toutes choses ?
LE TEMPS DE LA VIE
Qu'il ne soit pas facile de vivre au présent est une expérience bien commune, en effet. On
s'attache au passé et à l'avenir quand le présent est trop inconfortable. Avec nostalgie, on tend à
retrouver les moments les plus heureux de la vie : on se complaît dans les souvenirs d'un paradis
perdu que l'on rumine indéfiniment. Ou bien on se projette dans un futur idéalisé dont on attend
une situation meilleure. On rêve, on est ailleurs. Les images finissent par se substituer à la réalité. On
s'y attache, et l'attachement prend le sens d'un asservissement. Le présent est comme arrêté,
paralysé : il disparaît. Mais s'il disparaît, que reste-t-il de la vie ?
A l'inverse, on s'attache au moment présent selon des rythmes toujours plus rapides : il n'y a plus
ni passé ni avenir. Restent l'urgence, la course entre tout ce qui se présente, à saisir avant qu'il ne
soit trop tard. Le temps est court. Parce qu'il s'échappe, il importe de ne pas le perdre, ce qui
conduit à sur-occuper chaque instant. On ne respire plus ; on meurt de trop « vivre ». Mais on sent
bien que vivre, ce n'est pas cela. Les tensions psychiques et physiques, les obsessions, les effets de
désintégration sociale, les rythmes incontrôlés du monde professionnel, les fatigues les plus
diverses, tout cela contribue à donner au présent ces caractéristiques où le sujet échappe à la réalité
de son histoire.
Ce temps perdu dans des images ou des précipitations de toute sorte est un temps indéfini ou
sans limites, dispersé, sans véritable poids. Il nous devient extérieur. « Nous errons dans les temps
qui ne sont pas nôtres », disait encore Pascal. Mais que croyons-nous faire dans cet ailleurs ?
Qu'espérer d'un temps qui, n'étant pas nôtre, ne nous donne pas d'être nous-mêmes ? Nous y
sommes étrangers à nos propres aspirations ; notre volonté n'a prise sur rien qui tienne. Par là, c'est
le lieu concret de la vie qui nous échappe. Or comment vivre sans donner un lieu réel à la vie ?
Rêves et précipitations brouillent les pistes et ne permettent plus de lire ce qui arrive et d'écrire
ce que l'on veut au plus profond de soi. II y a quelque chose d'insensé à ne pas se tenir au temps
présent comme à vouloir fréquenter des terres inhabitables, déserts où rien ne vit sinon telle ou
telle forme d'animalité.
Comme le désert abrite les mirages, les mirages d'une existence dévoilent son désert à
l'existence. S'y résoudre est folie. Mais le non- sens a ceci de pervers qu'il cache ses manières
d'acquiescer, à la fois non voulues et toujours recherchées, dans une sorte de paradoxe qui dit le
conflit profond de l'existence.
A la différence de ces moments où la vie se brouille, le moment présent est un moment précis,
posé entre des limites, comme une demeure a ses limites. Se tenir au présent, c'est se tenir chez soi.
« Le monde est plein de gens qui veulent Dieu d'une volonté vague et générale », écrivait Surin, ce

Fioretti de textes partagés autour du module 1 : le moment présent 4
mystique du XVIIe siècle1. Comment ne pas ajouter : beaucoup veulent vivre, mais d'une volonté
vague et générale, c'est-à-dire sans se tenir au point précis où il y a à vivre et de quoi vivre ? Or un
vouloir précis est celui qui sort de ses errements pour s'appliquer à ce qui fait l'ordinaire de ses jours
et lui donner une orientation réfléchie. Il ne s'agit pas de faire disparaître le passé ou de se refuser à
l'avenir. Bien au contraire : la mémoire et l'attente doivent animer le présent. C'est dans cet ici et
maintenant, sans insouciance ni maîtrise, que nous rencontrons nos forces et nos faiblesses, le lieu
le plus précis de nos tentations et de nos appels. Chaque instant doit devenir un événement, un
moment plein de ce qu'il récapitule et inaugure tout à la fois.
Mais alors, vivre le moment présent, c'est vivre, tout simplement. Ici, il faut entendre deux
choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'autre moment à vivre que le moment présent. Toutes les
voies plus ou moins détournées et conscientes par où l'on se cache le présent retardent la vie —
jusqu'à mener à la mort. Vivre n'est pas autre chose que se décider pour le temps donné, celui qui
prend sens parce qu'il est la rencontre de la volonté avec elle-même, dans l'imprévisible de ses jours,
jour après jour.
Mais on entendra aussi dans le « tout simplement » qu'il y a à vivre le présent avec la plus grande
simplicité. Le goût d'une vie simple pourrait être le signe le plus authentique du désir de vivre dans
le présent. Sans viser la recherche archaïque d'une « vie naturelle » prétendument paradisiaque ou
quelque ascétisme hostile à la technique et au monde moderne, on verra dans la vie simple une vie
désencombrée de beaucoup de choses inutiles, et d'abord de cette course indéfinie après tous les
biens disponibles — dont on ne précise jamais celui qui importe —, une vie sans précipitation, qui
prend son temps, respecte le rythme des saisons. Une vie simple retrouve la saveur des choses
élémentaires ; dans les complexités rencontrées, affectives, sociales ou professionnelles, elle veut
s'en tenir à ce qui construit durablement.
Dès lors, le présent devient le temps où, toutes choses se simplifiant, la vie tend à son unité. Il est
véritablement temps de la vie. II se vit comme une attention.
LE MOMENT DE L'ATTENTION
Etre attentif ou inattentif : l'alternative paraît souvent secondaire, tant on s'habitue à ce que les
fautes d'inattention relèvent de la distraction plus que d'une attitude foncièrement voulue et
répréhensible en tant que telle. On se souvient des fautes de l'enfance, à demi excusées quand elles
relevaient de l'inattention, sortes d'étourderie sans gravité. Puis, avec les années, on a fait
l'expérience que l'inattention, apparemment vénielle, pouvait avoir aussi les plus douloureuses
conséquences. Dans l'ordre des relations humaines, combien de liens (parfois très chers) n'ont-ils
pas été défaits par de banales inattentions, toujours graves, puis décisives à force d'être répétées ?
Etre attentif, alors, c'est s'arrêter, arrêter en soi beaucoup de choses (à chacun de les nommer) pour
se tourner vers ce qui arrive ; c'est par la décision de se tendre tout entier vers autrui, et vers soi-
même, et vers plus grand que soi, que toutes les voix auront chance de ne pas se perdre.
Si l'attention est si centrale, c'est qu'elle appelle la décision de rompre avec le tumulte. Comment
une existence tumultueuse entendrait-elle ce qui appelle, du plus proche au plus lointain ? Les
rythmes effrénés s'interdisent l'attention ; les obsessions du corps et de l'esprit aussi. Quand la vie
se passe à entretenir des complexités sans nombre, à se précipiter dans des impasses, à séjourner
dans des images vaines, comment pourrait-elle écouter ? Que serait-elle capable de construire ? Et
pourtant, c'est bien là qu'il y a urgence à écouter. Quand la vie se défait ou, plus couramment peut-
être, peine à fructifier, il y a à retrouver en soi du silence pour être attentif à la réalité de ce qui est
donné. Le silence, le repos ou la gratuité, la distance avec soi-même, tous ces termes veulent dire le
chemin par où l'homme doit apprendre à vivre dans la paix pour se tenir sur le terrain du réel.
1 Lettre 214, Correspondance, Desdée de Brouwer,1966, p 727

Fioretti de textes partagés autour du module 1 : le moment présent 5
L'attention consiste à rencontrer les événements. L'évangile de Luc raconte qu'après l'épisode où
Jésus enfant était resté au temple parmi les docteurs de la loi, Marie « gardait tous ces événements
dans son cœur » (2,51). Recueillir ce qui se produit, le méditer dans son cœur et son intelligence,
c'est en effet prêter véritablement attention à ce qui se passe. Trop de faits « passent », justement,
suivis par d'autres qui les chassent, dans une insignifiance perpétuelle, et l'on « passe » à côté d'eux :
on ne les rencontre pas. Ainsi, Jésus ne se faisait pas faute de reprocher aux disciples leur
inintelligence : voici qu'il avait multiplié les pains pour la foule, et ils en étaient encore à se soucier de
leur nourriture (Mc 8,14-21). Et de beaucoup d'autres faits — peut-être de presque tous —, il en
était de même. Ils ne comprenaient pas, ne voyaient pas, n'entendaient pas. Leur vie n'était pas
attentive. Elle était en avance ou en retard, hors d'elle-même, hors du présent.
Mais pour avoir sens, ce qui arrive doit être vu et entendu. C'est cela, la rencontre. Il faut le
temps du recueillement, le temps du cœur et de l'esprit, pour que les faits laissent se déposer ce
qu'ils portent. Alors, ils deviennent des événements, contemporains du sujet qui les accueille.
Habiter le présent appelle à ne pas laisser perdre ce qui survient. Que recueillir par conséquent ?
Tous les événements personnels qui nous concernent, bien sûr : les décisions prises ou évitées, les
refus et les ouvertures, les expériences de joie et de tristesse. Mais aussi les forces qui travaillent
l'histoire dans laquelle nous sommes, les grands et petits événements par où l'humanité s'affirme et
se nie, car c'est de tout cela que notre présent se constitue. Nous ne serions pas attentifs à ce qui
nous arrive si nous n'intégrions pas le monde qui nous traverse. Méditer les événements dans une
veille incessante, cela revient à les interroger : sont-ils « insulte à la gloire de Dieu », « amour du
néant, course au mensonge », selon l'écho du psalmiste (Ps 4), ou rencontre de la justice et de
l'amour ? Le temps porte des enjeux de vie et de mort. Il s'agit de lui prêter attention pour vivre le
moment présent.
C'est donc l'attention à ce qui arrive aujourd'hui et maintenant qui fait du présent le point précis
de notre inscription dans l'histoire. Le présent a une densité. Il n'est pas abstrait. Il n'a de réalité que
par l'accueil d'un passé et d'un avenir.
ACCUEILLIR PASSE ET AVENIR
Il y a en effet à se tourner vers le passé, dans son ambivalence même. D'un côté, le passé est le
temps de la fondation, temps de la naissance, individuelle ou collective, avec tout ce qui a pu être
donné comme bienfaits. Un peuple se souvient de sa sortie d'Egypte, d'une marche fidèlement
accompagnée dans le désert, d'une terre accordée, d'un pardon toujours renouvelé ; un homme se
souvient de sa sortie de servitude, d'une existence restaurée, d'un amour à ses côtés. Or cela ne
saurait appartenir à un passé révolu. Le souvenir de ce qui a été donné constitue le présent :
rappeler le don, c'est continuer à en vivre et s'animer de la force qu'il contient. D'un autre côté, le
passé veut parfois être oublié : quand il a été douloureux, porteur d'échecs qui durent encore,
pourquoi et comment s'en souvenir ? Mais l'ignorer ne guérit pas la souffrance. C'est plutôt la
reconnaissance de ce qui a été qui peut être le chemin d'une libération et même d'une paix retrou-
vée. Alors, le passé mauvais, reconnu comme n'étant pas le dernier mot de notre histoire, aura
capacité à être le point d'où tout peut recommencer.
Et puis, il y a à porter attention à l'avenir : consentir à l'avenir d'où naîtra le présent. On connaît
de multiples manières de se tourner vers le lendemain. Beaucoup désertent le présent : elles
entretiennent le rêve. Quand le présent est inconfortable, il fait bon se reposer dans l'espoir de jours
meilleurs. Mais il y a toujours de bonnes raisons de ne pas se contenter du moment où l'on est ou du
pays que l'on habite : l’ailleurs est désirable. Pourtant, quand il n'est pensé qu'à la mesure des
choses connues, comme un superlatif de ce que l'on possède déjà, cet ailleurs ne va jamais bien loin
: il déplace indéfiniment les piquets de la tente, mais la terre reste la même. L'épuisement est assu-
ré. Consentir à l'avenir, au contraire, c'est croire en une infinie promesse de vie, attendre avec
assurance une nouveauté sans limite, à travers les bouleversements de l'existence et en refusant de
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%