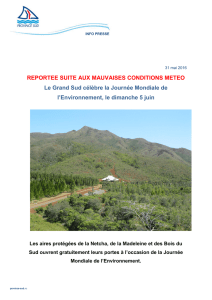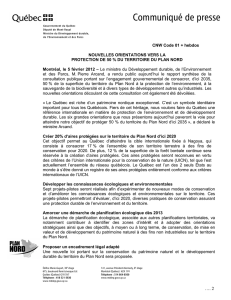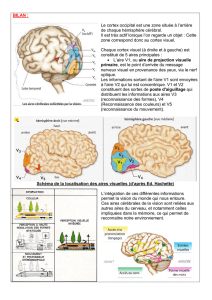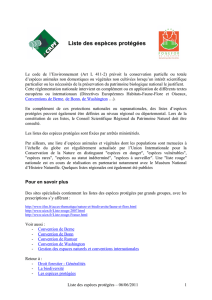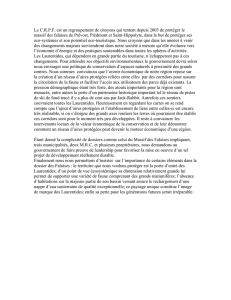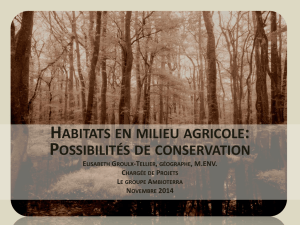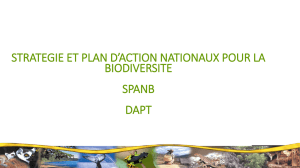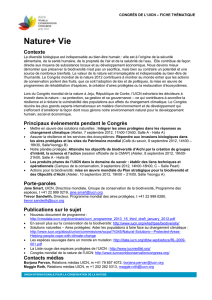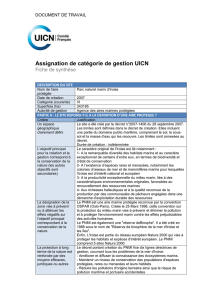Rapport final (word) : version du 05/05/2015

Application des catégories de gestion
UICN en France

2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 3
CONTEXTE DE L’ETUDE ....................................................................................................................... 4
Objectifs ................................................................................................................................................. 4
Objectifs internationaux ....................................................................................................................... 4
Objectifs en France ............................................................................................................................. 4
Statuts de protection français .............................................................................................................. 5
Vers un système d’aires protégées français plus lisible ...................................................................... 5
Chiffres clés et cartographie ................................................................................................................ 6
Description des statuts testés dans le cadre de cette étude (objectifs, modalités de gestion et
gouvernance) ....................................................................................................................................... 9
METHODOLOGIE ................................................................................................................................. 13
Présentation des catégories UICN et méthodologie d’assignation ............................................... 13
Définition des catégories de gestion ................................................................................................. 13
Définition des types de gouvernance ................................................................................................ 14
Méthodologie d’assignation appliquée en France ............................................................................. 15
Territoires pilotes ................................................................................................................................ 18
Procédure de validation ...................................................................................................................... 19
RESULTATS ......................................................................................................................................... 20
Présentation des résultats de l’échantillon pour l’utilisation des catégories UICN en France ... 20
Ile-de-France ..................................................................................................................................... 20
Atlantique ........................................................................................................................................... 23
Méditerranée...................................................................................................................................... 24
Synthèse des résultats ....................................................................................................................... 31
DISCUSSION ET CONCLUSION ......................................................................................................... 32
Eléments d’orientation sur la gouvernance pour chaque statut étudié ........................................ 32
Eléments d’orientation sur l’assignation des catégories de gestion UICN pour chaque statut
étudié .................................................................................................................................................... 34
Bilan de l’application des catégories de gestion UICN en France ................................................. 47
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE ................................................................................................ 50
Bibliographie ........................................................................................................................................ 50
Webographie ........................................................................................................................................ 50

3
Introduction
Les aires protégées sont un élément essentiel des stratégies de conservation de la biodiversité, de la
géodiversité et des paysages. Mises en place pour préserver un patrimoine naturel remarquable, elles
contribuent aussi à la bonne qualité écologique des milieux et des territoires qui les entourent, et
participent au maintien des biens et des services que les écosystèmes assurent aux populations.
Néanmoins, depuis la création de la première aire protégée dans le monde, de nombreux outils de
protection des espaces naturels ont été développés, correspondant à différents modes de gestion et
systèmes de gouvernance.
Compte tenu de cette diversité, de l’absence d’harmonisation et d’équivalence entre les classifications
nationales, l’UICN a passé les deux dernières décennies à examiner, et dans une certaine mesure, à
repenser la question de ce que définit une « aire protégée », comment et quelles aires protégées
contribuent à la société humaine. En réponse à ces interrogations, l’UICN a commencé à développer
en 1975 un système de catégories en fonction des objectifs de gestion, qui fut finalement publié comme
un ensemble de six catégories en 1994. La dernière édition des lignes directrices pour les catégories
d’aires protégées a été publiée en 2008 à l’occasion du Congrès mondial de la Nature de cette même
année.
L’existence de ces lignes directrices est une méthodologie qui répond à la complexité du système
français qui mobilise une grande diversité d’outils de protection. Selon le contexte, la protection se
traduit par des mesures d’acquisition foncière, des mesures réglementaires, ou encore des mesures
contractuelles entre les acteurs des territoires. Selon les instruments, la création d’une aire protégée
relève de l’Etat ou d’une collectivité territoriale (Régions, Départements), alors que la gestion peut
relever d’une très grande variété d’acteurs, y compris des organisations non gouvernementales.
A la demande du Ministère en charge de l’Ecologie, la présente étude vise à contribuer au
développement d’une procédure nationale d’assignation des catégories de gestion. Trois régions
métropolitaines (l’Ile-de-France, les façades atlantiques et méditerranéennes) ont fait l’objet de
l’échantillonnage recouvrant un large panel des statuts d’aires protégées français.

4
Contexte de l’étude
Objectifs
Objectifs internationaux
Depuis la création du Parc national de Yellowstone en 1872, plus de 200 000 aires protégées ont été
établies à travers le monde, dans des contextes politiques et écologiques très diversifiés. Ce
développement s’est traduit par la multiplication des dénominations et des statuts de protection,
rendant nécessaire la recherche d’une nomenclature commune à l’échelle internationale.
L’UICN a contribué à cet effort de standardisation en développant un système de classification des aires
protégées reconnu par les Nations-Unies
1
. Il est utilisé par plusieurs Gouvernements pour planifier leurs
systèmes d’aires protégées et incorporé dans de nombreuses législations nationales. Cette
classification sert également d’autres objectifs, parmi lesquels :
- Alerter les Gouvernements sur l’importance des aires protégées,
- Faciliter les analyses comparatives des systèmes de protection,
- Identifier de manière précise les objectifs de gestion des aires protégées,
- Instaurer un cadre standard pour la collecte et la diffusion de données sur les aires protégées,
- Encourager les Gouvernements à développer un éventail d’objectifs de gestion adaptés aux conditions
nationales et locales,
- Améliorer la communication et la compréhension mutuelle entre les acteurs impliqués dans la
conservation.
Depuis 2008, l’UICN a validé une nouvelle définition d’aires protégées, plus inclusive que la précédente:
Une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les
services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »
2
.
Les principes de l’assignation qui découlent de cette définition sont les suivants :
- l’assignation doit être réalisée sur la base d’un dialogue avec le gestionnaire
- elle s‘applique au site et non au statut : un statut peut être décliné différemment selon le
contexte local (modalités, …)
- elle est déterminée par l’objectif de conservation
- les modalités de gestion doivent être compatibles avec l’objectif de gestion
- certaines activités non prévues doivent s’appliquer sur 25% maximum de la surface de l’aire
protégée
La catégorie est définie uniquement en fonction de l’objectif de gestion principal qui doit-être respecté
sur au moins 75% de la superficie du territoire (la gestion des 25% doit-être compatible avec ce même
objectif).
Objectifs en France
Jusqu’à présent, l’assignation de catégories UICN repose essentiellement sur des dires d’experts ou
résulte d’études ponctuelles réalisées pour certains sites ou statuts. La France s’est engagée, dans le
cadre du programme aires protégées de la CDB, à renseigner pour chaque site une catégorie de
1
Cette nomenclature répond à l’appel de la 7ème conférence des Parties de la CDB pour un système de classification
internationale
2
Dudley, N. (Éditeur) (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées.
Gland, Suisse : UICN. x +96pp

5
gestion. Pour objectiver cette démarche, il est nécessaire de disposer d’une méthodologie à la fois
adaptée à l’échelle nationale et conforme aux lignes directrices de l’UICN.
Le projet vise à contribuer au développement d’une procédure nationale d’assignation des
catégories de gestion voulue par le Ministère en charge de l’Ecologie.
Cette démarche est déclinée en quatre composantes :
- communication et capacitation des gestionnaires et de leurs réseaux représentatifs sur les
objectifs de l’assignation de catégories et ses modalités
- développement d’une méthodologie (définition des critères, arbre de décision, formulaire)
- organisation de la chaine de validation (gouvernance de l’initiative)
- systématisation de l’assignation à travers le développement d’un outil de saisie en ligne mis à
la disposition des gestionnaires (2015)
S’agissant d’une approche expérimentale, cette méthodologie a été testée sur un échantillon
représentatif de l’ensemble des statuts de protection français.
Statuts de protection français
Vers un système d’aires protégées français plus lisible
La France dispose d’un large éventail d’outils de protection des espaces naturels, correspondant à
différents modes de gestion et systèmes de gouvernance. Cette diversité offre la possibilité d’adapter
le choix d’outil en fonction des situations rencontrées et des objectifs de protection recherchés. Il existe
également de nombreuses articulations envisageables entre ces outils afin de renforcer l’efficacité de
la protection. A l’échelle nationale, on distingue trois modalités juridiques de protection d’espaces
naturels : l’approche foncière repose sur l’acquisition de terrains en pleine propriété en vue d’assurer la
protection définitive d’un espace naturel remarquable ; l’approche conventionnelle vise à déléguer à un
tiers pour une durée déterminée la gestion et la préservation d’un espace naturel dans le cadre d’une
convention de maîtrise d’usage ; et l’approche réglementaire consiste à limiter voire à interdire
généralement par arrêté ou par décret des activités humaines en fonction de leurs impacts sur les
milieux naturels. Au total, la France compte 14 statuts de protection auxquels s’ajoutent les outils
spécifiques développés par les collectivités d’outre-mer et les outils de protection relevant de textes
internationaux ou européens.
La dixième Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (Nagoya, octobre
2010) a mis en lumière la nécessité d’améliorer la lisibilité du dispositif français d’aires protégées à
l’échelle internationale et de rendre compte auprès des Nations-Unies de la mise en œuvre des
stratégies de création d’aires protégées terrestres et marines. En tant que norme internationale de
référence, la classification de l’UICN peut contribuer à ce double objectif.
Jusqu’à présent, le dispositif français d’espaces protégés ne faisait l’objet d’aucune analyse
systématique au regard du système de classification défini par l’UICN. L’expertise acquise à travers les
évaluations réalisées sur un échantillon représentatif d’aires protégées peut être appliquée à tout autre
outil de protection ou site protégé.
Si la méthodologie d’assignation a été clairement définie à l’échelle internationale à travers la publication
de lignes directrices, en revanche les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre peuvent varier
d’un pays à l’autre. En effet, il n’existe pas de procédure unique et dans la pratique, de nombreuses
organisations peuvent prendre l’initiative de l’assignation d’une catégorie, qu’il s’agisse d’autorités
nationales, régionales ou d’organisations non gouvernementales. Dans tous les cas, la décision finale
d’assignation d’une catégorie de gestion d’aires protégées appartient au Gouvernement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
1
/
51
100%