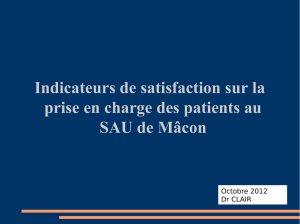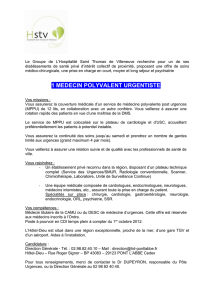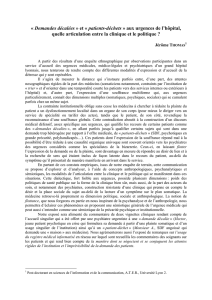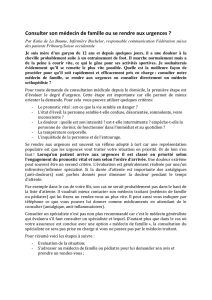Corrigé épreuve écrite 1 - Espace Educatif

1
Epreuve écrite
Points du programme en lien avec le sujet :
Classe
de 1ère
2. Comment apprécier l’état de
santé et de bien-être social ?
2.1. Mesure par des indicateurs diversifiés
3. Quels sont les principaux
déterminants de santé et de
bien-être social ?
3.1. Un état d’équilibre avec des inégalités
5. Quel cadre d’élaboration des
politiques ?
5. Politiques nationales et politiques territoriales :
niveau d’élaboration (central, déconcentré,
décentralisé)
6. Quelles politiques de santé
publique pour promouvoir ou
restaurer la santé ?
6.3. Principes d’organisation
Acteurs : diversité et rôle (décideurs, opérateurs
financeurs)
Classe
de Tale
10. Quels dispositifs en santé
publique ?
10.1. Problèmes de santé en France : les priorités
actuelles
Prise en compte globale des besoins d’une
population : de la réduction des inégalités au
développement de l’accès aux soins
10.2. Organisation et régulation du système de
soins entre la demande et l’offre de soins :
composantes du système de soins, établissements
de santé, réseaux de santé et services
extrahospitaliers, professions de santé
10.3. Choix et enjeux : cohérence, coordination et
évaluation des dispositifs et des actions
11. Quels dispositifs de
protection sociale ?
11.2. Régulation financière : action sur l’offre et la
demande (une recherche d’équilibre)
11.3. Assurance maladie du régime général de la
Sécurité sociale : organisation administrative et
financière (niveaux de pilotage)
Répartition des points :
Critères d’évaluation
Question 1
Question
2
TOTAL
1.1
1.2
1.3
Exploitation pertinente des documents
2
1
0,5
1
4,5
Maîtrise des connaissances
1
1,5
2
3
7,5
Capacité à identifier les différents aspects du
questionnement, à analyser, argumenter, synthétiser
2
1,5
1,5
1
6
Qualités rédactionnelles
2
2
TOTAL
14
6
18

2
Eléments de corrigé :
Les éléments de corrigé passent en revue la plupart des réponses qui peuvent être apportées aux
questions mais l’exhaustivité n’est attendue pour aucune d’entre elles.
1.1. Analyser le recours aux urgences hospitalières et préciser les raisons pour lesquelles il
n’apparaît pas toujours pertinent.
Caractéristiques du recours aux urgences hospitalières :
Taux de recours très important pour les enfants de moins d’un an puis pour les plus de 70 ans
Très fable recours pour les 51-70 ans
Pic intermédiaire pour les 16-25 ans
A tous les âges, les hommes ont plus recours aux urgences que les femmes
Recours aux urgences essentiellement dans la journée : augmentation rapide dès 7 h du
matin, maximum entre 10 et 11 h, baisse pendant la pause repas, légère reprise ensuite et
baisse à partir de 17 h
sauf pour les enfants de 0 à 1 an pour lesquels la baisse se situe entre 14 et 16 h (pendant la
sieste) et reprend en forte augmentation avec un pic à 21 h.
Les plus de 70 ans consultent davantage en fin de matinée et en début d’après-midi.
Le pourcentage de personnes hospitalisées après un passage aux urgences est relativement
faible (inférieur à 20 % en moyenne) mais il augmente sérieusement après 50 ans.
Les ouvriers et les employés sont surreprésentés parmi les usagers des urgences.
Raisons qui incitent la population à se rendre aux urgences :
Avis médical ou personnes à qui on n’a pas demandé leur avis
Echec des solutions précédentes (traitement en cours, récidive, autre service de l’hôpital qui
ne pouvait les prendre rapidement,…)
Alternative à la médecine de ville : pas de médecin traitant ou médecin absent
Lieu rassurant qui dispose de tous les spécialistes et du plateau technique permettant de faire
face à toutes les situations
Lieu ouvert 24 h sur 24 (même si la majorité des recours aux urgences ont lieu à des heures
d’activité normale des médecins généralistes).
Accueil sans discrimination
Pas d’avance des frais : ce qui peut sans doute expliquer la surreprésentation des classes
modestes parmi les usagers des urgences ainsi que celle des 16 à 25 (beaucoup d’étudiants
ou de petits boulots : peu de moyens financiers, et souvent pas de mutuelle)
Convenances personnelles ou raisons pratiques (proximité de l’hôpital)
Nature des recours aux urgences parfois injustifiés :
Presque 20 % de la population des moins de 50 ans ont recours aux urgences pour des états
qui ne sont pas susceptibles de s’aggraver et sans avoir besoin d’un acte diagnostique ou
thérapeutique c'est-à-dire des personnes qui ne présentaient pas de réel problème de santé
et de toute façon, pas de problème de santé urgent et/ou nécessitant le matériel et le
personnel performant de l’hôpital.
Environ 70 % des patients qui se sont présentés aux urgences présentaient un état clinique
qui n’était pas susceptible de s’aggraver (alors que « l’urgence est une organisation destinée
à prendre en charge tout événement médical nécessitant une intervention rapide ») mais qui

3
a donné lieu à un acte diagnostique ou thérapeutique qui aurait sans doute pu être effectué
par un médecin hospitalier dans un certain nombre de cas.
Une grande majorité des patients, à l’exception des plus de 70 ans, a pris la décision de s’y
rendre de sa propre initiative (ou de celle de son entourage) : le passage par un médecin (23
%) aurait permis d’éviter un recours inutile aux urgences.
Les recours justifiés aux urgences de patients dont l’état risque de s’aggraver aux urgences
(CCMU 3 à 5), représentent moins de 10 % des cas pour les moins de 50 ans, progressent
jusqu’à 35 % environ entre 50 et 80 ans et se stabilisent ensuite à ce taux au-delà.
Le recours aux urgences par des personnes dont le pronostic vital est en jeu est extrêmement
faible progressant lentement de 50 à 80 ans pour passer de 1 ou 2 % à 10 % environ.
Les recours pour convenances personnelles ou pour des raisons pratiques sans lien avec la
gravité ou l’urgence de la situation
Raisons pour lesquelles le recours aux urgences est parfois pertinent :
Une mauvaise information sur le rôle respectif du médecin généraliste et du médecin des
urgences
Une mauvaise évaluation de leur problème de santé
Un accès au médecin de proximité difficile (éloignement, horaires, manque d’information, de
numéro de téléphone, médecin absent,…)
Le tiers payant pratiqué à l’hôpital
1.2. Expliquer en quoi la régulation et le désengorgement des urgences hospitalières sont
devenus un enjeu important pour l’offre de soins hospitalière et ambulatoire.
La régulation permettrait d’orienter les patients vers les professionnels de santé dont ils ont
réellement besoin et éviterait qu’ils s’orientent toujours vers les urgences et permettrait ainsi de
les soulager.
Hôpital = pivot du système de soins, lieu de haute technicité avec des compétences
particulières
Difficultés financières pour l’hôpital qui représente quasiment la moitié des dépenses de santé
Recours inapproprié aux urgences personnels débordés, délais d’attente inadmissibles
pour les patients en partie en raison de soins qui ne relèvent pas de leur compétence
met en danger l’équilibre financier de l’hôpital, détourne les personnels des patients qui en ont
réellement besoin compromet les capacités de l’hôpital à remplir ses missions la régulation
et le désengorgement des urgences hospitalières sont devenus un enjeu important pour le
système de santé
Cela devient un véritable enjeu de société parce qu’un système de santé déficitaire risque de
remettre en cause la solidarité, l’accès pour tous au système de soins et risque donc de
provoquer une médecine à deux vitesses qui exclut certaines personnes du système.
Une meilleure organisation de la permanence des soins qui allie les compétences et le
fonctionnement de la médecine de ville et la médecine hospitalière, entraine obligatoirement une
modification des principes de la médecine libérale en France axée sur le principe de liberté pour
le patient et pour le médecin. C’est donc bien un enjeu de société, si on ne réforme pas, si on
n’informe pas les patients, le système de soins tel qu’on le connaît ne pourra plus fonctionner.
D’où la nécessité de penser la médecine de ville autrement pour mieux répondre aux besoins des
usagers : les nouvelles formes ….

4
1.3. Regrouper les acteurs de la permanence des soins en fonction des institutions ou des
professionnels qu’ils représentent et justifier leur présence dans ce dispositif.
Acteurs de la permanence des soins
Raisons de leur présence dans le dispositif
Représentants de l’Etat :
Préfet du département
DDASS
ARH
Etat garant du droit à la santé pour tous, partout en
France,
Responsable de la répartition géographique de l’offre
de santé
Responsable de la santé publique
Détient le pouvoir de décision (droit de réquisitionner
notamment)
Représentants des collectivités
territoriales :
Communes, départements,
régions
Chargés de défendre les intérêts de leurs administrés
Peuvent proposer des moyens (financiers ou
logistiques) pour améliorer l’accès aux soins sur leur
territoire
Représentants des
médecins libéraux :
Médecins du secteur
Médecins d’associations de
permanence des soins
Conseil départemental de
l’ordre des médecins
Principaux acteurs de la permanence des soins
Nécessité de s’organiser à la fois pour satisfaire les
besoins de la population et pour améliorer aussi leurs
conditions de travail
Nécessité de répartir les tâches entre permanence des
soins et services d’urgence
Représentants de l’assurance
maladie :
URCAM
Médecins conseil des caisses
d’assurance maladie
Caisse des régimes obligatoires
d’assurance maladie
ARH
L’assurance maladie
Finance les soins dispensés dans le cadre de la
permanence des soins
Veille à la maîtrise des dépenses de santé
Aide financièrement les initiatives qui ont pour objectif
de désengorger les urgences
Représentants des services
d’urgence :
Services départementaux
d’incendie et de secours
Médecin responsable de SAMU
Directeurs d’hôpitaux
(établissements de santé
publics et privés)
Sapeurs-pompiers
ARH
Chargés de réguler (trier) l’accès aux urgences
Nécessité de répartir les tâches entre permanence des
soins et urgences
Enjeux financiers (les urgences coûtent plus cher
qu’une consultation médicale de ville)
Conclure sur l’intérêt de leur partenariat.
Intérêt de ce partenariat :
La concertation de tous les acteurs de la permanence des soins (à l’exception toutefois des
usagers) doit permettre :
une meilleure définition du rôle de chacun et une meilleure répartition du travail,
de prendre en compte tous les aspects (humains, financiers, logistiques,…) de la permanence
des soins
de mieux répondre aux besoins de la population

5
de désengorger les urgences
d’éviter les déserts médicaux
de repenser le fonctionnement de la médecine libérale et hospitalière,
de mettre en place des structures, de nouvelles offres de soins qui accueillent comme à
l’hôpital (tiers payant, à toute heure),
développer l’information et la formation du public vis-à-vis du fonctionnement du système de
santé…
de responsabiliser les différents acteurs, patients compris,…
2. Intérêt de ces nouvelles offres de soins pour :
La qualité de la prise
en charge des
patients
accès facilité aux soins de premier recours
facilitent le recours des malades à d’autres professionnels de
santé (travail en équipe ou dans les mêmes locaux)
la transmission des informations entre professionnels permet un
meilleur suivi des malades (système d’information)
la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire permet de
raccourcir le séjour à l’hôpital et de rentrer plus rapidement chez soi
un lieu unique ou un professionnel de référence facilite les
démarches ou les déplacements
la maîtrise des
dépenses de santé
la concertation des professionnels évite les actes redondants ou
contradictoires
se situent dans une démarche de prévention qui permet d’éviter la
maladie ou son aggravation et diminue donc les dépenses (moins de
soins lourds et d’hospitalisations)
le coût de la consultation est moindre par rapport à l’hôpital
la promotion de la
santé
la pluridisciplinarité favorise l’éducation à la santé
les échanges entre professionnels permettent de mieux savoir ce
qu’il faut faire pour améliorer la situation
permet d’envisager des actions de prévention individuelles ou
collectives avec un ou plusieurs professionnels (qui tiennent le même
discours).
1
/
5
100%