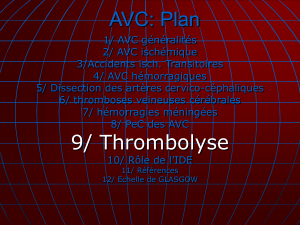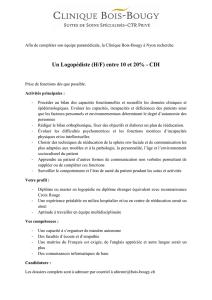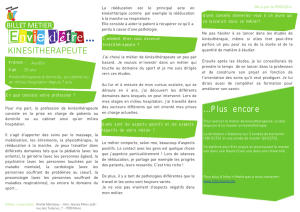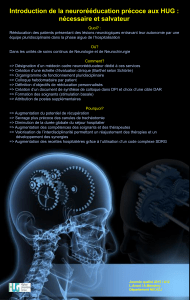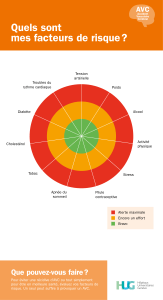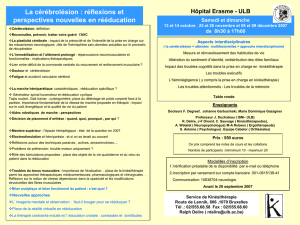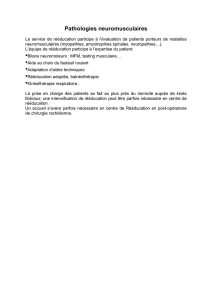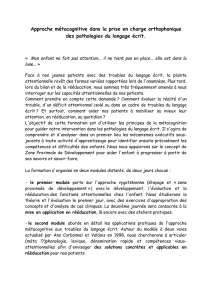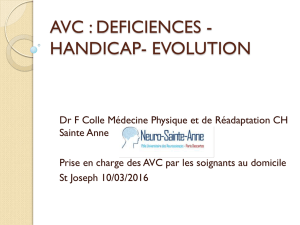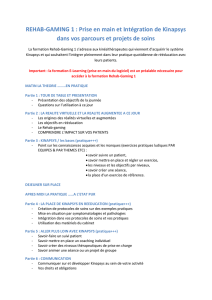SOUTENANCE A CRETEIL

1
SOUTENANCE A CRETEIL
UNIVERSITE PARIS VAL-DE-MARNE
FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL
******************
ANNEE 2010 N°
THESE
POUR LE DIPLOME D'ETAT
DE
DOCTEUR EN MEDECINE
Discipline : Médecine Générale
------------
Présenté(e) et soutenu(e) publiquement le :
à : CRETEIL (PARIS XII)
------------
Par TOSUN Jérôme
Né(e) le 26 Avril 1980 à IVRY SUR SEINE
-------------
TITRE : ETUDE DE L’AUTONOMIE DES PATIENTS HEMIPARETIQUES AU
STADE CHRONIQUE D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL EN
MEDECINE GENERALE.
DIRECTEUR DE THESE : LE CONSERVATEUR DE LA
Pr Jean-Michel GRACIES BIBLIOTHEQUE
Signature du Cachet de la bibliothèque
Directeur de thèse universitaire

2
REMERCIEMENTS
A mes parents Ani et Hosep TOSUN, à mes frères Armand et Stéphane. Merci pour votre
soutien et votre écoute, sans vous je ne serais pas là aujourd’hui.
A Laëtitia, pour son amour et sa patience.
Au Professeur GRACIES, qui grâce à ses qualités professionnelles et humaines, m’a permis
de réaliser cette thèse.

3
I- INTRODUCTION 5
II- GENERALITES 7
A- RAPPELS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET CLINIQUES
CONCERNANT LA REEDUCATION 7
B- INTERETS DE LA REEDUCATION DANS L’HEMIPARESIE
8
1- Revue générale de la littérature 8
2- Effet de l'intensité du traitement 10
3- Traitement à domicile 11
4- Date de début de la rééducation 11
5- Comparaison de différentes techniques 12
6- Prise en charge par la sécurité sociale en France 13
7- Prise en charge par le médecin généraliste 13
III- MATERIEL ET METHODES 15
A- RECUEIL DES DONNEES 15
1- Indice de Barthel 15
2- Fiche de consentement (Annexe 2) 16
B- CRITERES D’INCLUSION 17
C- CRITERES D’EXCLUSION 17
D- METHODES D’ANALYSE DES DONNEES 17
IV- RESULTATS 18
A- ETUDE DE LA POPULATION 18
B- RESULTATS : BARTHEL ET VITESSES DE MARCHE 21
C- ETUDE DES SEANCES DE KINESITHERAPIE 23
D- AVIS SUBJECTIFS CONCERNANT L’AMELIORATION DE
L’AUTONOMIE 24

4
V- DISCUSSION 24
A- EFFICACITE DE LA KINESITHERAPIE SUR
L’AUTONOMIE 24
B- INTERETS ET LIMITES DE L’ETUDE 26
VI- CONCLUSION 29
ANNEXE 1 30
ANNEXE 2 31
ANNEXE 3 32
BIBLIOGRAPHIE 34
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Caractéristiques de la population étudiée 18
Tableau 2 : Caractéristiques générales des accidents vasculaires cérébraux 20
Tableau 3 : Résultats de la vitesse de marche et de l’indice de Barthel 22

5
I- INTRODUCTION
Dans les pays occidentaux, l’accident vasculaire cérébral est la première
cause d’invalidité acquise, la deuxième cause de démence et la troisième cause de
décès. 78 % des patients vivant au domicile avant l’AVC y sont revenus six mois plus
tard avec, dans les faits, une prise en charge au quotidien de l’hémiparésie par le
médecin généraliste. Un traitement de kinésithérapie est souvent prescrit aux
patients plus de 6 mois après l’accident vasculaire cérébral, mais l’efficacité d’un tel
traitement est peu documentée.
La fréquence, la gravité, et le coût des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
en font un problème de santé publique considérable. Les estimations effectuées à
partir du registre de Dijon (Lemesle 1999 (23)) et des registres d’autres pays
développés (Hankey 1999 (10), Thorvaldsen 1995 (35) Asplund 1995 (3)) suggèrent
que chaque année en France, environ 120 000 personnes sont victimes d’un AVC,
dont schématiquement 30 000 vont mourir dans les jours ou mois qui suivent, 60 000
vont garder un handicap de sévérité variable et 30 000 vont récupérer sans
séquelles. Parmi les survivants, 50 % vont avoir une dépression dans l’année, 25 %
seront déments dans les 5 ans qui suivent et 40 % seulement des actifs reprendront
leur travail (Kapelle, 1994 (19), Sacco 1997 (29)).
La prise en charge chronique est souvent gérée par le médecin généraliste.
La plupart des patients voient leur travail de rééducation arrêté, ou converti en une
rééducation dite «d’entretien», lorsqu’il est estimé qu’ils «ne progressent plus».
Il n’est pas prouvé que cette prise en charge est en adéquation avec l’état
actuel des connaissances sur le potentiel de récupération motrice dans la parésie
spastique.
Compte tenu de leur fréquence et de la gravité de leurs séquelles, les AVC
sont parmi les affections les plus coûteuses. Le coût pour le système de soin est
estimé à environ 70 000 dollars US comme coût direct moyen pour les soins d’un
premier AVC jusqu’au décès dans les pays scandinaves (Asplund 1993 (2)), allant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%