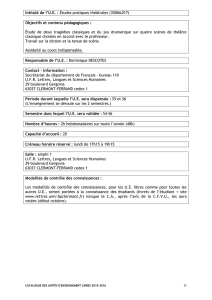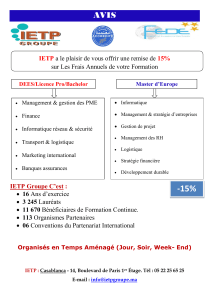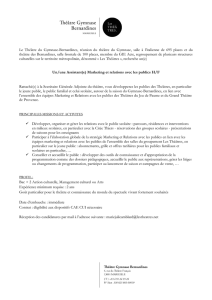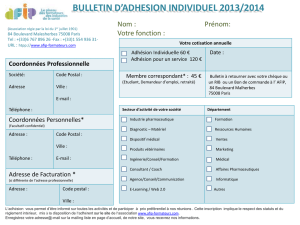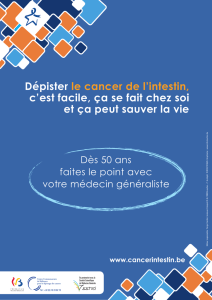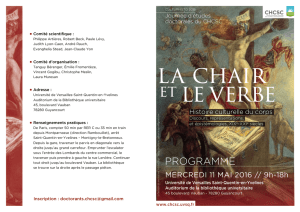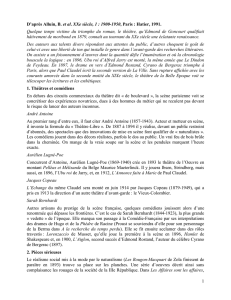Ambigu-Comique

M3-E-4°
Aboyeur
M3-E-4°
A. Pougin en donne cette description : « Dans les foires, à la porte des baraques de
saltimbanques, on trouve toujours, soit parmi ceux qui font la parade, soit en dehors
d’eux, un individu spécialement chargé de faire le boniment, et d’amorcer les spectateurs.
Il fait connaître la nature du spectacle, détaille aux badauds les merveilles qui vont être
offertes à leur administration, et, d’une voix à la fois puissante et enrouée, les incite à
franchir le seuil de ce paradis enchanté. C’est l’aboyeur, bien connu par la péroraison
devenue classique dans son discours : « Entrez, Messieurs et Mesdames, ça ne coûte que
dix centimes, deux sous ! et l’on ne paie qu’en sortant, si l’on est content ». Naguère
encore, ceci grâce à la réglementation tyrannique qui pesait sur nos théâtres, certains
d’entre eux, considérés seulement comme spectacles, étaient tenus, pour affirmer eux-
mêmes leur infériorité, d’avoir à leur porte un aboyeur qui les distinguait de leurs grands
confrères. C’est ainsi que, sur l’ancien boulevard du Temple, le théâtre de Madame Saqui,
les Funambules, le Lazary avaient chacun un aboyeur. » (Dictionnaire historique et
pittoresque du théâtre, 1885).
M2-1-10°
Acteur
M2-1-10°
La révolution romantique au théâtre impliquait une réforme du jeu des acteurs que les
comédiens anglais venus jouer Shakespeare à Paris, en 1822 et 1827, rendirent encore
plus urgente. Mais Talma, l’acteur a priori le plus favorable à leurs vues, meurt en 1826
et, pour avoir voulu investir d ’emblée la Comédie-Française, Hugo et ses amis doivent
composer avec les réticences d’une troupe qui partage les préventions de leur étoile, Mlle
Mars. Si Mlle George est mieux disposée à l’Odéon, elle est aussi en fin de carrière et ne
possède plus tous ses moyens. C’est donc au Boulevard que s’imposent les grands acteurs
romantiques. Leur jeu tend à exprimer avec plus de vérité les sentiments,
indépendamment de tout respect des bienséances et du « bon ton » ; en cela, il traduit la
sensibilité de toute une génération. A côté de Marie Dorval et de Frédérick Lemaître,
Pierre-François Bocage (1799 - 1862) s’élève au rang de modèle en créant le rôle-titre
d’Antony en 1831. Avec Gustave Mélingue (1807 – 1875), l’art du comédien est déjà
moins pur : ce dernier triomphe surtout dans les adaptations des romans de Dumas, mais
d’Artagnan a moins de force sur scène que dans le livre. Les créateurs immédiats du
drame romantique n’ont pas eu de successeurs à leur mesure.
M3-1b-6°
Acteur
M3-1b-6°
La révolution romantique au théâtre impliquait une réforme du jeu des acteurs que les
comédiens anglais venus jouer Shakespeare à Paris, en 1822 et 1827, rendirent encore
plus urgente. Mais Talma, l’acteur a priori le plus favorable à leurs vues, meurt en 1826
et, pour avoir voulu investir d ’emblée la Comédie-Française, Hugo et ses amis doivent
composer avec les réticences d’une troupe qui partage les préventions de leur étoile, Mlle
Mars. Si Mlle George est mieux disposée à l’Odéon, elle est aussi en fin de carrière et ne
possède plus tous ses moyens.
C’est donc au Boulevard que s’imposent les grands acteurs romantiques. Leur jeu tend à
exprimer avec plus de vérité les sentiments, indépendamment de tout respect des
bienséances et du « Bon ton » ; en cela, il traduit la sensibilité de toute une génération. A
côté de Marie Dorval et de Frédrick Lemaître, Pierre-François Bocage (1799 - 1862)
s’élève au rang de modèle en créant le rôle-titre d’Antony en 1831. Avec Gustave
Mélingue (1807 - 1875), l’art du comédien est déjà moins pur: ce dernier triomphe surtout
dans les adaptations des romans de Dumas, mais d’Artagnan a moins de force sur scène
que dans le livre. Les créateurs immédiats du drame romantique n’ont pas eu de
successeurs à leur mesure.
M3-4a-3°
Adam
(Adolphe)
M3-4a-3°
Compositeur né et mort à Paris (18O3 - 1856). Elève de Boieldieu pour l’harmonie et la
composition, il obtient en 1825 le second prix au concours de l’Institut, et atteint bientôt à
la notoriété en écrivant la musique, souvent fort importante, de nombreux vaudevilles
représentés au Gymnase, au Vaudeville et aux Nouveautés (Le Baiser au porteur, le Mal
du pays, le Dame jaune, Monsieur Botte, etc.). Il réussit enfin à forcer les portes de
l’Opéra-Comique, où il ne donnera pas moins de vingt-six ouvrages, dont plusieurs
obtiendront des succès prolongés.
M3-
5a-6°
Adam
(Adolphe)
M3-5a-6°
Compositeur né et mort à Paris (18O3 - 1856). Elève de Boieldieu pour l’harmonie
et la composition, il obtient en 1825 le second prix au concours de l’Institut, et
atteint bientôt à la notoriété en écrivant la musique, souvent fort importante, de
nombreux vaudevilles représentés au Gymnase, au Vaudeville et aux Nouveautés
(Le Baiser au porteur, le Mal du pays, le Dame jaune, Monsieur Botte, etc.) Il
réussit enfin à forcer les portes de l’Opéra Comique.
Il se fit aussi une réputation comme compositeur de ballets en donnant, à l’Opéra,
Giselle (1841), la Jolie Fille de Gand (184), le Diable à quatre (1845), la Filleule

des fées (1849), Orfa (1852), le Corsaire (1856). Adam eut la fâcheuse idée de
prendre en 1847 la direction de l’Opéra-National, devenu plus tard le Théâtre-
Lyrique, où il se ruina. Il donna à ce théâtre plusieurs ouvrages : la Poupée de
Nuremberg, Si j’étais roi, le Bijou perdu, le Muletier de Tolède, etc.
M3-3c-6°
Alternance
M3-3c-6°
L’alternance des spectacles est un principe rare au 18° siècle. L’état de la technologie,
puis l’insuffisance des emplois et des capitaux oblige à « pousser la pièce » jusqu’à ce
qu’elle fasse le plein de son public, quitte à la reprendre plus tard car on atteint très vite
une saturation relative, et il faut aussi compter avec la concurrence des autres spectacles
qui se renouvellent plus vite et moins laborieusement (théâtres forains, passages de
troupes ambulantes).
M1-11°
Ambigu
M1-11°
Ouvert le 9 juillet 1769, l’Ambigu-Comique sera incendié dans la nuit du 13 au 14 juillet
1827. Il quittera alors le numéro 62 du boulevard du Temple pour réouvrir le 7 juin 1828
dans une salle nouvelle située 2, boulevard Saint-Martin. Cette seconde salle contenait
1800 places. Elle échappera à la destruction de 1862, tout comme le théâtre de la Porte-
Saint-Martin et le théâtre Déjazet (ce dernier étant situé sur l’autre trottoir du boulevard
du Temple).
M2-1-7°
Ambigu-
Comique
M2-1-7°
La production des théatres du Boulevard du Crime doit être créative et abondante. La
course au succès est une préoccupation permanente, face à un public avide de
nouveautés. Citons quelques créations marquantes de l’Ambigu : « Madame Angot au
Sérail de Constantinople » (1798) ; « l’Auberge des Adrêts » (1822) ; Gaspard le
Pêcheur » (1837) ; « la Closerie des Genêts » (1841) ; les Trois Mousquetaires »
(1845) ; « le Juif Errant » (1848) ; « la Case de l’Oncle Tom » (1852), etc…
M2-2-6°
Ambigu-
Comique
M2-2-6°
Les privilèges donnaient à leur titulaire un droit exclusif de toute concurrence sur
toutes les autres exploitations rivales. Ils disparurent pendant la Révolution, et en 1791
fut inaugurée une période de liberté relative à laquelle mit fin le décret du 29 juillet
1807, réduisant à huit le nombre des théâtres parisiens.
Il ne restait alors que quatre «grands » théâtres : le Théâtre-Français, l’Académie
impériale de Musique, le Théâtre de sa Majesté l’Empereur et Théâtre de l’Impératrice,
dont les répertoires étaient protégés par des privilèges ; quatre autres théâtres avaient
chacun un répertoire étroitement délimité et étaient protégés par un privilège de
seconde catégorie (Ambigu-Comique, Gaité, Variétés et Vaudeville).
M2-3-7°
Ambigu-
Comique
M2-3-7°
Ouvert le 9 juillet 1769 par Audinot, un ancien acteur de la Comédie-Italienne,
l’Ambigu-Comique est incendié dans la nuit du 13 au 14 juillet 1827. Il quitte alors le
numéro 62 du boulevard du Temple pour reprendre ses activités le 7 juin 1828 dans une
salle nouvelle située 2, boulevard Saint-Martin. Il échappera à la destruction de 1862,
tout comme le théâtre de la Porte-Saint-Martin et le théâtre Déjazet (ce dernier étant situé
sur l’autre trottoir du boulevard du Temple). Le théâtre de l’Ambigu-Comique
disparaîtra définitivement en 1965, pour laisser la place à une banque, dont les activités
l’associeront à une tout autre destinée, celle des « 30 glorieuses »…
La seconde salle de l’Ambigu contenait 1.000 places (en 1860).
Moyenne annuelle des recettes durant les années fastes 1850-1861 : 545.393 francs.
M3-10a-1°
Ambigu-
Comique
M3-10a-1°
Les répertoires des deux théâtres voisins sont différents. Pendant longtemps, c’est le
mélodrame qui fera la fortune de l’Ambigu
M3-1a-
1°
Ambigu-
Comique
M3-1a-1°
Les privilèges donnaient au titulaire un droit exclusif de toute concurrence sur toutes
les autres exploitations rivales. Ils disparurent pendant la Révolution, et en 1791 fut
inaugurée une période de liberté relative à laquelle mit fin le décret du 29 juillet 1807
réduisant à huit le nombre des théâtres parisiens : Théâtre-Français, Académie
impériale de musique, Théâtre de sa Majesté l’Empereur, Théâtre de l’Impératrice,
Ambigu-Comique, Gaité, Variétés et Vaudeville.
Les privilèges des quatre « grands théâtres » portaient sur le répertoire et donnaient
une sorte de suzeraineté dont la tyrannie pouvait se traduire à l’encontre des quatre
théâtres « secondaires » par le paiement de redevances élevées, ce dont l’Opéra de
Paris s’était fait une spécialité. Par un arrêt du 11 juillet 1784, l’Académie de
musique avait obtenu le privilège de tous les spectacles des foires et des remparts de
Paris, avec la faculté de le céder. « C’était la liberté industrielle proclamée, sous
réserve pécuniaire au profit de l’Opéra. Les redevances, seulement tolérées jusqu’ici,
devinrent alors un droit productif » (Boutarel).
M3-1b-1°
Ambigu-
Comique
L’ambigu-Comique est l’un des plus anciens théâtres de Paris. Le comédien Audinot,
après avoir montré des marionnettes à la foire de Saint-Germain, s’établit sur le

M3-1b-1°
boulevard de Temple qui était devenu le centre des plaisirs parisiens. Dès l’année
suivante, il substitue aux marionnettes une troupe de jeunes enfants. C’est alors qu’il
donne à son théâtre le titre d’ « Ambigu-Comique ». Plus tard, les hommes sont
substitués aux enfants. Avec de véritables comédiens, pantomimes et vaudevilles sont
joués avant que le théatre ne devienne, dès le Consulat et l’Empire, l’un des temples du
mélodrame.
M3-1c-1°
Ambigu-
Comique
M3-1c-1°
Lorsqu’elle était sise boulevard du Temple, la grande salle de l’Ambigu-Comique avait
des difficultés structurelles pour atteindre ne serait-ce que le point d’équilibre financier
(concurrence des salles voisines, clientèle potentielle relativement limitée, faible
pouvoir d’achat de la population, etc…). Lorsqu’elle s’« isola » boulevard Saint-
Martin, une exploitation efficace facilita la hausse des investissements esthétiques et
spectaculaires.
Certains directeurs furent par ailleurs remarquables et permirent au théâtre de s’extraire
de situations périlleuses. Citons par exemple la direction de Corse (fin du XVIII° à
1816), puis celles de Cès-Caupennes, de Cormon et d’Antony Béraud. Dans la
mouvance des événements de 1848 et après la retraite de Béraud, il se forma une
association de comédiens qui géra avec bonheur le théâtre en instaurant une période de
recettes bénéficiaires (1848-1852). Les directeurs qui suivirent eurent moins de
difficultés et surent profiter de la conjoncture très favorable de l’économie durant le
Second-Empire (Charles Desnoyers, etc ...)
M3-2c-3°
Ambigu-
Comique
M3-2c-3°
Le prix des places les plus chères suit la même évolution pour les deux théâtres :
1790 : 30 sous 12 deniers
1817 : 3,60
1844 : 5F
En revanche, en 1854, l’Ambigu affiche 6F, alors que la Gaité s’arrête à 5F.
6F est le prix maximum des théâtres du « boulevard-ouest » (Variétés et Gymnase par
exemple).
M3-5a-3°
Ambigu-
Comique
M3-5a-3°
Quel théâtre de Paris n’a pas connu son ou ses incendies, au 18° comme au 19° siècle ?
C’est souvent pour cette raison que les théâtres se déplacent ou sont reconstruits sur
place. Le théâtre le plus nomade de Paris a bien été l’Opéra – ou « Académie de
musique » - qui a changé 14 fois d’emplacement… suivi de près par le Théâtre-
Français – ou Comédie-Française.
Notons au passage qu’il leur arrive souvent de changer de nom lorsqu’ils sont
reconstruits. L’Ambigu-Comique deviendra ainsi « Ambigu » tout court lors de son
installation sur le boulevard Saint-Martin.
M3-6a-
1°
Ambigu-
Comique
M3-6a-1°
Après l’incendie de la nuit du 13 au 14 juillet 1827, qui provoqua la disparition de
l’Ambigu-Comique, il fallut attendre quatre années pour que soit reconstruite une
salle sur cet emplacement mythique et idéal pour qui voulait appâter les
boulevardiers.
M3-E-9°
Ambigu-
Comique
M3-E-9°
Parmi les créations marquantes de l’Ambigu, citons : Madame Angot au sérail de
Constantinople (1798) où triomphe Corse ; La Femme à deux maris de Pixérécourt ;
L’Auberge des Adrêts (1823) avec les deux compères, Robert Macaire et Bertrand ;
Gaspard le Pêcheur (1837) de Bouchardy ; La Closerie des Genêts (1841) ; Les Trois
Mousquetaires (1845) ; Le Juif Errant (1848) d’Eugène Sue ; La Case de l’Oncle Tom
(1852), etc… Tout au long du XIX° siècle, le répertoire de cette scène populaire est
servi par des acteurs d’exception : Frédérick Lemaître, Bocage, Mélingue, Ménier,
Taillade.
Les salles de théâtre du boulevard Saint-Martin survivront à la « mort du Boulevard du
Crime », en 1862. Faisant figure de mémoire vivante, les mélodrames joués à
l’Ambigu comme La Porteuse de Pain ou Les Deux Gosses seront des succès ; plus
tard, L’Assommoir sera accueilli avec passion, etc... Dans un autre régistre, Firmin
Gémier y jouera dans Les Gaîtés de l’Escadron en 1895…
M2-1-14°
Amende
M2-1-14°
« C’est le châtiment infligé, sous forme de peine pécuniaire, à tout artiste ou employé qui
manque à son service d’une façon quelconque. L’amende est naturellement proportionnée
à l’importance de la faute. Encourt une amende celui qui arrive en retard à une répétition
ou à un spectacle, qui manque une répétition, qui fait du bruit en scène ou à l’orchestre,
qui vient au théâtre en état d’ivresse, qui provoque du bruit ou du scandale, qui n’est pas
costumé comme il doit l’être, qui manque de respect à un régisseur, qui fait manquer la
manoeuvre d’un décor, etc., etc. Quant à l’artiste chargé d’un rôle important, qui, sans
raison valable, fait manquer un spectacle et met le théâtre dans l’obligation de faire

relâche, sa conduite soulève une question de dommages-intérêts qui ne peut être tranchée
que par les tribunaux » (A. Pougin, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre,
1885).
M3-1b-8°
Angot
(Madame)
M3-1b-8°
« Type populaire de la poissarde parvenue, de la marchande fort vulgaire qui,
enrichie sans avoir abdiqué ses manières de harengère, veut singer la grande
dame… Pour expliquer la naissance de ce personnage, à la fois comique et
mythique, on a considéré qu’il avait pu surgir dans l’imagination populaire dès le
temps des spéculations de Law et des extravagantes fortunes de la rue
Quincampoix ». L’auteur Maillot, l’inventeur de Madame Angot, avait écrit en
1795 une parade pour la Gaité du nom de la Nouvelle Parvenue, ainsi que trois
autres vaudevilles.
C’est plus tard que l’œuvre de Joseph Aude, Madame Angot au sérail de
Constantinople sera créée à l’Ambigu en 1803. Puis viendra une des transpositions
les plus connues , la très célèbre Fille de Madame Angot, œuvre de Clairville et
Siraudin, avec la musique « pimpante » de Charles Lecocq, créée à Bruxelles en
1872 puis jouée aux Folies-Dramatiques en 1873.
M3-6a-2°
Antier
(Benjamin)
M3-6a-2°
Auteur dramatique, né et mort à Paris (1787 - 1870). Il a produit, seul ou en
collaboration avec Pixérécourt, Decomberousse, Couailhac, et d’autres, un grand
nombre de mélodrames et de vaudevilles, notamment : L’Auberge des Adrêts (184),
Beignets à la cour (1835), une de ses meilleures pièces, Robert Macaire (1836), où
Frédérick Lemaître remporta un triomphe.
M2-1-5°
Antony
M2-1-5°
En décembre 1831, Charles-Jean Harel, ancien directeur de l’Odéon et amant de
Mademoiselle George, devient directeur « privilégié » du théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Alexandre Dumas reprend à la Comédie-Française le manuscrit d’Antony pour le donner à
Harel. Victor Hugo apporte sa contribution avec Marion Delorme . Ce sont alors deux
triomphes pour les auteurs et leur directeur, mais aussi pour Frédérick Lemaître et Marie
Dorval.
Antony, le premier des grands héros du théâtre romantique, est le personnage central du
drame d’Alexandre Dumas père qui porte son nom (1831). Le thème éternel de l’adultère,
du mari, de la femme et de l’amant est ici développé avec un caractère poignant grâce à la
sombre figure d’Antony.
M3-10a-5°
Antony
M3-10a-5°
Antony est le personnage central du drame d’Alexandre Dumas père qui porte son
nom (1831), le premier des grands héros du théâtre romantique. Le thème éternel
de l’adultère, du mari, de la femme et de l’amant est ici développé avec un
caractère poignant, grâce à la sombre figure d’Antony.
M3-O-6°
Arago
François
M3-O-6°
Ecrivain et homme politique, Etienne Arago est né à Estagel (Pyrénées-Orientales) en
1802, et mort à Paris en 1892. Il fit représenter de nombreuses pièces, écrites le plus
souvent en collaboration : l’Anneau de Gypès (1825), L’Avocat, mélodrame (1827), La
Fleuriste (1827), Les Malheurs d’un jeune garçon (1834), Les Pages de Bassompierre
(1835), Le Cabaret de Lustucru (1838), Les Mémoires du diable (1842), Une Invasion de
grisettes (1844), Les Aristocrates, comédie en vers (1847). Il fut directeur du Vaudeville
de 1830 à 1840. Homme politique, il prit une part très active à toutes les luttes du parti
républicain. Compromis dans la journée du 13 juin 1849, il se réfugia à Bruxelles, et fut
condamné par contumace à la déportation. Pendant son exil, il publia des volumes de vers
: Spa, son origine, son histoire; le Deux-Décembre; la Voix de l’exil. Rentré en France en
1859, maire de Paris après le 4 septembre 1870, député des Pyrénées-Orientales (1871), il
devint archiviste de l’Ecole des Beaux-Arts (1878) et conservateur du musée de
Luxembourg (1879). On lui doit également la publication de L’Hôtel de Paris au 4
Septembre et pendant le Siège (1874), les Tuileries et le Carrousel (1878).
M3-7a-3°
Arlequinade
M3-7a-3°
A. Pougin nous donne cette description des arlequinades : « Lorsque des comédiens
italiens vinrent pour la première fois s’établir à Paris, ils importèrent chez nous, sur leur
théâtre, les personnages comiques de leur pays, en tête desquels se trouvait Arlequin. Cet
Arlequin était presque toujours le principal héros de leurs comédies, et les théâtres de la
Foire, les imitant en cela, transportèrent bientôt Arlequin sur leurs scènes populaires, si
bien que pendant plus d’un demi-siècle tous les personnages de la comédie italienne
prirent leurs ébats sur tous nos théâtres secondaires. L’habitude était si bien prise que,
même lorsque les comédiens italiens abandonnèrent les pièces de leur pays pour se vouer
au genre de la comédie française, plusieurs auteurs continuèrent d’employer le type
d’Arlequin, entre autres Saint-Foix, Marivaux et Florian. Ce sont les pièces de ce genre
qui prirent le nom d’Arlequinades. Aujourd’hui, on ne désigne ainsi que les petits

pantomimes dans lesquelles réapparaissent ces anciens personnages aimés de nos pères :
Arlequin, Pierrot, Cassandre, Léandre, et Colombine. » (Dictionnaire historique et
pittoresque du théâtre, 1885).
M3-E-6°
Arlequinade
M3-E-6°
A propos de l’arlequinade, A. Pougin écrit : « Lorsque des comédiens italiens vinrent
pour la première fois s’établir à Paris, ils importèrent chez nous, sur leur théâtre, les
personnages comiques de leur pays, en tête desquels se trouvait Arlequin. Cet Arlequin
était presque toujours le principal héros de leurs comédies, et les théâtres de la Foire, les
imitant en cela, transportèrent bientôt Arlequin sur leurs scènes populaires, si bien que
pendant plus d’un demi-siècle tous les personnages de la comédie italienne prirent leurs
ébats sur tous nos théâtres secondaires. L’habitude était si bien prise que, même lorsque
les comédiens italiens abandonnèrent les pièces de leur pays pour se vouer au genre de la
comédie française, plusieurs auteurs continuèrent d’employer le type d’Arlequin, entre
autres Saint-Foix, Marivaux et Florian. Ce sont les pièces de ce genre qui prirent le nom
d’Arlequinades. Aujourd’hui, on ne désigne ainsi que les petits pantomimes dans
lesquelles réapparaissent ces anciens personnages aimés de nos pères : Arlequin, Pierrot,
Cassandre, Léandre, et Colombine » (Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre,
1885).
M3-2b-3°
Arlincourt
(d’)
(Charles)
M3-2b-3°
Ecrivain français, né en 1789, au château de Mérantris, près de Versailles, mort à Paris en
1856. D’abord écuyer de Madame mère sous l’Empire, puis auditeur au Conseil d’Etat, il
se rallie aux Bourbons. En 1818, il publie son grand poème de la Caroléide, et donne
successivement des romans comme Ipsiboé (1823); et surtout le Solitaire (1821), chef-
d’oeuvre célèbre, de bizarre emphase ; puis, après la révolution de Juillet, une série de
romans pseudo historiques, et qui n’étaient pas des pamphlets contre le régime nouveau :
les Rebelles sous Charles V (1832), les Ecorcheurs ou l’Usurpation et la Peste (1833), le
Brasseur du roi (1833), etc. D’une tragédie qu’il fit représenter au Théâtre-Français en
1827, le Siège de Paris, on a retenu ces vers pleins d’équivoque :
« On m’appelle à régner...
Mon père, en ma prison, seul à manger m’apporte.
J’habite la montagne, et j’aime la vallée... »
M2-2-3°
Arrondisse
ment
théâtral
M2-2-3°
Depuis 1864, la liberté de l’industrie théâtrale était redevenue complète, par l’effet d’un
décret impérial, comme à l’époque de la Révolution. Auparavant, cette industrie était
réglementée de multiples façons. Les plus grandes villes ne pouvaient avoir plus de deux
théâtres, les autres un seul. A part les grandes villes qui avaient des troupes dramatiques
sédentaires, c’est-à-dire consacrées à elles seules et ne se déplaçant pas, le territoire de la
France était divisé en vingt-cinq circonscriptions formant chacune un « arrondissement
théâtral ». Ces circonscriptions étaient exploitées simultanément par une, deux ou trois
troupes de comédiens fixes ou ambulantes.
M3-1b-5°
Auberge
des
Adrêts
(pièce)
M3-1b-5°
Mélodrame en trois actes, de Benjamin Antier, Saint-Amand et Paulyanthe (Ambigu-
Comique, 2 juillet 1823). L’auberge des Adrêts est sur la route de Grenoble à Chambéry.
A l’occasion du mariage de Charles, fils adoptif de l’aubergiste, deux scélérats, Robert
Macaire et Bertrand, entrent dans l’auberge, assassinent et volent pendant la nuit un riche
convive. Une pauvre femme, Marie, est accusée, mais elle se disculpe ; puis,
reconnaissant son fils dans Charles, et dans Macaire son mari qui l’a abandonnée jadis,
elle veut aider le meurtrier à fuir. Macaire, arrêté, reporte l’horreur du crime sur Bertrand,
et celui-ci, exaspéré, le blesse dangereusement d’un coup de pistolet. Frédérick Lemaître
fit de Macaire un type plein d’audace et d’originalité, qui consacra sa réputation.
M2-1-9°
Auberge
des Adrêts
(pièce)
M2-1-9°
Mélodrame en trois actes de Benjamin Antier, Saint-Amand et Paulyanthe (Ambigu-
Comique, 2 juillet 1823).
L’Auberge des Adrêts se trouve sur la route de Grenoble à Chambéry. A l’occasion du
mariage de Charles, fils adoptif de l’aubergiste, deux scélérats, Robert Macaire et
Bertrand, entrent dans l’auberge, assassinent et volent pendant la nuit un riche convive.
Une pauvre femme, Marie, est accusée, mais elle parvient à se disculper ; puis,
reconnaissant dans Charles son fils, et dans Macaire son mari qui l’avait jadis
abandonnée, elle tente d’aider le meurtrier à fuir. Macaire, arrêté, reporte l’horreur du
crime sur Bertrand, et celui-ci, exaspéré, le blesse dangereusement d’un coup de pistolet.
Frédérick Lemaître fit de Macaire un type plein d’audace et d’originalité, qui consacra sa
réputation.
M3-1a-2°
Audinot
(Nicolas)
M3-1a-2°
Audinot, ancien directeur de la Comédie-Italienne, construisit en 1768 une loge à la foire
Saint-Germain pour y donner des spectacles de marionnettes. Ayant fait de bonnes
affaires, il inaugura en 1769 un théâtre sur le boulevard du Temple, et il l’appela
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
1
/
58
100%