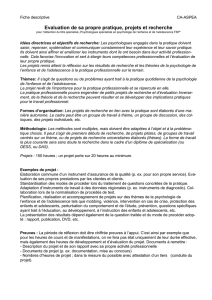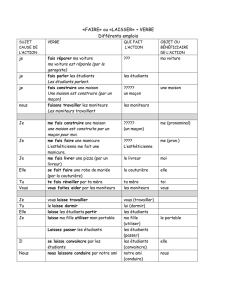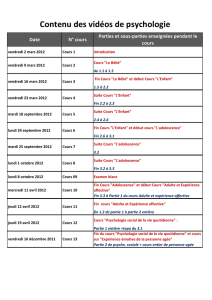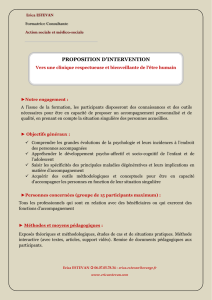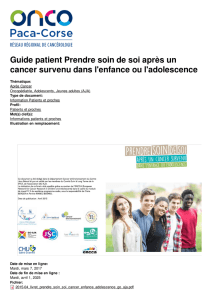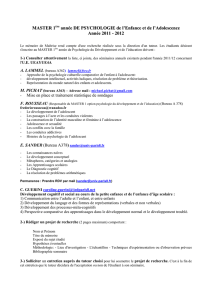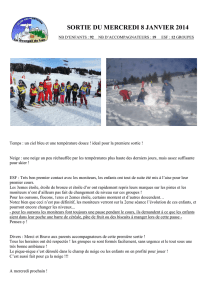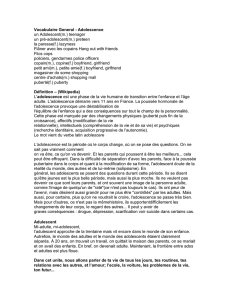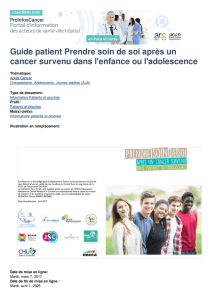La psychologie de l`enfant

Recyclage des Moniteurs/trices, District d’Avedji/Lomé, Septembre 2008
« La psychologie de l’enfant à l’usage des moniteurs »
Préparée et présentée par M. HAMENOU Kodzo Pascal, Sociologue et Educateur de Jeunes
La psychologie de l'enfant
Introduction
Le thème abordé dans notre étude tourne autour de l’enfant. Nous pensons que les arguments
avancés dans cette étude aideront les parents et les moniteurs pour une meilleure organisation
et adaptation dans l’encadrement des enfants.
Les résultats des recherches des grands psychologues comme PIAGET et ROUSSEAU ont
permis de comprendre que l’enfant n’est pas "un adulte en miniature" mais une créature qu’il
faut aborder en tenant compte de son évolution physique et psychique dans le cadre de son
éducation. En effet l’enfant doit cesser d’apparaître comme "un adulte réduction", dont il est
permis d’interpréter les comportements en fonction de "la mentalité adulte". Il ne pense ni
n’agit comme l’homme. on ne peut donc le comprendre qu’en fonction de ses propres
structures mentales- un double effort est donc nécessaire : il faut d’une part s’efforcer de
connaître ses structures et d’autre part, faire preuve d’imagination dans une véritable
décentration psychologique- l’objet de la psychologie de l’enfant définit ainsi, par voie de
conséquence, la méthode devant s’imposer pour son éducation.
L’enfant est un être en perpétuel devenir : il importe donc de suivre son évolution pas à pas,
en observateur et en expérimentateur, en se plaçant dans le courant du développement.
Nous nous efforcerons de vous en donner quelques détails à travers les chapitres suivants :
Chapitre1 : définitions : éducation, instruction, psychopédagogie
Chapitre 2 : les étapes de l’évolution de l’enfant
Chapitre 3 : connaissance de l’adolescence
Chapitre 4 : la place des activités ludiques dans la vie de l’enfant
Chapitre 5 : l’ordre et la discipline
Chapitre 6 : l’émulation
Chapitre 7 : la famille, l’école de dimanche
Chapitre 8 : quelques citations bibliques
Chapitre 1 : instruction, éducation, psychopédagogie
A/ L’instruction
Elle consiste à donner des connaissances, un savoir à une personne ; elle est plutôt théorique.
Instruire c’est faire connaître, inculquer une connaissance à quelqu’un (Deut11 :19-20).

Recyclage des Moniteurs/trices, District d’Avedji/Lomé, Septembre 2008
« La psychologie de l’enfant à l’usage des moniteurs »
Préparée et présentée par M. HAMENOU Kodzo Pascal, Sociologue et Educateur de Jeunes
B/ L’éducation
C’est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore « mures »
afin de leur donner les atouts nécessaires à leur intégration dans n’importe quelle société
donnée.
Elle est l’art d’élever les enfants. Sous une autre forme, l’éducation a toujours existé, depuis
qu’il y a des pères et des mères qui apprennent à leurs enfants à parler, à manger, à se vêtir, à
se garder des dangers, à s’intégrer dans leur société.
Peu à peu, le développement constant de la civilisation et l’élargissement des connaissances
ont rendu très difficile pour les parents la tâche de donner à leurs enfants une préparation
suffisante à la vie.
Pour suppléer à l’insuffisance des familles, une institution nouvelle est née, l’école. des
spécialistes se sont chargés de l’éducation et de l’instruction de l ‘enfance. Avec le temps ils
ont inventé des techniques qui s’améliorent au fur et à mesure que progressent les données
psychologiques de l’enfant.
C/ La Pédagogie
On peut définir la pédagogie comme une science basée sur la connaissance de l’enfant. Elle
donne les règles à suivre pour instruire et éduquer les enfants. La pédagogie traite de la
théorie de l’éducation.
D/ La psychologie
Elle se définit d’un point de vue global comme la science de la conduite ; il faut entendre non
seulement le comportement observable mais encore l’action sur l’entourage.
E/ La psychopédagogie
Elle est quant à elle la science de l’éducation qui prend en considération la dynamique de la
psychologie et les étapes du développement de l’enfant pour une meilleure adaptation de
l’enseignement et des méthodes.
PIAGET est l’un des auteurs dont elle s’inspire.
IMPLICATION SPIRITUELLE
Plusieurs passages de la bible nous invitent à instruire et à éduquer l’enfant selon la voie du
Seigneur.
Il convient de connaître l’enfant qui est au centre de l’instruction et de l’éducation afin de lui
apporter un enseignement adapté selon les étapes de son évolution que nous aborderons dans
le prochain chapitre.
Chapitre 2 : les étapes de l’évolution de l’enfant

Recyclage des Moniteurs/trices, District d’Avedji/Lomé, Septembre 2008
« La psychologie de l’enfant à l’usage des moniteurs »
Préparée et présentée par M. HAMENOU Kodzo Pascal, Sociologue et Educateur de Jeunes
Ce chapitre est de loin le plus important de notre étude. Il nous aidera à comprendre l’enfant
dans toute sa personnalité (physique, psychologique, psychique, …) et par conséquent à
apprendre à mieux jouer notre rôle d’éducateur.
Les phases essentielles de l’évolution psychique de l’enfant correspondent sensiblement aux
étapes de son développement physique. Les deux peuvent ne pas se superposer mais rien
n’empêche qu’elles marchent en parfaite correspondance. A chacun de ses stades, on doit
considérer l’enfant comme un être à part, ses goûts, ses raisonnements, ses jugements, ses
actes révèlent chaque fois qu’il n’est plus ce qu’il a été précédemment et qu’il n’est pas
encore ce qu’il deviendra plus tard.
Première période : Jusqu'à 6 ans
De trois à huit mois, le bébé commence à s’intéresser à ce qu’on lui montre, aux
mouvements de ses mains ; il reconnaît les objets familiers et les personnes qui vivent autour
de lui. Les bruits, les sons le captivent : c’est la période des intérêts sensoriels.
A partir d’un an et à mesure que son langage se perfectionne, apparaît sa première activité
intellectuelle. Il rapporte tout à lui – il se révèle naturellement accaparant et jaloux – c’est
l’âge de l’égocentrisme et des intérêts subjectifs.
Entre trois et six ans, le pourquoi des choses préoccupe l’enfant – les données fournies
directement par les sens ne suffisent plus à satisfaire sa curiosité – il pose sans cesse des
questions – une sorte d’ivresse de causalité le poursuit : les pourquoi se succèdent tout le long
de la journée – si gênantes que soient parfois ses interminables questions, n’étouffons pas
chez l’enfant cet instinct questionneur, notre meilleur auxiliaire pour son instruction.
Deuxième préiode : De 6 à 12 ans
L’enfant se rend compte de ce qu’il pense et de ce qu’il dit – il parle beaucoup – il s’efforce
de traduire en actes les idées qui lui trottent dans la tête – sa mémoire emmagasine - son
attention devient volontaire ; il commence à raisonner et à juger – son esprit critique s’éveille.
C’est vers sept ans qu’il cesse d’ajouter foi spontanément aux contes de fées.
Troisième période : de 12 à 15 ans
L’enfant sent monter la vie à lui, il se sent vivre. Il a des idées personnelles, son sens critique
commence à poindre, sa volonté s’affermit – à mesure qu’il grandit il devient capable de
maintenir son attention sur une suite de faits qui s’enchaînent – il les associe – il voit des
ressemblances et des différences – il les coordonne en un tout de plus en plus logique.
L’enfant se sent à présent à mesure d’aborder et de comprendre des sujets moins puérils. Les
histoires imaginaires cessent de le passionner ; mais en revanche, les histoires d’aventures
vécues retiennent davantage son intention.
DIRECTIVES PEDAGOGIQUES
L’évolution tant physique qu’intellectuelle s’échelonne sur une période relativement
considérable de la vie humaine, plus du quart pour la majorité des hommes.

Recyclage des Moniteurs/trices, District d’Avedji/Lomé, Septembre 2008
« La psychologie de l’enfant à l’usage des moniteurs »
Préparée et présentée par M. HAMENOU Kodzo Pascal, Sociologue et Educateur de Jeunes
L’éducateur doit tenir compte de ce lent processus de transformation pour ne proposer à
l’enfant que des activités en rapport avec son âge, son degré de développement.
On ne saurait connaître un enfant et comprendre ses réactions si on ignore les caractéristiques
de son âge. On ne saurait aussi le connaître si s’en tenant à ces idées générales, on néglige
l’observation du cas concret et précis qu’il représente. La référence au stade évolutif doit se
compléter de la référence à la personnalité.
DIRECTIVES SPIRITUELLES
Proverbes 22/6 : Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et quant il sera vieux, il ne
s’en détournera pas.
Il faut noter que l’enfance représente une période de la vie extrêmement riche et extrêmement
importante en elle-même.
Il est indispensable d’aborder cette période de la vie humaine avec beaucoup plus de sérieux –
selon notre texte biblique la suite de l’existence en dépend en grande partie.
Selon cette étude, nous pensons que la période idéale pour la conversion de l’enfant se situe
entre 6 et 12 ans. Pendant cette période, l’enfant se rend compte de ce qu’il pense ; il
commence à raisonner – son esprit critique s’éveille- il est donc capable de prendre une
décision en ce qui concerne le bien et le mal. Bien sûr, il ne faut pas attendre la période de la
conversion pour donner l’enseignement biblique ; certains enfants étonnent par leur
connaissance avant l’âge de 6 ans.
Il ressort aussi de notre analyse qu’il est nécessaire d’avoir au moins 3 classes différentes
d’enfants lors des regroupements à but éducatif et d’adapter le contenu du message à donner
en fonction de chaque classe d’âges.
Chapitre 3 : connaissance de l’adolescence
L’adolescence est un processus plutôt qu’une période de maturation. Ce qui peut être entendu
aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan psychologique ou social. Maturation, cela
veut dire marche vers une maturité qui peut être affective, intellectuelle, sociale ou physique.
La maturité est aussi un processus d’acquisition des aptitudes, des qualités ou des
qualifications nécessaires à un individu pour tenir sa place dans la société.
Du point de vue purement chronologique, les auteurs ne sont pas d’accord sur la
détermination de la période précise de l’adolescence. certains la situent entre 13 et 21 ans.
D’autres entre 12 et 19 ans. Cette instabilité permet simplement de dire que l’adolescence est
la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte.
Si l’adolescence est une période de transition ou si elle apparaît comme telle, c’est non
seulement parce que les deux périodes qui la limitent et l’encadrent semblent plus facile à
définir mais aussi parce qu’on peut y voir une sorte d’instance, instance de maturité et
instance d’adulte.
I/ L’ADOLESCENCE DU POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE ET ECONOMIQUE

Recyclage des Moniteurs/trices, District d’Avedji/Lomé, Septembre 2008
« La psychologie de l’enfant à l’usage des moniteurs »
Préparée et présentée par M. HAMENOU Kodzo Pascal, Sociologue et Educateur de Jeunes
L’insertion sociale de l’adolescent comme adulte avec les droits, les devoirs et pouvoirs qui
sont ceux des adultes se fait de nos jours de plus en plus tard.
Le temps de plus en plus long nécessaire à l’apprentissage d’un métier, la prolongation de
l’exercice professionnel des adultes accroissent cet allongement de la période de
transition, ce qui a des répercutions considérables sur le plan non seulement social, mais aussi
psychologique d’une masse de plus en plus grande d’adolescentes et d’adolescents laissés en
instance, c’est à dire en marge.
II/ L’ADOLESCENCE DU POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE ET
PSYCHOSOCIAL
Plusieurs critères permettent de définir l’adolescence :
a) la sexualité
Le développement de la sexualité est rapide et suscite des motivations puissantes. Ici le flirt
est considéré comme le phénomène typique de l’adolescence. il comporte d’abord tous les
jeux de la séduction et l’apprentissage des sentiments amoureux à l’occasion des relations
interpersonnelles avec des partenaires de sexe opposé.
Se faire connaître et se faire reconnaître par l’autre dans une relation sentimentale et érotique
est une expérience importante pour l’adolescent ou l’adolescente.
Par le flirt et à travers lui, l’adolescente et l’adolescent recherchent en quoi et comment ils
peuvent plaire, jusqu’à quel point ils peuvent plaire et qu’est-ce qui plaît en eux ou en elles.
On comprend pourquoi l’échec sentimental, lorsqu’il prend une importance particulière, du
fait de l’intensité de l’implication personnelle, atteint la personnalité même de l’adolescent ou
de l’adolescente et remet en question tout son être.
De plus en plus surtout par suite à des transformations de la mentalité sociale et le
développement des méthodes contraceptives, les expériences sexuelles directes remplacent le
flirt et se font de plus en plus précoces.
La pression des besoins sexuels est à l’origine de nombreux autres problèmes de la conscience
adolescente, car ces besoins entrent en conflit avec d’autres non moins naturels à cet âge tel
que le besoin d’idéal.
b) la révolte contre l’environnement social et besoin de recréer les valeurs
Après un début marqué par le narcissisme, l’effervescence de la rumination intérieure, le
débat du « moi» avec lui-même, le romantisme, l’adolescence est surtout caractérisée par
toutes les formes de la révolte, car on ne s’oppose soi-même qu’en s’opposant, on ne
s’affirme qu’en niant. Les périodes antérieures d’opposition ne disposent pas de la puissance
physique que l’individu découvre et retient à l’adolescence.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%