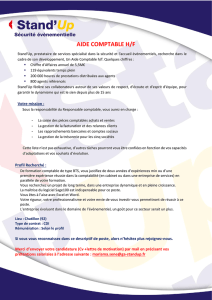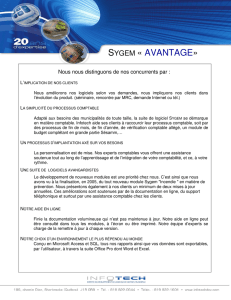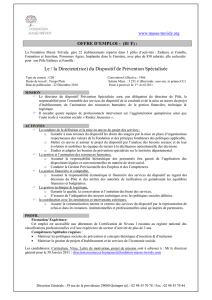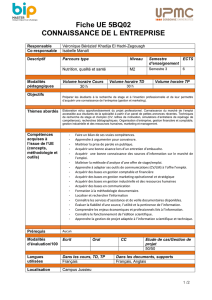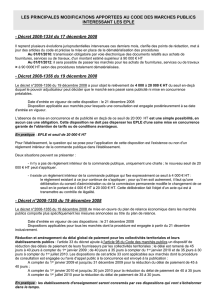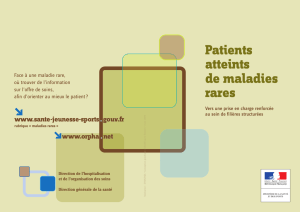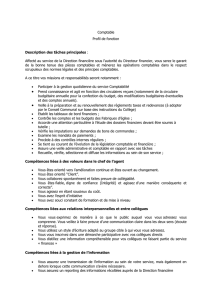B2_Roland

1
Roland Janvier
CNLAPS : 7èmes journées nationales de la prévention spécialisée
De l’utilité sociale de nos pratiques éducatives
Vers une recomposition de l’action sociale :
utilité sociale et place de la prévention spécialisée
Introduction
L’utilité sociale peut être vue sous deux angles, que, pour la clarté de l’exposé, je vous propose de
simplifier et d’opposer dans un premier temps avant d’envisager la manière de les assortir.
Selon une conception utilitariste, l’utilité sociale se mesure à l’aune du profit qu’apportent les
interventions sociales à la société. Elle est alors synonyme de performance et d’efficience selon des
critères essentiellement économiques.
Cette première conception, largement critiquée, peut être opposée à une vision plus politique de
l’utilité sociale qui va alors envisager la manière dont le travail social contribue à faire évoluer la vie
sociale.
Je vous propose de présenter brièvement ces deux approches de l’utilité sociale pour envisager
comment, dans ces recherches de nouvelles légitimités au travail social, la prévention spécialisée
peut prendre position.
1. L’utilité sociale dans son versant « utilitaire »
L’utilité sociale, dans une conception fonctionnaliste, se réfère au concept d’investissement social
récemment rappelé dans le plan d’action gouvernemental en faveur du travail social et du
développement social. Le mécanisme théorique est simple, il part du postulat que ce qui est dépensé
pour une action sociale génère un retour sur investissement qui peut, à long terme, produire des
recettes supérieures aux coûts initiaux. Par exemple, un enfant pris en charge en ITEP du fait de
troubles comportementaux qui perturbent son apprentissage scolaire va peser sur le budget de la
sécurité sociale. Mais si cette action permet de le réintégrer dans un cursus de formation, de
qualification, qui améliorera son employabilité future, cet enfant, devenu un adulte intégré
socialement et économiquement, paiera des cotisations sociales, des impôts qui, au total de sa
carrière, seront d’un montant bien supérieur à ce qui a été investi pour sa réadaptation.
1.1. Le travail social à la recherche de nouvelles légitimités
Dans cette approche fonctionnaliste, l’utilité sociale est prioritairement considérée selon des critères
quantitatifs qui éveillent naturellement la méfiance des travailleurs sociaux. Je propose de ne pas
rejeter a priori cette dimension qui peut être l’opportunité de conférer une certaine légitimité au
travail social dans un monde où tout se compte. C’est sans doute parce que le travail social a été trop
discret sur sa « rentabilité » économique et sociale qu’il a prêté le flanc à la dénonciation de sa
prodigalité. Sur le temps court, l’action sociale est dispendieuse, mais sur le long terme, elle est sans

2
conteste un investissement socialement profitable. C’est là une voie à explorer pour légitimer ce que
font les établissements et services de l’action sociale et médico-sociale.
1.2. La logique comptable comme régulateur ultime du travail social
Cependant, cette analyse présente, à mes yeux, deux écueils : D’une part, le retour sur investissement
suppose de se donner des critères ce qui n’est pas simple. Revenons à l’exemple du jeune confié à un
ITEP. L’analyse coût/investissement tenue au plan individuel ne peut être transposée au plan macro-
sociétal telle-quelle. En effet, il est normal qu’un individu participe à la vie de la société par ses
contributions diverses et variées. Aucune comptabilité ne peut renvoyer chacun à un solde individuel
charges/produits. Il faudrait alors déplacer l’argument : Si le projet éducatif, thérapeutique et
pédagogique pour ce jeune produit les effets attendus il évitera une dégradation de sa situation soit
dans le registre comportemental – la prison coûte très cher à la société – soit dans le registre
pathologique – l’hospitalisation psychiatrique représente une charge très élevée. C’est la notion de
« coûts évités » dont parle Philippe Langevin. Mais ces coûts, nous l’avons vu, sont difficiles à valoriser.
Pour ma part, afin de montrer l’ambivalence de ce genre de chiffrage, je propose de parler de
« manque à dépenser », c’est-à-dire d’évaluer les dépenses qui ne sont pas engagées et qui auraient
été bien supérieures aux dépenses réellement engagées.
D’autre part, tout ne peut pas se compter. C’est là le second écueil de cette hégémonie de la logique
comptable. Le quantitatif ne permet jamais de rendre totalement « compte » de tous les aspects
qualitatifs qui donnent consistance à la relation d’aide. La difficulté majeure du travail social réside
dans sa complexité – tout simplement parce qu’il se situe au cœur de la complexité humaine. Il est très
compliqué de rendre compte de la complexité, la tendance est alors de simplifier : simplifier en
réduisant le réel au binaire (fait/non-fait, bon/mauvais, Inclus/exclus…) ; simplifier en remettant au
chiffre le pouvoir de tout expliquer, classifier, catégoriser ; simplifier en évacuant ce qui ne se chiffre
pas (le mieux-être, l’affectif, le plaisir, l’esthétique…). La complexité suppose la compréhension pas la
simplification. C’est ce qui est compliqué qui peut être simplifié. Ce qui est complexe convoque
l’intelligence.
Le coup d’Etat qu’a opéré la logique comptable – paradigme de la simplification – ne s’explique pas
par la pénurie budgétaire mais par la conversion généralisée de la pensée commune à la rationalisation
de l’humain. Mobiliser des concepts simplistes pour évaluer l’utilité sociale des différentes formes du
travail social a pour effet immédiat, officiellement par souci de rentabilité et de performance
budgétaire, d’éradiquer les actions les plus complexes – donc les plus subtiles, les plus ouvertes ou
marquées par l’incertitude – au profit des action les plus simples – donc les plus simples dans leur
forme, les plus facilement compréhensibles. C’est ce paradigme de la simplification qui motive la
réduction drastique des moyens, voire la fermeture, d’équipes de prévention spécialisée – ce que nous
avons connu dans le Finistère. Et c’est précisément lié au fait que la prévention spécialisée se situe
dans les espaces les plus complexes de la société, parce que les plus problématiques. Ce n’est pas
d’abord une question de ressources financières. Sinon, comment expliquer les sommes investies dans
d’autres champs. Je pense ici à l’autisme. Mais chacun sait, notamment depuis les recommandations
de la HAS et de l’ANESM, que les théories comportementalistes sont plus faciles à comprendre par la
logique comptable…
Le risque de tout rapporter à la simplification quantitative est d’abord lié aux réductions qui s’opèrent.

3
1.3. Un risque d’impasse : la financiarisation du travail social
J’ai parlé jusque-là de logique comptable. Il faut compléter cette logique par ce que Michel Chauvière
nomme la « chalandisation ». C’est, bien-sûr l’import des pratiques marchandes, essentiellement par
la mise en concurrence des offres. Mais nous ne sommes pas encore au bout du chemin…
Le lancement récent, par la secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire, d’un appel à projets d’un
an pour des « contrats à impact social » ouvre une nouvelle brèche à l’envahissement de ces logiques
marchandes et comptables.
Le principe est simple – toujours ce paradigme de la simplification qui alimente la dictature de la
rationalisation : un opérateur propose à des investisseurs, via un intermédiaire bancaire, de financer
une action innovante. Cette action vise à générer des économies par rapport aux formes traditionnelles
d’intervention sociale. Des critères d’évaluation de l’action permettront, via un évaluateur
indépendant, de démontrer que les objectifs ont été atteints. La collectivité qui réalise ainsi une
économie de dépense rémunère l’investisseur qui retrouve sa mise. Si les objectifs sont dépassés, le
projet envisage de verser des dividendes, sinon, il perd son investissement (ce qui rapproche ce genre
de pratiques du « capital risque » des investisseurs).
Au-delà de la logique comptable, au-delà de la marchandisation du travail social, nous assistons ici à
un début de financiarisation de l’action sociale. On peut facilement imaginer que les investisseurs dans
les contrats à impact social – ce ne sont pas des mécènes, il ne faut pas confondre
1
– demanderont des
comptes, surtout si les objectifs ne sont pas atteints. On peut même imaginer que ce quasi-prêt pourra
justifier l’ingérence de l’apporteur de fonds privés dans la conduite du projet : niveau des
rémunérations accordées, grilles horaires des intervenants, etc. De plus, il y a fort à parier que les
actions innovantes qui seront retenues pour être financées sous cette forme seront les plus faciles à
évaluer, les plus simples, celles qui portent la meilleure lisibilité des retours sur investissement.
2. L’utilité sociale dans sa dimension politique
Dans cette seconde approche fondée sur les théories critiques, l’utilité sociale est plutôt considérée
selon des critères qualitatifs qui mobilisent une analyse socio-politique des effets du travail social.
Nous pouvons penser que cette perspective est plus traditionnelle dans les cultures du travail social.
Cependant, il semble aujourd’hui nécessaire de réhabiliter la dimension politique de l’action sociale,
trop souvent abandonnée au profit d’une vision instrumentale des actions. L’idée est que le travail
social, travail sur et dans la société, porte intrinsèquement une perspective de transformation sociale.
Autrement dit, le travail social ne serait pas uniquement réparateur mais aussi contributeur à la
construction d’une société plus juste et plus intégrative.
2.1. Agir dans la société : un processus d’émancipation
Le simple fait d’œuvrer à la résolution de problèmes des personnes les plus vulnérables du corps social
ne représente pas la totalité des légitimités du travail social. Agissant ainsi, l’action participe à la
promotion des personnes, au développement d’une citoyenneté de plein exercice pour tous. Là, les
thèmes de la participation des usagers à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet
1
Le mécénat d’entreprise est une démarche de don, aux contreparties restent très limitées, qui développe la
notoriété de l’entreprise et noue un partenariat à vocation sociale.

4
qui les concernent, prend tout son sens. Il ne s’agit pas simplement de dépanner mais de donner les
clefs du processus de réhabilitation aux intéressés eux-mêmes. En permettant à la personne
accompagnée d’être actrice de la résolution des difficultés qui la concernent, l’intervention sociale lui
permet de libérer son pouvoir d’agir. Le travail social œuvre ainsi au développement des capabilités
des personnes, au sens où l’entend Amartya Sen.
L’utilité sociale réside ici dans le processus d’accompagnement qui arme les personnes vulnérables
pour être mieux en mesure d’affronter les problèmes de leur existence, pour leur permettre de
prendre en main leur destin individuel.
Ce processus d’émancipation, totalement immergé dans l’espace social, a des effets transformateurs
qui n’en restent pas au plan individuel.
2.2. Agir sur la société : une visée transformatrice
Car en effet, permettre à des personnes de reprendre en main leur destin de vie, entraîne des
conséquences sur leur entourage : famille, communauté sociale, groupes d’appartenance… Participer
à la réalisation de citoyens libres et responsables contribue à construire une société fraternelle qui
incarne l’idéal républicain issu de la Révolution française.
Autrement dit, agir « dans » la société, au chevet des personnes fragiles, est indissociable d’agir « sur »
la société, c’est-à-dire de participer à la construction de la société, à sa transformation.
L’utilité sociale réside ici dans le dévoilement, par l’action, des situations d’injustice, des échecs de
l’intégration, des phénomènes d’exclusion, des relégations sociales qui marquent les espaces
sociétaux. La mise à jour, via le travail auprès des personnes singulières qu’accompagne le travail
social, des aléas qui écornent le triptyque « liberté, égalité, fraternité » est de la première utilité pour
une société qui peine toujours à réaliser ses utopies. L’utilité sociale du travail social consiste à prendre
position au cœur des rapports de force qui traversent la société.
2.3. Agir pour la société : un projet éminemment politique
Finalement, travailler le social dans et sur la société, induit la nécessité de porter un projet politique,
c’est-à-dire de formuler une conception du vivre ensemble, de la participation de chacun et de tous à
la vie de la cité. C’est là, me semble-t-il, la condition pour ne pas réduire le travail social à une simple
fonction d’instrument de rebouchage des fuites du projet de société. La visée de l’inclusion suppose
une conception de ce que doit être une société inclusive ; l’ambition de permettre à chacun de jouir
de tous ses droits suppose une conception de ce que doit être une société d’égalité ; la volonté de
permettre à tous de participer à la vie sociale suppose une conception des formes et des modalités de
la démocratie.
L’utilité sociale réside ici dans la capacité du travail social à énoncer politiquement un projet de société,
à recomposer l’action sociale, à « repolitiser » la question sociale. Pour cela, le travail social doit tenir
une fonction critique des fonctionnements de la société. Le travail social, « dans » et « sur » la société
est constitutivement une instance critique qui participe à la construction sociale, qui agit « pour » la
société.
3. Tenir un champ de tensions entre utilitarisme et visée transformatrice

5
Ces deux versants de l’utilité sociale – utilitariste et politique – sont exposés ici de manière clivée. Ils
constituent en fait les deux faces d’une même pièce. Ceci, parce qu’il est impossible de contribuer à la
résolution de problèmes sociaux individuels et collectifs sans se soucier des conditions socio-
économiques, donc politiques, de leur émergence. Ce que je vous propose maintenant, c’est de voir
comment gérer cette situation.
3.1. Refuser le clivage simplificateur et mortifère
Opposer l’utilité sociale versus logique comptable à l’utilité sociale versus action politique pourrait
être, me semble-t-il, une erreur stratégique mortifère. En effet, nous avons vu à quel point la logique
comptable, fondée sur un fantasme de rationalisation du vivant, est en train d’envahir tous les schémas
de pensée, depuis le vulgum-pecus jusqu’aux décideurs politiques. Il serait vain de vouloir simplement
l’ignorer, elle est omniprésente. Il s’agit donc de réfléchir à ce que nous pouvons en faire. Par ailleurs,
nous avons également vu la difficulté à repolitiser l’action sociale dans un contexte de dépolitisation
des débats de société. Il s’agit donc, ici, de réfléchir à la manière de réintroduire la délibération
démocratique au cœur des pratiques du travail social.
Autrement dit, l’utilité sociale limitée à son seul aspect de rentabilité économique est une impasse car
elle oublie la construction sociale. Inversement, l’utilité sociale réduite à sa seule dimension politique
est une erreur car elle omet la nécessité pour le travail social de développer une opérationnalité
tangible.
3.2. Construire l’alliance entre économique et politique
Il s’agit donc de travailler à une alliance de ces deux faces de la pièce. C’est par cette alliance que le
travail social pourra refonder de nouvelles légitimités. La première légitimité du travail social est de
résoudre effectivement les problèmes sociaux qu’il a à traiter au bénéfice d’individus ou de groupes.
Cette résolution suppose d’atteindre des objectifs, d’obtenir des résultats. Là, la logique comptable
peut nous être utile en démontrant la rentabilité de l’investissement, en rendant visible, lisible et
compréhensible ce qui est fait. Mais il serait suicidaire d’opérer cette démonstration en la situant
uniquement à un niveau monétaire. La démonstration économique doit, en même temps, développer
l’argument de l’utilité politique. Autrement dit, le dispositif de preuve de l’utilité sociale doit assortir
concomitamment des indicateurs économiques (coût, retour sur investissement, coûts évités,
« manque à dépenser »…) et des indicateurs de développement humain (qualité de la vie sociale, bien-
être, accès à la culture, enrichissement du capital social des habitants…). Il convient de refuser un
argumentaire qui ferait l’impasse sur l’un ou l’autre de ces deux aspects antagonistes mais
complémentaires, de ces deux faces opposées mais nécessaires l’une à l’autre.
3.3. Mettre en tension opérationnalité pragmatique et visée politique
En fait, je propose de tenir l’utilité sociale dans un champ de tensions qu’il ne faut pas réduire mais
entretenir comme la condition de l’équilibre énergétique du système d’action. Une image pour
comprendre : c’est un peu comme une bille de métal qui évoluerait dans un espace délimité par deux
aimants. Sa liberté de mouvement consiste à ne pas se laisser prendre par l’une ou l’autre des polarités
qui lui sont offertes mais de rester à juste distance de chacune d’elle pour préserver sa mobilité. C’est
cela se situer dans un champ de tension : savoir où sont nos exigences d’autonomie par rapport aux
dispositifs idéologiques qui encadrent les représentations sociétales, tenir compte des uns et des
 6
6
 7
7
1
/
7
100%