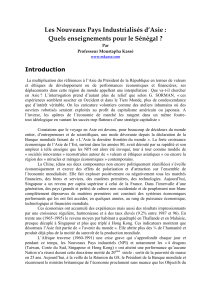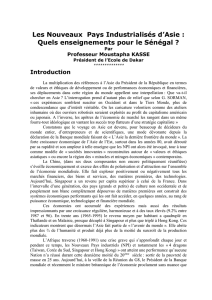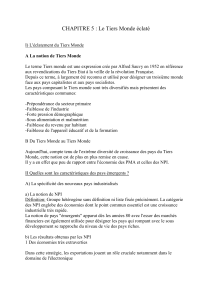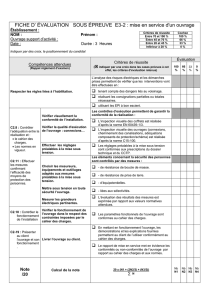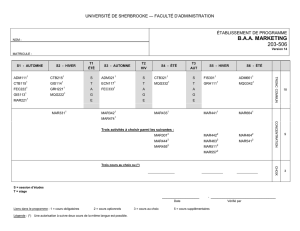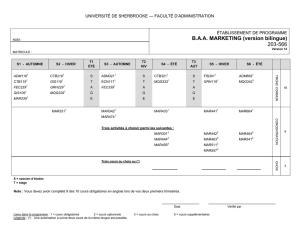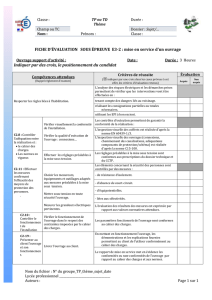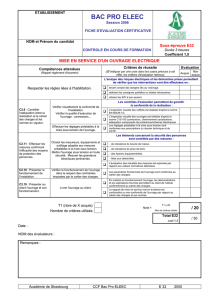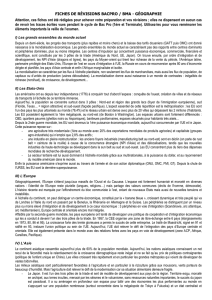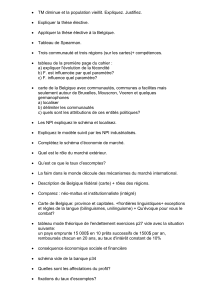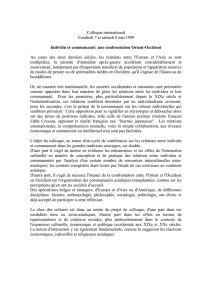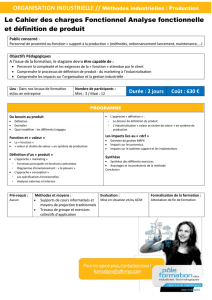Quels enseignements des NPI pour l`Afrique

Les Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie :
Quels enseignements pour le Sénégal ?
Par
Professeur Moustapha Kassé
Président de l’Ecole de Dakar
**************
Introduction
La multiplication des références à l’Asie du Président de la République en termes
de valeurs et éthiques de développement ou de performances économiques et financières,
ses déplacements dans cette région du monde appellent une interpellation : Que va-t-il
chercher en Asie ? L’interrogation prend d’autant plus de relief que selon G. SORMAN,
« ces expériences semblent susciter en Occident et dans le Tiers Monde, plus de
condescendance que d’intérêt véritable. On les caricature volontiers comme des ateliers
inhumains où des ouvriers robotisés seraient exploités au profit du capitalisme américain
ou japonais. A l’inverse, les apôtres de l’économie de marché les rangent dans un même
fourre-tout idéologique en vantant les succès trop flatteurs d’une stratégie capitaliste »
Constatons que le voyage en Asie est devenu, pour beaucoup de décideurs du
monde entier, d’entrepreneurs et de scientifiques, une mode dévorante depuis la
déclaration de la Banque mondiale faisant de « L’Asie la dernière frontière du monde ». La
forte croissance économique de l’Asie de l’Est, surtout dans les années 80, avait dérouté
par sa rapidité et son ampleur à telle enseigne que les NPI ont alors été invoqué, tour à tour
comme modèle de « sociétés innovantes » reconstruites autour de « valeurs et éthiques
asiatiques » ou encore la région des « miracles et mirages économiques » contemporains.
La Chine, (dans ses deux composantes non encore politiquement réunifiées)
s’éveille économiquement et exerce des effets de polarisation et d’attraction sur l’ensemble
de l’économie mondialisée. Elle fait exploser positivement ou négativement tous les
marchés financiers, des biens et services, des matières premières, des technologies.
Aujourd’hui, Singapour a un revenu per capita supérieur à celui de la France. Dans
l’intervalle d’une génération, des pays (grands et petits) de culture non occidentale et de
peuplement non blanc complètement dépourvus de matières premières ont construit des
systèmes économiques performants qui les ont fait accéder, en quelques années, au rang de
puissance économique, technologique et financière mondiale.
Ces économies ont accumulé des expériences mais aussi des résultats
impressionnants par une croissance régulière, harmonieuse et à des taux élevés (9.2% entre
1987 et 96). En trente ans (1965-1995) le revenu moyen par habitant a quadruplé en
Thaïlande et en Malaisie, presque décuplé à Singapour et plus que triplé à Hong Kong. Ces
indicateurs montrent que désormais l’Asie fait partie de « l’avenir du monde ». Elle abrite
plus des ¾ de l’humanité et produit déjà plus de la moitié du surcroît de la production
mondiale.
L’Afrique traverse (1960-1991) une crise grave qui s’approfondit chaque jour et
pendant ce temps, les Nouveaux Pays industriels (NPI) et notamment les « 4 dragons
(Taiwan, Corée du Sud, Singapour et Hong Kong) » ont atteint une performance qu’aucune
Nation n’a réussi durant cette deuxième moitié du 20ème siècle : sortir de la pauvreté de
masse en 25 ans. Aujourd’hui, à la veille de la Réunion du G8, le Président de la Banque
mondiale et récemment le ministre britannique de l’économie proclament sans nuance que

2
les Objectifs du Millénaire pour le Développement visant à réduire la pauvreté africaine de
moitié ne seront pas atteints.
Depuis les années 1990, les pays d’Asie qui étaient très pauvres au départ ont
quasiment rattrapé le niveau de vie des pays riches alors que l’Afrique continue toujours
d’être confrontée à la dégradation des fondamentaux de l’économie, au surendettement qui
n’a pas servi au financement de l’industrialisation, à la stagnation de la production, à
l'enfoncement dans la pauvreté. Sous-développement, misère et famine continuent d’y
peser comme une fatalité. Pour relancer les enjeux du développement africain, les
décideurs avaient privilégié, depuis les années 80, les politiques de stabilisation et
d’ajustement au détriment des politiques de développement à long terme. La comparaison
dans le domaine des politiques agricoles conduit à observer que les greniers sont vides en :
Afrique et pleins en Asie. Depuis les années 70, l’Afrique a progressivement remplacé
l’Asie et l’Amérique Latine dans le recours de l’assistance alimentaire internationale. En
prenant l’indicateur du revenu réel par habitant en Asie, mesuré en parité de pouvoir
d’achat (c’est-à-dire en tenant compte du niveau inférieur des prix pour un panier de bien
donné), il représentait en moyenne plus des 2/3 de celui des pays riches en 1996, contre
moins de 20% en 1965. En prenant le même indicateur, on observe qu’à l’inverse la
situation africaine se détériore. En effet, ce revenu moyen n’a point progressé, son niveau
représentait 7% de celui des pays développés en 1996 contre 13% trente ans plus tôt.
Tout au long de l’année 1997, ces pays ont été traversés par un véritable cyclone
monétaire et financier qui les a conduits à accueillir des Plans de Restructuration des
Institutions Financières Internationales (notamment du FMI) sur beaucoup de points
semblables aux Programmes d’Ajustement Structurels (PAS) que les économies africaines,
pour faire face à leurs échéances extérieures, ont appliqué trois décennies durant sans
résultats probants. Une foule de questions se posent et qui peuvent nous concerner dans la
recherche de voies pour un développement durable.
Comment ont-ils fait ? Que reste t-il, aujourd’hui du modèle asiatique après la
crise? Les « tigres asiatiques », comme l’on dit, peuvent-ils encore rugir ? Le miracle va-t-
il se transformer en mirage, comme en Côte d’Ivoire dans les années 70, avec les plans
d’austérité du FMI et la montée de la grogne sociale ?
I. Comment ont-ils fait pour sortir du sous-
développement.
Sans nul doute l’histoire, la géographie et la démographie expliquent pour une part
importante la trajectoire des NPI. Le Japon en offre une parfaite illustration. En effet, la
difficulté de l’existence des hommes explique l’impérieuse nécessité de trouver des
solutions ou de périr. Le pays possède beaucoup de montagnes : à peu prés de 80% de la
superficie totale est montagneuse, donc économiquement inutile. La population de plus de
120 millions d’hommes vit sur un espace restreint soit en termes de densité de population
sur la superficie utile, de l’ordre de plus de 1 500 par km2. Comparativement à la France
qui compte actuellement une population de 55 millions sur une superficie totale de 550
000km2. Mais étant donné le fait que la superficie française est économiquement utile,
donc la densité de population est 1/15 de la France. Comme l’observe Yoshimori, « Si on
transposait cette densité de population en France sur la surface utile au Japon, le Japon
compterait une population de seulement 7 millions au lieu de 116 millions ». Ensuite pour
échapper à une colonisation rampante et au défi occidental, les japonais ont opté de
concurrencer les Occidentaux sur leur propre terrain, c’est- à –dire en empruntant, en

3
assimilant systématiquement les technologies occidentales et leur savoir faire. Voilà pour
quoi les japonais se sont mis à se développer, à s’industrialiser et pourquoi ils ont réussi
sur le plan économique. Les autres pays asiatiques sont dans une situation pas trop
éloignée de celle du Japon.
Toutefois, au plan strictement technique et schématiquement, toute croissance
économique est le produit des politiques publiques qui doivent réaliser une combinaison
optimale des déterminants que sont le travail, le capital, la technologie et les ressources
naturelles. De l’Ecole classique anglaise (A. Smith, Ricardo) jusqu’aux théoriciens
contemporains de la croissance endogène (Romer, Lucas, Barro) en passant par les
keynésiens (Keynes, Harrod-Domar, Kalecki, Hicks) et les néo-classiques (Solow, Von
Mises et Hayek), ces différentes théories enseignent que la réalisation des taux de
croissance les plus élevés est fonction du dosage des différents déterminants et du niveau
de productivité des facteurs (compétitivité). De nos jours, les variables de cette équation se
modifient. Le capital et les technologies circulent plus librement et les différences vont se
jouer principalement sur les avantages comparatifs des coûts de main-d’œuvre et la qualité
des infrastructures. Cette opinion est quotidiennement rappelée par le Président Abdoulaye
Wade.
A ces déterminants s’ajoutent d’autres pour constituer les bases des modèles de
développement économique et social. Si les variables quantitatives et mêmes qualitatives
sont bien connues, ce qui l’est moins, c’est la compréhension de leurs enchaînements, de
leur mise en œuvre, dans les politiques économiques appropriées. Dans le cas de l’Asie, le
modèle de développement asiatique et ses performances se fondent sur quatre préalables :
philosophiques et culturels, économiques, institutionnels et sociaux.
1) Les préalables philosophiques et culturels
Ces préalables sont au nombre de deux : d’une part le mode d’organisation sociale
inspirée de CONFUCIUS où l’individu acquiert son identité par son appartenance à la
famille, d’autre part et par extension à la société entière le respect de la hiérarchie dans
l’activité productive de même que le développement de l’esprit de solidarité et de groupe.
A y regardes de prés, ces valeurs ne sont pas étrangères aux africains. Les tentatives de
théorisation sur le communautarisme caractéristique du fonctionnement des sociétés
africaines le montrent assez largement. Les années 60 ont vu la production de plusieurs
recherches sur ces thème :le « Consciencism » de K. NKrumah, le « communaucratisme »
de L. Senghor et le « communalisme » de J. Nyerere. Pourquoi ces décideurs de premier
plan n’ont-ils pas pu traduire leurs idées en actions concrètes au service du progrès
économique comme cela a été fait en Asie ? Pourquoi n’ont-ils pas réussi à traduire le
travail de la communauté, par la communauté, pour la communauté en actions qui
combineraient salariat et bénévolat pour effectuer des tâches de développement comme :
organiser le travail productif collectif, aider et former la jeunesse, assister les personnes
dépendantes, embellir les cités et les rues, organiser les fêtes, grâce à un tiers secteur qui se
développe déjà dans les milieux associatifs, coopératifs et alternatifs.
Le second aspect du préalable concerne les relations sociales ramenées à une
relation hiérarchique : liens sociaux verticaux de supérieur à inférieur, plutôt
qu’horizontaux entre égaux. Cette relation fonctionne en Afrique mais avec une
organisation sociale à tendance égalitariste qui se matérialise par la destruction
systématique de toute velléité de formation de surplus pour empêcher la formation de
différenciation sociale par enrichissement matériel. Cela explique la persistance de ces
formes contemporaines de liquidation des surplus par son utilisation improductive dans les
multiples cérémonies familiales (naissance, mariage et mort, autres manifestations sociales
d’obédience religieuses).

4
2) Les préalables économiques
Ces préalables se réduisent à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de
développement fondée sur des options macroéconomiques et macro financières qui ont
tourné autour de réformes agraires pertinentes faisant du secteur agricole le moteur du
développement et de politiques commerciales et fiscales favorisant les exportations et
amplifiant les incitations à l’investissement productif. La révolution verte avec ses
semences sélectionnées à haut rendement, l’utilisation optimale des deltas par irrigation et
l'emploi intense des facteurs modernes de production ont permis de haut niveau de
production et une croissance de la production alimentaire plus rapide que celle de la
population liquidant du coup les pénuries alimentaires. Une population mieux nourrie et
qui dispose de revenus plus Importants finit par se fixer dans les zones rurales. Cette
agriculture a relancé, en amont comme en aval, l’industrialisation, ce qui donne une
industrialisation amorcée à partir de l’agriculture pour s’étendre aux exportations.
La politique financière, commerciale et fiscale appropriée vient en complément des
politiques agricoles et industrielle. La politique commerciale est agressive et vise le
marché le mondial par une offre de biens diversifiés et aux meilleurs prix. Quant à la
politique fiscale, elle a multiplié les incitations pour rendre les plus attractifs et les produits
plus compétitifs.
3) Les préalables institutionnels
Les préalables institutionnels sont ceux qui permettent de réduire les coûts des
transactions et sont de trois ordres : la mise en place d’arrangements institutionnels
compatibles avec les objectifs fixés ; les investissements importants dans le capital
humain : éducation et santé et un bon Etat géré par un bon gouvernement comme le
préconisait déjà au 18ème siècle J. Struart Mill. Ces institutions sont accompagnées par des
règles et comportements éthiques compatibles avec les objectifs de développement. Ils
doivent être socialement bien acceptés et appliqués par les principaux acteurs de la vie
économique et sociale. Les règles appliquées dans la pratique sont au nombre de quatre :
s’appuyer sur ses propres forces, concentrer ses ressources là où on a un avantage
concurrentiel, choisir le domaine le plus étroit possible et avoir la détermination. Quant
aux acteurs, ils se subdivisent en trois catégories : les entrepreneurs qui sont des hommes
de talents exceptionnels caractérisés par leur souplesse et leur agilité ; les élites
intellectuelles et techniques issues des politiques de valorisation des ressources humaines
permettant d’élever le niveau de qualification de la main-d’œuvre et l’Etat qui est le
principal architecte du développement et des transformations.
L Etat est « pro » c’est-à-dire producteur, promoteur, programmeur et prospecteur
(P. Hugon). Michel Camdessus notait que « l’Etat a joué un rôle essentiel en Asie en
renonçant à faire ce qu’il fait le moins bien, se substituer à l’entreprise pour faire
davantage et mieux ce qu’il est seul à pouvoir faire : faire prévaloir le droit et réprimer les
abus, assurer les services sociaux ou collectifs que les signaux de la demande solvable sur
le marché ne suffisent pas à assurer ; offrir aux agents économiques des perspectives
universelles et de long terme et garantir la stabilité de la monnaie et du cadre macro
économique global sans laquelle on ne peut pas optimiser la croissance à long terme d
l’économie ».
Organisateur, il mobilise et oriente tous les investissements, prend en charge les
secteurs stratégiques de l’économie, des infrastructures de base aux industries lourdes et
l’éducation. L’industrialisation s’est déroulée à partir d’une étroite articulation entre l’Etat
chargé de la conduite de la politique économique et le secteur privé dynamique et engagé.
Les lourdes charges de régulation du système économique et social par l’Etat a permis à
certains auteurs de qualifier le modèle de développement asiatique de nouvelle variante du
capitalisme d’Etat pourtant très fortement décrié en Afrique par les Institutions

5
Financières Internationales de Bretton Woods et les tenants de la nouvelle orthodoxie néo-
libérale (L.von Mises, F. Hayek, P. Salin et P.Simmonot) qui préconisent de disqualifier
l’Etat et de l’exclure de toute responsabilité économique et sociale.
4) Les préalables sociaux
Les pays asiatiques ont mis en place un pacte social nouveau différent du taylorisme
pratiqué en Occident qui spire des traditions culturelles de travail, d’hiérarchie, de
discipline et d’obéissance. Le Président du Patronat japonais Kanusuka Matsushita
déclarait devant ses collègues industriels : « Dans la nouvelle compétition, nous allons
gagner et l’Occident va perdre… Vos organisations sont tayloriennes, mais le pire, c’est
que vos têtes le sont. Vous distinguer d’un côté ceux qui pensent et de l’autre ceux qui
exécutent…. Nous pensons que tous les membres de l’entreprise sont impliqués et nos
entreprises donnent trois fois plus de formation à tout leur personnel que ne le font vos
entreprises ? Réalistes nous pensons qu’il faut faire défendre l’entreprise par l’homme et
que celle-ci leur rendra au centuple ce qu’ils auront donné. Ce faisant nous finissons par
être plus sociaux ». Pour Paul Krugman du MIT, la clé du succès en Asie c’est le travail
parfois au-delà des normes sociales. En conséquence, selon lui, l’Asie « croit par
transpiration, mais pas par innovation ». La plupart des NPI sont devenus de véritables
« sweat shop » c'est-à-dire des ateliers de sueur.
Ces expériences positives de forte croissance qui ont de l’Asie un pôle émergent et
dynamique de l’économie mondiale vont être entraînées dans un cyclone monétaire et
financière en 1997 avec les banques qui ont fait faillite, des bourses qui s’effondrent. Tout
cela rappelle étrangement la crise de 1929. Peuvent-elles encore servir de référence pour
les pays africains auxquels la Communauté internationale demandent, dans le cadre des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), d’accélérer la croissance au taux
d’au moins 7% pour réduire la pauvreté seulement de moitié d’ici 2015.
II. Quels enseignements pour l’Afrique et le
Sénégal : quelques éléments de débat?
« Celui qui oublie l’expérience est condamné à la répéter » dit en substance un
proverbe africain. Au regard de la situation extrêmement morose du Continent, ses
intellectuels et son élite devraient se mettre à l’Ecole de l’Asie. S’il n’existe pas de recette
toute faite pour accéder au développement économique et social, il y a quelques points de
passage obligés que les NPI ont suivi et qui méritent d’être scrutés par tous ceux le
développement durable de l’Afrique intéresse. Dans notre analyse des stratégies comparée
de développement entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine, les éléments
caractéristiques de la stratégie stratégique peuvent se ramener en définitive à 5 éléments :
1) une géostratégie mondiale favorable qui s’est traduite par une aide financière
américaine massive pour contenir le communisme asiatique particulièrement actif et
conquérant (Chine, Corée du Nord, Viêt-Nam, Cambodge, Laos, etc.). Cependant
l’Afrique a bénéficié d’importantes ressources et continue encore d’obtenir la plus forte
part de l’Aide Publique au Développement puisqu’elle a reçu 26 % du total de la l’APD
fournie à l’ensemble des pays en développement. Les prêts hautement concessionnels ou
les dons représentaient environ 95% de cette aide (Finances et Développement juin 1997).
Deux décennies auparavant G. AMOA (19884) observait que l’Afrique a reçu des
ressources financières aussi importantes que celles du Plan Marshall mais elles ont été
mises au service de mauvaises options ce qui fait qu’elles n’ont
impulsé ni révolution agraire ni industrialisation. Aujourd’hui le Président Abdoulaye
Wade réouvre le dossier et récuse l’efficacité du « binôme aide–endettement ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%