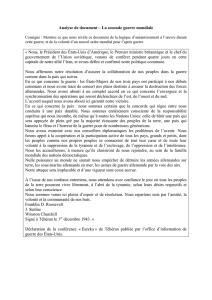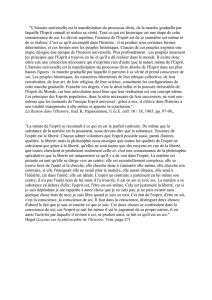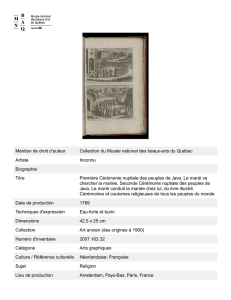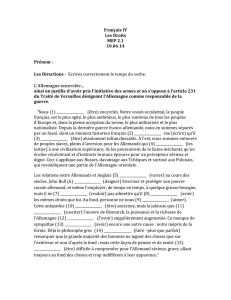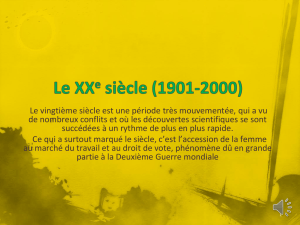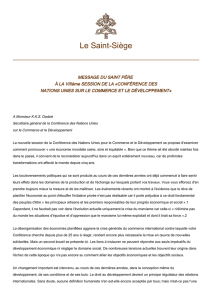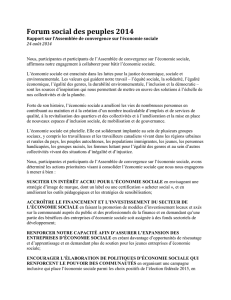Lettres - Bibliothèque russe et slave

Piotr Tchaadaïev
(Чаадаев Пётр Яковлевич)
1794 – 1856
LETTRES SUR LA PHILOSOPHIE DE
L’HISTOIRE
1829-1836
Œuvres choisies de Pierre Tchadaïef, publiées pour la première foi
par le P. Gagarin, de la compagnie de Jésus, Paris-Leipzig, Librairie
A. Franck, 1862.
LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —

2
TABLE
PRÉFACE DE L’ÉDITEUR. ............................................... 3
LETTRE PREMIÈRE. ......................................................... 8
LETTRE DEUXIÈME........................................................ 36
LETTRE TROISIÈME. ..................................................... 72
LETTRE QUATRIÈME. ................................................... 98

3
PRÉFACE DE L’ÉDITEUR.
Un concours heureux de circonstances a réuni dans
mes mains quelques-uns des écrits les plus importants de
Pierre Tchadaïef ; je n’ai pas cru qu’il me fût permis de
garder ce dépôt pour moi, et je me fais un devoir de le
communiquer au public, et surtout à mes compatriotes.
J’ai connu et j’ai aimé Tchadaïef. En 1833, à Munich,
le célèbre Schelling me parlait de lui comme de l’un des
hommes les plus remarquables qu’il eût rencontrés. Me
trouvant à Moscou en 1835, je m’empressai de me mettre
en rapport avec lui, et je n’eus pas de peine à me con-
vaincre que Schelling ne m’avait dit rien de trop. Je pris
l’habitude, toutes les fois que les circonstances me rame-
naient à Moscou, de voir fréquemment cet homme émi-
nent, et de causer longuement avec lui. Ces relations
exercèrent sur mon avenir une puissante influence, et
j’accomplis un devoir de reconnaissance en proclamant
hautement les obligations que je lui ai. Puisse la lecture
de ses écrits produire sur beaucoup d’esprits les mêmes
impressions que ses conversations ont produites sur le
mien !
Penseur original et profond, Tchadaïef se séparait
d’une manière bien tranchée des hommes et des idées au
milieu desquels il a vécu. Dans sa jeunesse, il s’est trouvé
en contact avec le mouvement libéral qui a abouti à la ca-
tastrophe sanglante du 14/26 décembre 1825. Il parta-
geait les tendances libérales des hommes qui ont pris part

4
à ce mouvement, il était d’accord avec eux sur l’existence
des maux trop réels dont souffrait et souffre encore la
Russie ; mais il se séparait d’eux lorsqu’il s’agissait d’en
préciser la cause, et surtout lorsqu’il s’agissait d’y appor-
ter un remède. Il ne croyait pas qu’il fallût chercher la ra-
cine du mal dans l’état politique du pays, et il repoussait
énergiquement la pensée de recourir à une révolution ou
à un changement violent de gouvernement. Il aurait dit
volontiers, avec le comte de Maistre, que les peuples ont
tous le gouvernement qu’ils méritent.
Le malheur de la Russie, suivant lui, était d’être de-
meurée pendant un si long espace de temps étrangère à la
vie intellectuelle et morale de l’Europe ; et la cause de cet
isolement, il la voyait dans le schisme, qui depuis des
siècles avait tenu la nation russe séparée des autres na-
tions civilisées. C’est l’Église catholique qui a élevé
l’Europe, c’est elle qui l’a formée, qui lui a donné cette
unité si facile à reconnaître, malgré les différences de na-
tionalités et de constitutions politiques, cet ensemble de
principes, de tendances que le protestantisme lui-même
n’est pas parvenu à détruire, qui fait que l’Europe est tou-
jours une, qu’elle vit d’une vie commune. La racine du
mal ainsi mise à nu, le remède était facile à trouver ; il
fallait rentrer dans le concert européen, non par une imi-
tation extérieure et superficielle des résultats de la civili-
sation, mais par un retour à cette unité, dont le Pape est
la personnification la plus haute et la plus sensible.
On comprend dès lors ce qui devait empêcher Tcha-
daïef d’adopter les idées des Slavophiles, dans la société
desquels il a vécu pendant ses dernières années.

5
En effet, les hommes qui ont été désignés en Russie
sous ce nom ne se bornent pas à répudier ce qu’il y a de
factice dans cette imitation de l’Europe, dans ces impor-
tations étrangères par lesquelles Pierre Ier croyait pouvoir
faire sortir son pays de son isolement séculaire et de la
barbarie qui en avait été la suite ; ils condamnent la civi-
lisation même de l’Europe, soutenant qu’elle a été radica-
lement faussée par la Papauté et par l’Église catholique,
et qu’il faut demander une autre civilisation plus parfaite
et plus pure aux germes latents mais féconds qui exis-
taient et qui existent encore, suivant eux, dans le sein de
l’Église orientale et de la nationalité slave. Hostiles au ca-
tholicisme, hostiles à l’Europe, à ses idées, à ses mœurs,
à ses institutions, ils attribuent tous les maux dont souffre
la Russie aux éléments étrangers qu’elle a imprudem-
ment absorbés, et ils font consister le salut de la patrie
dans le développement logique de la nationalité slave et
de l’Église orientale.
Cette manière de voir attaquait de front les idées aux-
quelles Tchadaïef tenait le plus. Il ne pouvait pas ad-
mettre que la civilisation ne fût pas une, qu’il y eût une
civilisation véritable en dehors de celle qui a jeté tant
d’éclat sur les peuples de l’Europe, et qui s’appuie sur le
christianisme. Il ne pouvait pas admettre que le christia-
nisme complet ne fût pas un, comme la vérité est une ;
que la société chrétienne ou l’Église ne fût pas une ; que
la hiérarchie divinement instituée pour gouverner l’Église
ne fût pas une et n’aboutît pas à l’unité.
Mais il est inutile d’exposer ici les idées de Tchadaïef ;
le lecteur aimera mieux les lire dans ses propres écrits.
Bornons-nous à donner quelques courtes explications né-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
1
/
104
100%