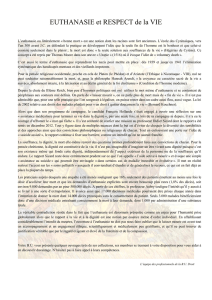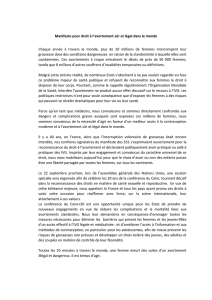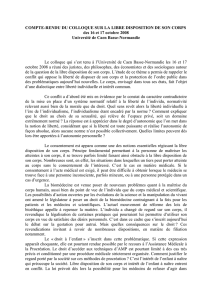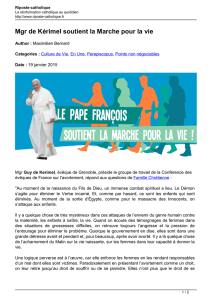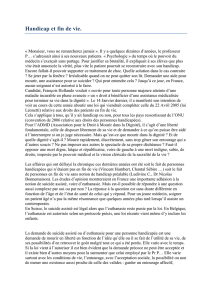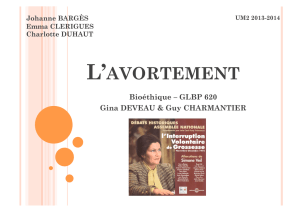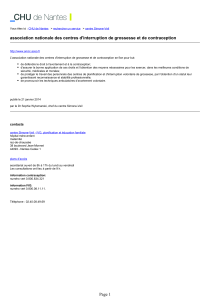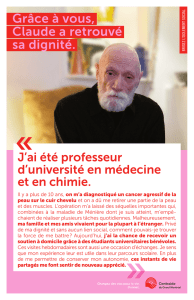DGEMC

DGEMC II) les sujets de droit
Chapitre 2) la vie, le corps, la santé
introduction :
point de départ : la distinction capitale des personnes et des choses. Cette distinction était
d’opérable pour rendre compte de situation extrême, à savoir avant la naissance, et après la mort
?
Avant la naissance : c’est le pb du statut de l’embryon ou du fœtus.
Problème : à quelle étape étant 1 embryon ? À quelle étape étant 1 fœtus ?
2 questions 1) la personnalité juridique était acquise ou non dès la conception ?
2) la protection de l’embryon en tant que futures personnes.
Code civil article 16 : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garanties de respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Conséquence : sont interdites : les recherches sur l’embryon humain in vitro.
Le législateur prévoit toutefois quelques dérogations : code de la santé publique article L2
115 – 5 :
• pertinence scientifique du projet
• susceptibilité de permettre des progrès médicaux majeurs
• impossibilité de parvenir au résultat escompté par les recherches de courant ne recourant
pas à des embryons humains.
• Respect des principes éthiques.
D’après la loi numéro 2011 – 814 du 7 juillet 2011 les recherches alternatives à celles sur
l’embryon humain est conforme à l’éthique doivent être favorisées.
Attention : cette protection n’équivaut pas à la protection juridique accordée à la personne.
L’avortement : il est permis en France, de façon très très réglementée, dont plusieurs
hypothèses.
Cassation assemblée plénière du 29 juin 2001 : la Cour de Cassation refuse d’appliquer les
règles pénales concernant l’homicide involontaire d’autrui à l’enfant à naître.
Après la mort :
principe : la mort entraîne la fin de la personnalité juridique.
Conséquence : personne décédée et héritier ne saurait donc se prévaloir du droit au respect du
corps humain.
Néanmoins : Code civil article 16 – 1 – 1 : le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la
mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celle dont le corps a donné
lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et d’essence.
Conséquence : 1 protection publique aux dépouilles mortelles : le caractère inviolable qui
n’exclut pas l’utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques est donc garanti.
Autre décision : Cour de Cassation 1e chambre civile, 16 septembre 2010, numéro 09 – 67.
456 : « en l’espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité,
décence, la cour d’appel à rechercher s’ils avaient 1 origine licite et, plus particulièrement, si les
personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs
cadavres ; en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé,
d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 – 1 – 1 du Code civil. »
1 principe essentiel convoqué ici : le principe de dignité humaine : ce principe est consacré

juridiquement tant au niveau national qu’international.
Exemple : déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
Article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en droits »
autre texte comprenant le principe de la dignité humaine : la convention contre la torture de
1984
les droits qu’elle consacre procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine.
Au niveau interne : contrairement à la plupart des constitutions la constitution française ne
consacre pas le principe de la dignité humaine. Cependant : 1994 le conseil constitutionnel
analyse les lois de bioéthique et fait du principe de la sauvegarde de la dignité humaine en
principe à valeur constitutionnelle.
Dès lors 3 problématiques se posent : le statut de l’avortement, celui de l’euthanasie, et celui
de la procréation médicalement assistée.
1) le droit à l’avortement : protection relative.
Définition de l’avortement : l’avortement se définit comme l’acte mettant fin à 1 grossesse.
On distingue 2 types d’avortement : 1 l’avortement volontaire et 2) l’avortement médical.
a) l’absence de reconnaissance d’un droit à l’avortement en droit européen :
l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales garantit le droit de la vie. Cependant il n’empêche pas la reconnaissance d’un
droit à l’avortement par les Etats. Cependant cet article de ne consacre pas le droit l’avortement.
Article 2 : – toute personne dispose du droit à la vie
• ce droit la vie est protégée par la loi –
. la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement.
Nuance : à l’origine il existait 1 exception pour les sentences capitales.
Cependant : les pays signataires la Convention européennes des droits de l’homme ont aboli la
peine de mort.
Problème posé à la CEDH: 1 État interdisant l’avortement méconnaît-il oui ou non le droit au
respect de la vie privée inscrit à l’article 8, d’où découle 1 droit à l’initiative personnelle ?
Décision de la cour européenne des droits de l’homme affaire ABC contre Irlande
16/12/2010 : « si le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée existe, il doit se
mesurer à l’aune d’autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de l’enfant à naître. »
Conséquence : l’interdiction étatique de l’avortement, restriction du droit au respect de la vie
privée de la femme enceinte, est conforme au sens de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme dans la mesure où elle remplit toutes les conditions prévues par le traité.
Quelles sont ces conditions ?
1) elle est prévue par la loi
2) elle poursuit 1 but légitime : conformité à la morale + droit à la vie
3) s’agissant du droit à la vie, l’État irlandais dispose d’un droit d’ingérence dans la vie privée
qui peut aller jusqu’à l’interdiction de l’avortement.
b) droit comparé : des législations étatiques diverses :
relativement la question de l’avortement distinguent 3 catégories d’État.
1 les états prohibitionnistes : l’avortement il est illégal sauf cas médical de danger pour la vie
de la femme. L’Irlande appartient à la catégorie des Etats prohibitionnistes.

En 1983 la constitution nationale irlandaise reconnaît 1 droit de l’enfant à naître.
Néanmoins il est possible de diffuser 1 information sur l’avortement sur le territoire irlandais
conformément à la liberté d’expression et il est également possible pour les femmes irlandaises
d’aller à l’étranger pour apporter.
2) les Etats intermédiaires. La Pologne appartient cette catégorie d’États. Le principe c’est
l’interdiction ainsi qu’un certain nombre de dérogations plus nombreuses : motif médical :
protection de la vie et de la santé de la femme + avortement volontaire dans le cas de grossesses
dues à des viols.
3) les Etats libéraux : ils reconnaissent avortement thérapeutique et l’avortement volontaire sans
condition de santé de la femme ou du fœtus. La seule condition est 1 condition de délai de
réalisation de l’acte d’avortement, qui peut varier d’un État à l’autre. En France le délai maximal
reconnu et de 12 semaines.
C) l’avortement droit interne :
Du point de vue du droit français : avant la loi du 27 mars 1923, l’avortement était défini
comme crime. À partir de cette date il devient 1 délit.
3e étape : 1975 : loi relative à l’IVG. L’interruption volontaire de grossesse est autorisée dans 1
délai de 10 semaines puis 12 semaines après 1 loi passée en 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception pour la femme s’estimant dans 1 état de détresse.
Quelles sont les conditions à remplir ?
L’état de détresse de la femme, apprécié par elle seule, à l’exclusion du père et du médecin.
Conditions temporelles.
En ce qui concerne l’interruption médicale de grossesse : l’avortement est destiné à sauver la
vie de la mère.
1 975 l’interruption médicale de grossesse est ouverte dès que la grossesse met gravement en
péril la santé de la femme et quand il y a 1 forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une
affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il peut
être pratiqué à tout moment de la grossesse.
Quelles sont les conditions de l’interruption médicale de grossesse ? Cette interruption
nécessite l’accord de 2 médecins qui doivent être spécialistes du diagnostic prénatal et appartenir
1 centre de diagnostic prénatal agréé. C’est la femme enceinte qui doit en faire la demande et
cette demande d’être accepté par 1 équipe médicale pluridisciplinaire.
Néanmoins : la loi prévoit ni clause de conscience à vocable par les médecins praticiens. Cela
leur permet de ne pas pratiquer 1 interruption de grossesse.
Cependant : ils doivent informer l’intéressé de leur refus et lui communiquer le nom de
praticiens susceptibles de réaliser 1 telle intervention.
Cela est précisé par l’article L2212 – 8 du code de la santé publique : « depuis la loi de
2001, dans 1 établissement de santé publique, 1 chef de service ne peut refuser, pour des raisons
de conscience, d’organiser dans son service de la pratique d’une interruption volontaire de
grossesse. Par contre il peut toujours refuser de pratiquer lui-même l’interruption volontaire de
grossesse. »
Le droit français entend donc limiter la protection du droit la vie au nom du droit des
femmes à disposer de leur corps.
2 ) le débat de l’euthanasie :

Lorsqu’on traite de l’euthanasie il y a 4 notions à distinguer.
Définition de l’euthanasie active : le médecin ou 1 proche du patient provoque le décès par 1
acte positif.
Exemple : injection d’une substance mortelle.
Euthanasie indirecte : administration par le médecin d’un médicament.
Nuance : le but recherché par le médecin lors de l’administration du médicament n’est pas la
mort du patient.
Définition de l’euthanasie passive, ou encore orthothanasie: quand le patient refuse
l’acharnement thérapeutique.
Exemple : débranchement des machines.
Définition du suicide assisté : le médecin montre aux patients, encore lucide et mobile, 1
méthode qui lui permettra de mettre fin à ses jours le plus sereinement possible.
• l’absence de reconnaissance de l’euthanasie en droit européen :
En 2000 de la cour peine de répondre à 1 question : l’interdiction de l’euthanasie par le
Royaume-Uni est-elle ou non contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ?
D’après l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme le droit à la vie est
consacré et reste à savoir s’il implique ou non le droit de mourir.
Réponse du juge européen : l’interdiction de l’euthanasie ne contrevient pas l’article 2 de la
cour européenne des droits de l’homme car consacrer le droit à la vie n’implique pas que l’on
reconnaisse le droit de mourir.
Autre argument du requérant : la prohibition de l’euthanasie constituerait 1 ingérence
irrégulière dans le droit à l’autonomie personnelle et à l’autodétermination.
Thèse : le droit au respect de la vie privée implique : 1 le droit l’autonomie personnelle
2 le droit à l’autodétermination
Analyse de la cour européenne des droits de l’homme : la prohibition de l’euthanasie
constitue certes 1 ingérence de l’État dans la vie privée.
Cependant : il s’agit d’une ingérence légitimée par le but poursuivi : la protection de la vie.
b) quelques éléments de droit comparé :
L’euthanasie légalisée de façon très encadrée aux Pays-Bas. Le patient doit être atteint d’une
maladie incurable ou d’une souffrance intolérable et doit avoir formulé la demande en toute
conscience. La Belgique légalise l’euthanasie en 2002 et le Luxembourg en 2009 dans des
conditions similaires à celles des Pays-Bas.
Dans d’autres pays l’euthanasie demeure interdite : ces pays constituent la majorité des états
européens.
Interdiction absolue : Pologne, Irlande
interdiction avec des dérogations : France : l’euthanasie passive est permise
C) l’euthanasie en droit interne :
Le Parlement français a voté la loi les années qui le 22 avril 2005 loi Léonie tire relative aux
droits des patients fins de vie.
La loi se prononce contre l’acharnement thérapeutique.
La loi instaure 1 droit au « laissé mourir »
code de la santé publique article L1110 – 5 : « les actes médicaux ne doivent pas être
poursuivis par 1 obstination déraisonnable. Lorsqu’ils paraissent inutiles, disproportionnée et

n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas
être entrepris. »
De plus cela autorise l’euthanasie passive : « lorsqu’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou
d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informé des conséquences
de son choix. »
Conditions d’application :
• 2 médecins doivent en convenir
• 2 après concertation avec les proches du malade.
Cependant : ce que privilégie le droit français : les soins palliatifs
article L1110 – 11 du code de la santé publique : détermination du rôle des bénévoles dans
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
But des soins palliatifs :
• réduction des symptômes
• confort du malade.
3) la procréation médicalisée :
Définition de l’assistance médicale à la procréation : toutes techniques autorisées permettant
la procréation en dehors du processus naturel. Cela concerne 2,4 % des naissances parents en
France.
Encadrement du rock du recours à l’assistance médicale à la procréation en droit français :
but : le recours doit poursuivre 1 finalité médicale.
2 hypothèses :
1 ) l’utilité contre l’infertilité médicalement constatée du couple.
2) éviter la transmission à l’enfant à naître ou 1 membre du couple 1 maladie d’une maladie
grave.
Article L2141 – 2 alinéas premiers du code de la santé publique.
Quant aux bénéficiaires de l’assistance médicale à la procréation : il peut s’agir 1 couple
hétérosexuel il ne peut s’agir que d’un couple hétérosexuel qui doit être en âge de procréer.
Attention : si la vie de couple a cessé, l’assistance médicale à la procréation, quel que soit
l’étape du processus de pas être poursuivi.
4) le corps :
C’est le principe du respect de la dignité humaine qui font la protection juridique du corps.
Le principe de l’inviolabilité du corps humain est garanti par l’article 16 – 1 alinéa 2 du Code
civil : « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain,
ces éléments et ces produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Conséquence : on ne peut pas porter atteint à l’intégrité corporelle d’une personne.
Nuance : la loi ne met des atteintes licites, celles qui sont fondées sur la nécessité médicale ou
l’intérêt thérapeutique d’autrui.
A) en matière médicale : la condition du consentement :
principe : l’atteinte à l’intégrité physique exige le consentement de l’individu touché dans son
corps.
Ce principe est formulé dans les lois de bioéthique est repris dans l’article 16 – 3 du Code civil :
« il ne peut être porté atteint à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour
la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire 1 intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%