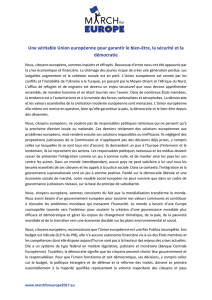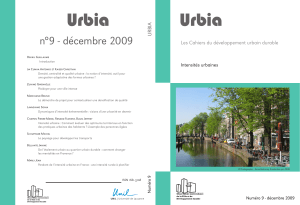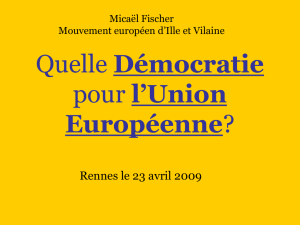Congrès AFSP - Grenoble - 9 septembre 2009

1
Congrès AFSP - Grenoble - 9 septembre 2009
La démocratie locale en débats
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article1255
Axe 2
(Laboratoire PACTE, UMR 5194)
Version intermédiaire
La démocratie urbaine en question: zones d’ombre et apports potentiels à l’étude du gouvernement
des villes
Introduction
La plupart des pays européens développent actuellement des dispositifs de démocratie locale avec
le but affiché de favoriser la participation des populations à la gestion de la ville (Blondiaux, 1999;
Bacqué & Sintomer, 2001; Loughlin, Aja et al., 2001; Kersting & Vetter, 2003). Ce tournant intervient à
la suite du double changement structurel que constituent les politiques de décentralisation menées dans la
majorité des États européens et l’émergence d’une action publique négociée au sein de réseaux d’acteurs
plus ou moins formalisés (Stoker, 1998; Gaudin, 2002; Delcamp & Loughlin, 2003). Dans cette nouvelle
configuration où coopèrent les instances publiques locales dotées d’une autonomie relative inédite et des
acteurs privés, un acteur de taille demeure cependant absent. Il s’agit du citoyen-habitant qui se trouve
souvent exclu par une nouvelle organisation de l’action publique basée essentiellement sur la médiation et
coordination de divers intérêts politiques, territoriaux, économiques et corporatistes au sein de réseaux
qui échappent en grande partie à la responsabilité politique. Ainsi la logique participative et la
coopération qui sont à la base du changement de régime de l’action publique qui se présente désormais
comme partenariale, négociée et inclusive se limitent-elles à la recherche de solutions négociées dans le
cadre de réseaux d’action publique.
Cette nouvelle économie politique de l’action publique bouscule significativement l’équilibre
entre « efficacité » et « responsabilité politique » qui est traditionnellement attaché au fonctionnement des
institutions démocratiques. Les nouvelles capacités d’action publique semblent en effet échapper de plus
en plus au contrôle démocratique au point que nombres de chercheurs ont souligné le déficit
démocratique des réseaux qui en sont à l’origine (Benz, 2001; Papadopoulos, 2003; Heinelt & Kübler,
2005; Kübler, 2005; Papadopoulos, 2007). Dans cette ère participative et partenariale de l’action
publique, l’intégration de la population dans des dispositifs de concertation s’est rapidement imposée
comme la solution permettant à la fois de ne pas remettre en question la tendance d’une action publique
co-construite tout en cherchant à compenser le déficit démocratique des décisions et solutions retenues
par les réseaux d’action publique. Suivant les cultures politiques nationales et locales, cette idée a donné
lieu à des déclinaisons diverses qui vont de la mise en place d’instances consultatives à des tentatives
d’empowerment consistant à attribuer à des communautés un pouvoir relatif de gestion et d’action dans
un domaine et sur une zone géographique donnés. Cependant, un premier bilan de l’expérience de ces
dispositifs participatifs en France et à l’étranger montre clairement que la pratique reste très en dessous de
l’objectif de départ, à savoir donner voix au chapitre aux habitants avec la possibilité d’infléchir
éventuellement la décision. Plusieurs ambiguïtés (sur les objectifs d’un projet ou de la concertation en
général) et nombre d’enjeux et de jeux de pouvoir non avoués viennent en effet restreindre sévèrement la
portée et l’impact de ces dispositifs participatifs (Blondiaux, 1999; Mohan & Stokke, 2000; Bacqué &
Sintomer, 2001; Blondiaux, 2001; Lowndes, Pratchett et al., 2001; Goldfrank, 2002; Blanc & Beaumont,
2005; Revel, Blatrix et al., 2007).
La plupart de ces expériences se caractérisent par des difficultés de mise en œuvre qui découlent
de l’institutionnalisation problématique de la démocratie locale avec le constat récurrent que les

2
instruments et dispositifs mis en place produisent rarement les résultats et les effets escomptés. Ainsi,
l’analyse des formes de démocratie locale s’est-elle faite principalement à travers l’examen de ces
dispositifs/instruments qui en symbolisent le développement volontariste ou imposé. Nous touchons ici
une dimension essentielle de la démocratie locale en tant qu’objet scientifique puisqu’en effet, et à la
faveur d’innovations prévues par les différentes lois qui se sont succédées en France et à l’étranger, il
existe une tendance à prendre l’étude de la mise en place des dispositifs de concertation et de démocratie
de proximité comme une base empirique privilégiée de l’étude de la démocratie locale. Or, la plupart des
travaux insistent sur des réalisations et des mises en œuvre plus ou moins conformes à l’esprit et aux
objectifs des lois, quand il ne s’agit pas tout simplement de confiscation de la dynamique démocratique
par des acteurs aux ressources et capacités d’action spécifiques, le plus souvent en raison d’enjeux et de
jeux de pouvoir qui émergent avec l’application des textes (Wilson, 2000; Blondiaux, 2001; Lowndes,
Pratchett et al., 2001; Blondiaux, 2007).
De ce premier bilan, il ressort que le fait démocratique urbain (défini comme confrontation des
intérêts, des identités, des pratiques sociales et des usages liés à l’espace urbain, à l’occasion notamment
d’un processus de décision publique) ne se réduit pas aux tentatives de son institutionnalisation avec les
nouveaux dispositifs prévus par les innovations législatives. Dit autrement, le fait démocratique ne se
limite pas à la forme et à l’organisation que prennent les outils institutionnels mis en place dans le cadre
de politiques publiques qui visent à renforcer la participation et la démocratie locale. Dans cette
contribution, et dans le cadre d’une réflexion méthodologique, nous souhaitons montrer comment le fait
démocratique peut être construit comme objet scientifique et être mobilisé comme grille de
questionnement pour approfondir notre connaissance du gouvernement des villes. Notre propos
s’organise en deux temps. Dans une première partie nous revenons sur les limites et les difficultés liées à
la façon de concevoir la démocratie locale et la participation dans l’étude du gouvernement urbain. Cette
revue critique nous amènera à dégager quelques zones d’ombre liées à l’articulation problématique entre,
d’une part, les dispositifs et dynamiques de gouvernance urbaine et, d’autre part, la question
démocratique. Dans un second temps, et en montrant comment le fait démocratique en tant que
dynamiques sociales liées à l’espace urbain peut être construit comme objet scientifique et être mobilisé
comme grille de questionnement du gouvernement urbain, nous présentons l’apport potentiel de la
démocratie urbaine pour renouveler et enrichir notre connaissance des pratiques et des méthodes du
gouvernement urbain.
I. L’institutionnalisation de la démocratie locale : le seul terrain d’étude de la démocratie
locale ?
Si historiquement la démocratie est apparue dans les cités grecques et est donc intimement liée dès
son origine à la ville et à l’espace urbain, sa pratique a toujours oscillé depuis entre la mise en place de
protocoles et de rites destinés à formaliser l’expression des demandes de la population et l’expression
spontanée plus ou moins pacifique de revendications. En tant qu’outil de gouvernement, la démocratie
répond donc à une double logique qui est celle, d’une part, des impératifs moraux ou politiques sur
lesquels une société établit les principes et les formes de sa régulation et, d’autre part, la réalité des
pratiques qui sont plus ou moins fidèles à l’esprit de ces impératifs. La construction des États nations, et
avec elle l’instauration d’un système politique central, semble avoir éloigné un moment le centre de
gravité de la pratique démocratique de son environnement traditionnel qu’est la ville - et cela à la suite de
l’influence grandissante du système politique central comme lieu et instrument de médiation et régulation
de la conflictualité sociale et politique, et en raison de l’importance prise par la logique représentative sur
la logique participative dans le jeu démocratique. Après la consolidation des institutions démocratiques
nationales et les réformes de décentralisation, la question de la démocratie locale est revenue au premier
plan de l’agenda politique de la plupart des pays occidentaux avec le souci de développer un système de
participation de la population dans le cadre d’une relative autonomie locale.
Avec ce « retour » à la démocratie locale, essentiellement urbaine, se repose la question de
l’articulation entre les impératifs politiques moraux et la réalité des conditions et contraintes de mise en
œuvre d’une démocratie participative, comme en témoignent à la fois les travaux autour de la délibération
comme théorie politique et philosophique de la démocratie et plus récemment les recherches consacrées
à la démocratie participative. De nos jours, l’étude de la démocratie locale privilégie l’examen des

3
nouveaux dispositifs de participation et de concertation (Berry, Portney et al., 1993; Purcell, 2006; Revel,
Blatrix et al., 2007), mais elle passe également par la revendication d’un « droit à la ville » sous la forme
d’un programme de recherche mû par une démarche de « recherche-action » sur les institutions à créer
pour assurer un gouvernement de la ville qui soit à la fois plus démocratique (pour intégrer réellement les
habitants dans les processus de décision) et plus juste socialement. Cette notion de « droit à la ville »,
développée par H. Lefebvre (1972) et fréquemment travestie par les acteurs qui s’en réclameront par la
suite, repose sur l’idée que l’espace de la ville ne doit pas être considéré seulement du point de vue de sa
valeur d’échange (en tant que bien marchand) mais également du point de sa valeur d’usage, justifiant
ainsi la participation ou la consultation de ceux qui habitent la ville et la pratiquent sans en être les
propriétaires fonciers (Lefebvre, 2000; Purcell, 2002). Au-delà de sa double spécificité en tant qu’objet de
réflexion de la philosophie politique et objet de pratiques sociales, la notion de démocratie locale reste
encore imprécise et vague (Blondiaux, 2007), ce qui explique les ambiguïtés au gré des compréhensions
et des usages qu’en font les acteurs. Cette caractéristique de la démocratie locale amène à s’interroger sur
sa construction en tant qu’objet scientifique, et cela dans la perspective d’une meilleure compréhension
des pratiques, des dynamiques et des dispositifs du gouvernement urbain dans un contexte où la décision
publique est plus que jamais soumise à la variété des légitimités, des expertises et des voies de
contestation. Pour cela nous allons présenter les principaux enjeux analytiques et méthodologiques
attachés à la démocratie urbaine pour mieux souligner les limites et les zones d’ombre liées à son étude
actuelle, en précisant notamment l’absence d’articulation théorique entre les recherches sur les dispositifs
de gouvernance urbaine et la question démocratique.
Construire la démocratie urbaine en tant qu’objet scientifique : l’intérêt et les difficultés
L’intérêt de construire la démocratie urbaine en tant qu’objet scientifique se justifie
principalement par les évolutions de l’action publique et du gouvernement urbain. Ainsi la célèbre
question de R. Dahl (1989), « Qui gouverne ? », trouve-t-elle une nouvelle résonance et actualité dans un
système où la décision publique répond de plus en plus à une logique de négociation et de co-construction
entre des acteurs aux horizons et aux intérêts divers (Kooiman, 1993; Stoker, 1998; John, 2001; Gaudin,
2002; Rhodes, 2007). Traditionnellement le lieu de la variété des intérêts, des usages de l’espace, des
identités et des pratiques sociales, la ville est le résultat des rapports sociaux et de pratiques sociales qui
s’inscrivent dans des espaces ou des échelles spatiales donnés. À ce titre, la variété des échelles spatiales
correspondant à ces pratiques sociales ou intérêts hétérogènes fait que la ville peut être saisie comme le
lieu de la coexistence, voire de la confrontation, de diverses définitions, visions et intérêts liés à l’espace
urbain (Delaney & Leitner, 1997; Marston, 2000; Purcell, 2003). Dans ce contexte, la construction de la
démocratie urbaine en tant qu’objet scientifique s’impose à la fois en raison du tournant participatif dans
la gestion des affaires publiques locales adopté officiellement par la plupart des autorités locales dans les
pays occidentaux, mais aussi en raison des mobilisations et des contestations au sein de la société locale.
Plusieurs travers contrarient néanmoins la construction de la démocratie urbaine comme objet
scientifique. Le premier correspond à ce que l’on pourrait appeler le fétichisme du local qui consiste à
penser que l’échelon local est toujours préférable à d'autres échelles territoriales car garant de vraie
démocratie et de justice sociale. Mark Purcell (2006) a ainsi parlé de piège du local (local trap) pour
souligner la conception normative habituellement associée à cette échelle territoriale dont on pense un
peu rapidement qu’elle aurait la vertu de favoriser la démocratie et la justice sociale. Cette croyance en la
vertu du local repose sur l’idée que le rapprochement de la décision du citoyen conduit nécessairement à
des choix plus démocratiques et à des mesures plus efficaces et plus justes. Or, certaines réformes allant
dans ce sens se soldent parfois par une réduction significative du profil et du nombre d’acteurs ayant une
réelle influence sur les choix faits (Purcell, 2006). Le local et la démocratie locale doivent donc avant tout
être envisagés sous l’angle des configurations d’acteurs, des pratiques et des usages qui en sont faits.
Cette posture de recherche devient nécessaire avec la multiplication des réformes qui reposent sur l’idée
que la mise en place de nouveaux mécanismes participatifs favoriserait l’apprentissage et
l’institutionnalisation de la démocratie locale ; un peu comme si l’existence du dispositif de participation
suffisait à produire de la démocratie locale.
Mais là n’est pas la seule difficulté posée par le fétichisme du local et par la représentation
idéalisée de la démocratie. En effet, reposant sur l’image idyllique de la communauté d’individus

4
décidant par eux-mêmes et pour eux-mêmes, la « démocratie locale » est captive d’une double logique de
compréhension. Elle est à la fois saisie sous le mode d’un objet de réflexion de la philosophie politique
avec à la clé un certain nombre de recommandations d’organisation et de fonctionnement et, par ailleurs,
comme un ensemble de représentations communes du processus délibératif tirées de l’expérience
personnelle. Cette double dimension cognitive pour saisir intellectuellement la démocratie (locale)
perturbe notre examen de la démocratie en actes puisque nous évaluons les dynamiques de délibération
en fonction d’un modèle alimenté à la fois par cette réflexion philosophique et par notre propre
représentation d’une délibération rationnelle et équitable. En oubliant vite qu’il s’agit avant tout d’un
idéal d’organisation politique (y compris au sein des cités grecques), et cherchant à retrouver la
manifestation de cet idéal dans les expériences observées, le risque est donc fort de ne constater que des
insuffisances des dispositifs participatifs, voire d’éventuelles instrumentations. Il est d’autant plus
difficile d’éviter complètement les effets de cet idéal qu’il est lui-même à la base des projets de réformes
visant à instaurer ou à renforcer la démocratie locale et qu’il est également à l’origine des revendications
et contestations spontanées au sein de la population. Bref, l’idéal démocratique, et plus précisément ce
qu’en comprennent et pensent les acteurs, détermine en partie les dispositions à agir et les motivations des
individus concernés. Par conséquent, il n’est jamais aisé, en matière de démocratie locale, de séparer
totalement le registre des faits de celui des conceptions normatives.
Une deuxième difficulté à construire la démocratie urbaine comme objet scientifique s’explique
par la tendance à examiner la gestion des affaires publiques locales à travers la focale privilégiée de
l’analyse des politiques publiques. Découlant des transformations de l’action publique qui répond de plus
en plus à un processus de négociation et de co-construction, cette façon de faire s’accompagne le plus
souvent d’un angle de recherche privilégié (l’articulation des intérêts en présence), de sources empiriques
(le contenu et les modalités de mise en œuvre de la politique publique proprement dite) ainsi que de
certains ressorts d’interprétation (les dispositifs institutionnels comme ressources ou contraintes pour les
acteurs en présence). L’importance prise ces dernières années par l’analyse des politiques publiques dans
la discipline s’explique notamment par l’émergence des pouvoirs locaux à la suite des processus de
décentralisation, processus pour lequel elle a été un instrument pratique et efficace pour mettre en lumière
les phénomènes d’institutionnalisation et d’échange politique qui sont à la base de la consolidation de ces
nouveaux échelons de pouvoir et de la reconfiguration de l’ordre politique local. Par la suite, le principe
d’une action publique négociée et concertée, en raison de la remise en cause plus fréquente de l’action
publique par les destinataires ou les exécutants, a rendu plus systématique l’utilisation de cette grille
d’analyse pour examiner la décision publique en général selon une problématique de la
négociation/transaction entre acteurs. Les expériences de démocratie locale n’échappent pas non plus à
cette approche puisqu’il s’agit la plupart du temps d’examiner la mise en œuvre de plans et de dispositifs
de participation définis par la loi et/ou négociés entre acteurs locaux. Toutefois, au regard de cette
thématique de la démocratie locale, cette façon d’opérer, très en vogue, présente quelques inconvénients
non négligeables.
En effet, le premier et non des moindres est que le dispositif créé par la loi impose de facto avec sa
mise en œuvre une certaine sélection des dynamiques et des pratiques de la démocratie locale, en
poussant le chercheur à se focaliser principalement sur ce que montrent les dispositifs de leur organisation
et de leur fonctionnement et à négliger quelque peu des pratiques et dynamiques alternatives qui n’auront
pas été acceptées au sein de ces dispositifs. À ne considérer la démocratie urbaine que par l’entremise des
dispositifs et procédures de participation prévus par la loi, le risque est grand de croire que le fait
démocratique peut être saisi essentiellement avec ces structures de concertation. Le deuxième
inconvénient a trait à la dynamique de participation/concertation proprement dite par le biais d’instances
autour desquelles gravitent un certain nombre de réseaux d’acteurs. En matière de participation, et si l’on
considère la définition formelle de ce terme qui sert à justifier la mise en place des dispositifs, le décalage
entre l’esprit et la pratique est régulièrement souligné par les recherches dans ce domaine. Un certain
nombre de caractéristiques propres aux formules actuelles de concertation et de participation (où les
réseaux jouent un rôle significatif) viennent en effet contraindre la dynamique délibérative. Tout d’abord,
remarquons que les réseaux d’acteurs qui accompagnent la mise en place de ces instances de
participation/concertation ne sont pas toujours représentatifs de la population ou de la variété des intérêts
concernés. À cela, il faut avancer l’explication que la participation comporte une série de filtres qui

5
découlent de sa mise en œuvre : la nécessité de la mise en forme de la parole ou des demandes de la
population et des différents intérêts concernés par l’intermédiaire de personnes désignées comme
représentants ou autoproclamées comme telles en raison de leurs compétences techniques ou de leur
connaissance d’un espace donné de la ville ; la nécessité d’établir une série de diagnostics sur l’état de
tout ou partie de la ville pour lesquels des experts sont sollicités et pour lesquels les mêmes experts ou
d’autres seront appelés à en produire une version acceptable pour toutes les parties en présence au sein
des structures de concertation – cette expertise va même de nos jours jusqu’à l’apparition de
professionnels de la concertation qui prétendent aider à la mise en place de celle-ci selon des protocoles
ou des tours de main donnés (Nonjon, 2005). Enfin, l’inégalité entre les participants en termes de
ressources d’action est souvent évoquée comme un obstacle significatif dans la mise en œuvre d’une
concertation pluraliste car elle se traduit par une inégalité dans la capacité à influencer ou à infléchir le
produit de la concertation. Si la focale sur les instruments et plus largement l’analyse des politiques
publiques ont apporté une contribution significative à la compréhension de l’évolution du gouvernement
local, et ont permis une meilleure connaissance des nouvelles configurations d’acteurs qui sous-tendent ce
dernier autour d’un régime de négociation et de transaction, souvenons-nous néanmoins que toutes les
dimensions ou facettes du pouvoir local ne peuvent être uniquement examinées par ce biais comme le
montre le cas de la démocratie locale pour lequel les jeux de pouvoir et les jeux d’acteurs ne peuvent être
entièrement saisis à travers les dispositifs mis en place.
Une dernière difficulté dans la construction de la démocratie urbaine comme objet scientifique
concerne la notion même de démocratie et la façon de l’opérationnaliser en tant qu’objet de recherche à
partir d’un parti pris théorique. Entre l’évaluation des pratiques délibératives selon un modèle théorique
issu de la philosophie politique et la mise au jour d’instrumentations, de détournements ou de
manipulations, l’approche de la démocratie urbaine se trouve prisonnière des contradictions de sa double
dimension (normative et descriptive) dans la façon même de questionner les faits et de les interpréter.
Cette difficulté est bien mise en lumière par les interrogations de L. Blondiaux et Y. Sintomer (2002) sur
le statut de la démocratie participative comme phénomène politique et le cadre interprétatif qui peut lui
être appliqué pour approfondir notre connaissance des pratiques de démocratie participative et déterminer
leur impact sur le processus du gouvernement local. De leur coté, dans leur projet d’articuler une théorie
normative de la démocratie avec les recherches empiriques sur la formulation et la mise en œuvre de
l’action publique, Y. Papadopoulos et P. Warin (2007) construisent la démocratie participative comme
objet scientifique non pas pour soi mais bien plus comme un instrument de connaissance des pratiques et
des dynamiques du gouvernement local. Dans les deux cas, l’enjeu théorique et méthodologique est de
dépasser les constats récurrents d’échecs plus ou moins prononcés ou encore la mise au jour de
détournement et de manipulation des dispositifs participatifs. En invitant à prendre au sérieux
« l’impératif délibératif », L. Blondiaux et Y. Sintomer (2002) cherchent ainsi à surmonter l’impasse
théorique et méthodologique habituellement associée à l’approche duale (normative et descriptive) de la
démocratie locale en examinant plus particulièrement l’effet des dynamiques de justification sur les jeux
d’acteurs. Pour notre part, et comme nous le préciserons dans la section suivante, le parti pris théorique
que nous retiendrons dans cette contribution est de penser la démocratie locale, au-delà de ses formes
institutionnalisées, comme un processus de confrontation des identités, des intérêts et des pratiques
sociales alimenté par des usages sociaux concurrents de l’espace urbain qui détermine le registre des
modalités et des réalisations du gouvernement urbain. En effet, nous pensons que c’est dans la pratique et
le vécu de l’espace urbain à différentes échelles et selon différentes rationalités ou intérêts que se
construisent les dispositions à agir et les motivations des acteurs au regard des décisions et des projets
urbains. Approfondir notre connaissance du fait démocratique suppose donc de développer davantage les
analyses du coté des modes de vie, des pratiques sociales liées à l’espace urbain et des formes
d’appropriation des différentes échelles spatiales de la ville pour cerner leurs effets sur les formes
d’engagement dans le débat local ou d’interpellation des autorités qui ne se limite pas seulement aux
figures institutionnalisées de la démocratie participative et aux exigences de la justification.
Ces problèmes et travers de l’analyse de la démocratie locale sont à l’origine d’un certain nombre
de limites du point de vue de la perspective d’étude qui expliquent notamment la récurrence de certains
résultats et conclusions. En effet, la plupart des travaux insistent sur les effets de sélection de ces
dispositifs participatifs qui nécessitent en fait des compétences, des dispositions et du temps pour les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%