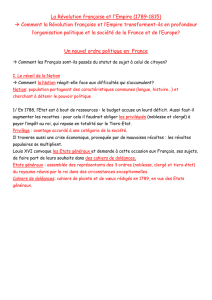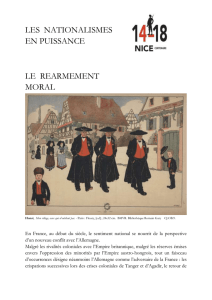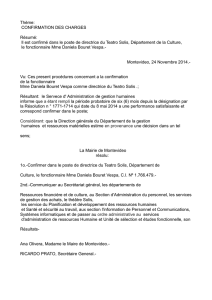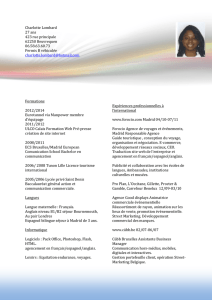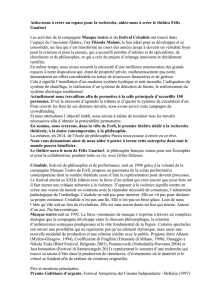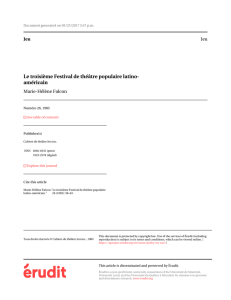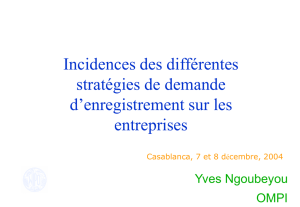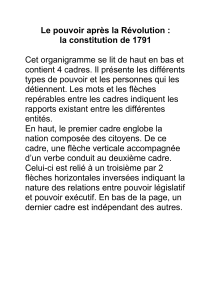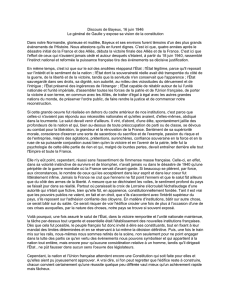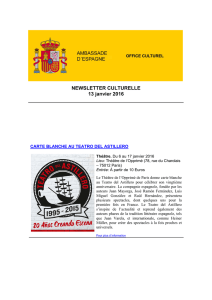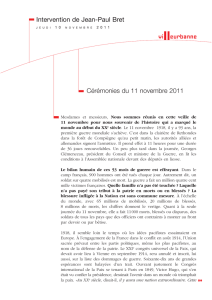La construction de la nation au XIXe siècle dans le théâtre patriotique:

1
La construction de la nation au XIXe siècle dans le théâtre patriotique :
les invariants d’un processus de définition identitaire
Marie SALGUES
Université Paris 8 - Vincennes-St Denis
CREC (Paris 3, EA 2292)
À l'origine de cette communication se trouve une interrogation qui a surgi très tôt dans
mes recherches sur le théâtre patriotique, une interrogation qui est née du sentiment de
l'existence d'un petit grain de sable dans l'engrenage, comme une aspérité dont j'avais préféré
faire abstraction. En effet, je me rappelle ma stupeur la première fois que je rencontrai, dans
ce corpus patriotique, un type de récupération bien particulier : au moment d'écrire une pièce
pour exalter le sentiment patriotique de ses compatriotes, le dramaturge, ressortissant d'une
nation A, choisit de reprendre – en l'imitant, en la plagiant, en la traduisant... – une pièce déjà
existante, mais qui est l'œuvre d'un auteur appartenant à une autre nation, parfois même à la
nation contre laquelle une guerre est en cours
1
. Tout cela avec très peu de changements,
uniquement les noms de lieux et les dates dans certains cas. Alors que ce type de théâtre se
propose de défendre une cause nationale, d'aider à forger un sentiment d'appartenance
tellement évident que le public pourrait prendre les armes dans la foulée de la représentation,
il s'avérerait finalement que peu importe le flacon national, pourvu qu'on ait l'ivresse
patriotique. Qu'une telle pièce parvienne à fonctionner dans plusieurs pays sous-entend, dès
lors, que rien, dans le message, ne définit la nation elle-même quand, pourtant, le fait d'en être
l'un des membres est censé justifier tous les sacrifices. Bien sûr, la majorité des pièces
patriotiques ne sont pas reprises ainsi, la plupart sont trop marquées pour être recopiées telles
quelles, mais le seul fait que cela puisse se produire constitue un écueil qui mérite, je pense,
que l'on s'y arrête. Puisque ces pièces, que l'on pourrait appeler dans un premier temps
1
Je ne donnerai que deux exemples, emblématiques même s'il s'agit ici de pièces plutôt historiques, largement
postérieures aux événements qu'elles décrivent. En 1859, deux dramaturges espagnols traduisent une pièce
patriotique française sur la guerre de Crimée pour célébrer la date anniversaire du soulèvement du 2 mai... contre
les Français (Vicente DE LALAMA et Rafael DEL CASTILLO Los dos artesanos, Madrid, Impr. de don Vicente de
Lalama, 1859). Il s'agit d'une adaptation, très fidèle dans l'ensemble, de la pièce Les deux faubouriens, drame en
5 actes et huit tableaux d'Henri CRISAFULLI (première le 19.05.1857 à Paris). En 1873, un dramaturge colombien
plagie intégralement une pièce espagnole sur la Guerre d'Indépendance pour célébrer l'anniversaire... de la
Guerre d'indépendance colombienne contre les Espagnols : La jota aragonesa, d'Antonio HURTADO et Gaspar
NUÑEZ DE ARCE (Madrid, Impr. de José Rodríguez, 1866) devient sous la plume de Lázaro María PEREZ Una
página de oro o el sitio de Cartagena en 1815 (Bogóta, 1873).

2
« transnationales », existent, c'est donc que le théâtre patriotique aurait pour sujet, comme son
nom l'indique, la patrie, non pas au sens de MA patrie, mais la patrie dans ce qu'elle a de plus
général. L'article défini ne définirait aucune patrie en particulier, ne singulariserait pas, mais il
permettrait de désigner l'essence même du patriotisme, LA patrie comme concept, bien loin
de toute concrétisation. En partant de ce paradoxe, je considèrerai le théâtre patriotique du
XIXème siècle, espagnol en particulier, européen et américain de façon beaucoup plus
allusive, afin de dégager les invariants du genre, les ingrédients d'un succès infaillible, par-
delà les frontières et, dès lors, d'en préciser peut-être la définition.
Avant un examen plus détaillé de cette production patriotique, des différents corpus et
analyses disponibles, il convient de souligner une difficulté terminologique autour de
l'appellation même de ce théâtre. Les noms qu'on lui donne sont multiples et, pour ne retenir
que les deux plus courants, on parle très fréquemment de théâtre patriotique (qui est, par
commodité, ce que j'utiliserai ici) et/ou de théâtre de circonstances
2
. Si les deux appellations
sont, sous la plume de certains, véritablement synonymes, elles établissent, chez d'autres, une
ligne de partage qui tente de définir au plus près un corpus dont les limites sont parfois floues.
Pour ne prendre que deux exemples, dans le cas espagnol, Serge Salaün considère que c'est
l'ensemble de la production du género chico, ces pièces courtes qui envahissent par milliers la
scène des théâtres espagnols à partir des années 1870, qui est patriotique. En effet, il montre
par quels mécanismes ce théâtre « cimente l'opinion autour des valeurs politiques de la
Restauration. Le militarisme triomphant [...] et le nationalisme patriotard – écrit-il –
constituent des valeurs incontestées »
3
. Dans ce cas, parler de théâtre de circonstances peut
aider à délimiter le corpus, en ciblant, par exemple, les pièces écrites pendant un conflit dans
le but de galvaniser le public. Toutefois, il a existé un théâtre de cour de circonstances,
notamment pour célébrer des unions royales sous l'Ancien Régime, et on ne saurait parler,
dans ce cas, de théâtre patriotique – nous y reviendrons. C'est pour tenter d'échapper à ces
2
À propos de l'apparition de ce théâtre patriotique en Espagne, María Mercedes ROMERO PEÑA recense d'autres
appellations : « teatro de urgencia », « teatro de combate », « literatura de resistencia », « drama bélico de
actualidad ». (El teatro en Madrid durante la Guerra de la Independencia: 1808-1814, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 2006, p. 74).
3
« cimienta la opinión alrededor de los valores políticos de la Restauración. El militarismo triunfante [...] y el
nacionalismo patriotero constituyen valores indiscutidos ». Serge SALAÜN, « El 'género chico' o los mecanismos
de un pacto cultural », p. 251-261 dans El teatro menor en España a partir del siglo XVI. Actas del coloquio
celebrado en Madrid, 20-22 / 05 / 1982, Anejos de la Revista Segismundo, Madrid, CSIC, 1983, p. 257.

3
ambigüités que j'avais choisi, dans ma thèse, le syntagme « théâtre d'actualité militaire », pour
désigner ce type d'œuvres dans l'Espagne du XIXe siècle
4
.
Cette production patriotique relève majoritairement du mélodrame
5
, genre dans lequel
une histoire familiale vient croiser la grande Histoire, qu'il s'agisse d'amours contrariées ou de
retrouvailles rocambolesques entre des membres d'une même famille longtemps séparés.
Trois autres grandes tendances structurent l'ensemble et, tout d'abord, l'utilisation d'allégories,
avec tout un déploiement scénique lié aux miracles, aux autos sacramentels, qui permet de
mettre en scène de façon éblouissante, parfois au sens propre du terme, l'Espagne, le Peuple,
le Bien, le Mal, la Religion, etc., dans un combat que remportent toujours les Espagnols,
notamment parce que Dieu est de leur côté. Un autre déploiement scénique spectaculaire est
celui qui recrée des batailles, avec force canonnades et coups de feu tirés par des militaires
vêtus parfois de vrais uniformes – bien que ce soit interdit – et montés sur de vrais chevaux. Il
peut alors s'agir de pantomimes, jouées dans d'immenses cirques-théâtres qui servent de lieux
de représentation, ou de pièces dont la trame plus ou moins cousue de fil blanc permet
d'enchaîner ce type de tableaux guerriers. Dernière variation, enfin, certaines pièces font le
choix du « réalisme », en mettant en scène le quotidien de familles humbles dont le fils part à
la guerre, causant la tristesse, mais aussi la fierté des siens. Il n'est pas d'amour plus fort que
celui de la patrie, ni de destin plus glorieux que de mourir pour elle.
Nous voilà donc revenus à la patrie, cette essence dont je disais à l'instant qu'elle
semblait se trouver au cœur de la réappropriation de pièces devenues transfuges. Alors que
l'étymologie latine renvoie au pays du père, c'est en femme qu'elle s'incarne quand elle
devient allégorie, en mère aimante qu'elle est décrite dans le discours de toutes ces pièces :
elle suscite chez ses soldats un amour plus fort que tout, bien au-delà de celui que l'on porte à
son aimée, mais aussi à sa mère. De même que les généraux font office de pères pour leurs
troupes, la Patrie est la mère de tous les combattants. Dès lors, les dramaturges opposent,
implicitement le plus souvent, la nation, entité étatique et structure administrative, et la patrie,
lieu de toutes les passions. Ce binôme, destiné à renforcer l'attachement à la patrie, se double
d'une autre dualité, beaucoup plus implicite en général, mais omniprésente : celle qui
distingue, pour mieux les fusionner toutefois, la patria chica et la patria grande.
Ce dédoublement est parfois souligné sur le ton de l'humour, comme dans la pièce
écrite en pleine Guerre de Cuba, ¡A las filas!, où elle donne lieu à un quiproquo comique.
4
Marie SALGUES, Teatro patriótico y nacionalismo en España: 1859-1900, Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2010. Ciencias sociales: 78.
5
Sur le lien entre le mélodrame et la Révolution Française qui place le peuple au cœur de l'action et de l'Histoire,
on lira les travaux de Jean-Marie Thomasseau.

4
Lorsque le sergent, chargé de recruter les jeunes gens d'un village qui ont été tirés au sort pour
partir à l'armée, justifie auprès du maire cette nouvelle levée de troupes, il explique : « Es la
misma patria la que peligra: es la tierra donde hemos nacido: es nuestra tierra la que quieren
atropellar, es... » Le maire prend peur, en déduit que « entonces, Villatorta está en peligro » et
il s'apprête à aller mettre à l'abri, dans cet ordre, sa mule, sa femme, son poulain, son beau-
frère et l'oie qui appartient à son fils. Il revient alors au sergent de le tranquilliser : le danger
n'est pas si proche
6
. En réalité, la plupart des dramaturges se gardent bien de lever l'ambigüité
et désignent avec ce terme de « patrie », tantôt l'une, tantôt l'autre, mais toujours comme s'il
s'agissait d'une seule et même chose. Le hiatus est, le plus souvent, à peine perceptible dans
les pièces péninsulaires, notamment parce qu'il est facile de considérer certaines régions
comme une métonymie du pays dans son entier. Le cas le plus emblématique est celui de
l'Andalousie, en passe de devenir, à l'époque, une sorte de quintessence de l'Espagne
7
, mais
on pourrait également prendre l'exemple de l'Aragon, héraut du patriotisme et, en ce sens,
autre synecdoque possible de la Péninsule. La confusion ainsi introduite est loin d'être
anodine et on comprend mieux dans le cas américain le fossé qui peut, parfois, séparer les
deux acceptions. Ainsi, dans une pièce écrite à Montevideo en 1808 contre les attaques
anglaises, le terme « patria » renvoie, selon les occurrences, soit à Montevideo soit à la
métropole espagnole
8
. Ce brouillage initial est sans doute pour partie responsable de
l'élargissement possible qui permet ensuite à une pièce d'être récupérée par l'ennemi d'hier
pour exalter le sentiment d'appartenance de ressortissants d'autres nations.
D'ailleurs, les ressortissants nationaux ne sont pas tant définis, particularisés ou décrits
qu'opposés à un autre qui, lui, est beaucoup plus finement dépeint, détaillé, caricaturé et c'est
dans cette altérité que se construisent, plus ou moins en creux, une conscience et une union
nationales. Ce trait, récurrent de la propagande patriotique dans les territoires qui subirent
l'invasion napoléonienne
9
, ne constitue pas une spécificité du média théâtral et permet de faire
de l'ennemi une incarnation de nombreux défauts ou vices qui, par contrecoup, placent le bon
6
Pedro A. ROZO, ¡A las filas!, Acte I, sc. 7, p. 13, Cádiz, Tip. de Cabello y Lozón, 1900.
7
Serge SALAÜN, « España empieza en Despeñaperros. Lo andaluz en la escena nacional », p. 211-221 dans Yvan
LISSORGUES et Gonzalo SOBEJANO (coords.), Pensamiento y literatura en España en el siglo XIX. Idealismo,
positivismo, espiritualismo, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998.
8
Daniel VIDAL, « El espíritu patriótico en La lealtad más acendrada y Buenos Aires vengada (1808) de Juan
Francisco Martínez », p. 181-194 dans Roger MIRZA (éd.), Teatro, memoria, identidad, Montevideo,
Universidad de la República, facultad de humanidades y ciencias de la educación, Departamento de teoría y
metodología literarias, 2009 (p. 183 pour l'analyse des significations de patria).
9
Hagen SCHULZE, État et nation dans l'histoire de l'Europe, Paris, Editions du Seuil, 1996, traduction de Denis-
Armand Canal, p. 203-206 en particulier. À propos d'un Catecismo civil, qui circulera abondamment, et dans
plusieurs langues, parmi les opposants à Napoléon, H. Schulze écrit que « la définition de soi-même est donnée
par l'identification de l'ennemi » (p. 206).

5
droit du côté de la Nation de l'auteur de la pièce. Si l'ennemi est parfois très courageux (à
vaincre sans péril, on triomphe sans gloire...), il est presque systématiquement traître, athée ou
d'une autre religion, libidineux quelquefois et il se fait le défenseur d'une cause injuste. Placer
l'ennemi du côté du Mal en le brossant ainsi à gros traits et s'en tenir à cela pour toute
définition identitaire, de soi et de l'autre, permet de faire circuler les pièces d'une nation à
l'autre, en même temps que cela justifie une des constantes de ce théâtre : la quasi
impossibilité de se mélanger avec l'ennemi, de mêler deux sangs que tout oppose.
Ainsi, dans les nombreuses pièces qui sont structurées autour d'une histoire d'amour, la
jeune étrangère amoureuse du soldat espagnol est bien souvent éconduite, n'étant pas à la
hauteur du parangon de vertu, douceur et beauté qu'est la femme espagnole
10
. Quand,
d'aventure, un couple « mixte » semble devoir se former, on découvre à la fin, après une de
ces scènes de reconnaissance chères à la dramaturgie du mélodrame, que la jeune femme était
en fait espagnole et qu'elle avait été arrachée aux siens
11
. Les quelques mariages qui sont,
toutefois, annoncés supposent, bien évidemment, le baptême et la conversion de la jeune
femme
12
.
Ce théâtre apparaît en France au moment de la Révolution Française, en Espagne lors
de l'invasion napoléonienne, en Allemagne après la victoire remportée à Sedan..., etc. Il
correspond au surgissement des États Nationaux qui marque, en Europe, une grande partie de
l'histoire du XIXe siècle et qui entraîne l'enrôlement militaire de tous – au moins en théorie.
L'avènement du peuple devient un élément central, de l'Histoire et de la dramaturgie, en tant
qu'il est un protagoniste majeur, constitutif de la souveraineté nationale et, surtout, un
combattant. Cette idée se matérialise dans l'image d'un peuple en armes qui se dresse pour
défendre une patrie qui soudain lui appartient, alors que le territoire n'était auparavant que le
patrimoine personnel de son souverain, à moins qu'il n'ait été le bien de l'Eglise ou d'un
seigneur quelconque. Toutefois, les différentes études sur le théâtre patriotique montrent
combien ce peuple est très largement donné comme « mineur », notamment par des
dramaturges espagnols qui minimisent presque systématiquement son action
13
par le recours à
10
Pour ne citer que deux exemples : Odios africanos o la batalla de Melilla, de Jesús LOPEZ GOMEZ (manuscrit
déposé à la BNE de Madrid sous la cote Ms 14 46013) où Zoraida, repoussée para Rafael, marié à Adelina, en
devient folle. ¡Españoles a Marruecos! (Diego SEGURA, BNE, Ms 14 1375) où une autre Zoraida, à qui Isidro
Rodríguez préfère Rosa, se fait baptiser et décide d'aller en Espagne pour entrer au couvent.
11
Dans Tetuán por España, Zaide tombe amoureuse de Carlos, un prisonnier chrétien, auquel elle avoue son
secret : chrétienne, elle est née en Espagne mais la misère et le deuil ont fait d'elle une esclave en Afrique dès
l'âge de six ans. (Pièce anonyme, BNE, Ms 14 2281).
12
Dans Los moros del Riff (Carlos PEÑA-RUBIA Y TELLO, Madrid, Impr. de José Rodríguez, 1859), on annonce à
la fin de la pièce que Zara, amoureuse de Rafael, va se convertir et qu'ils se marieront.
13
Emmanuel LARRAZ, Théâtre et politique pendant la Guerre d'Indépendance : 1808-1814, Aix-en-Provence,
Université de Provence, 1988, en particulier p. 234 et suivantes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%