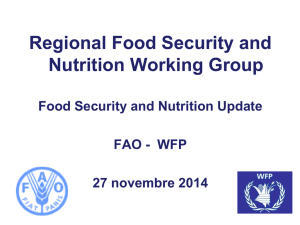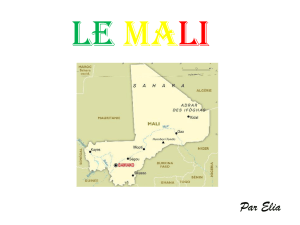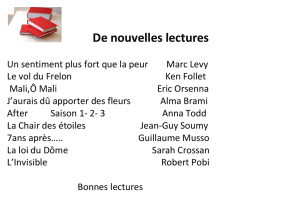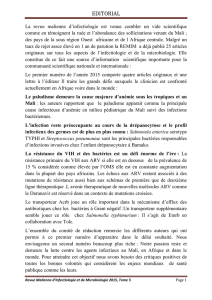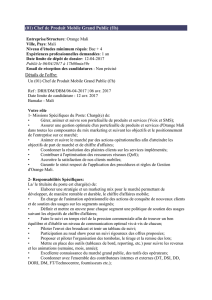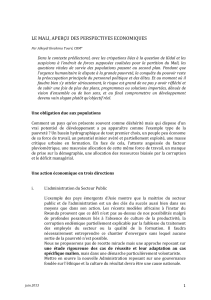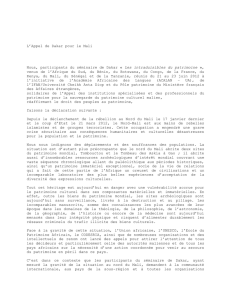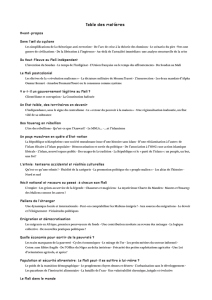Rapport principal Mali - comite de liaison de la route transsaharienne

Page 1 sur 50 841053040
PRESENTATION.
Rappel historique de la Route TransSaharienne (RTS),
Le Sahara est un immense espace désertique, aride, inhospitalier et fort peu habité
(moins de 5 habitants au km2).
Il s'étend sur près de 5 000 km, d'est en ouest, de l'Atlantique à la Mer Rouge et
2 000 km du nord au sud.
Le Sahara vit grâce à une organisation sociale dans laquelle les nomades et les
sédentaires coexistent en symbiose. Les uns, caravaniers, ont une économie pastorale, les
autres, sédentaires, habitent les oasis et sont les gardiens des points d'eau, des haltes et
des cultures".
Les limites de cet espace sont généralement définies par des facteurs biologiques
et climatiques. Les isohyètes de 100 mm/an constituent l'enveloppe climatique moyenne,
quoique dans certaines régions il ne pleut pas certaines années.
Les échanges commerciaux et socioculturels à travers le Sahara tirent leur origine
de l’histoire ancestrale. Ils ont été gravés par d’illustres historiens et écrivains à travers
les âges pour la postérité.
Pietro Laureano affirmait dans son livre " le Sahara jardin méconnu" : «Comme la
Méditerranée, le Sahara n'a jamais constitué une barrière entre les différents peuples et
les civilisations. Depuis l'antiquité la plus lointaine jusqu'au moyen âge, et alors
qu'affluait en Europe l'or du Sahara qui servait à la frappe des monnaies, le désert
s'inscrivait dans un contexte international d'échanges commerciaux ».
Ainsi, l'établissement d'un courant continu d'échanges transsahariens remonterait
au 8ème siècle et l'initiative reviendrait à la dynastie Rostémide de Tahert ( 776-921). Les
commerçants empruntaient surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao (pistes
chamelières), mais aussi la route Sijilmasa-Awdaghost-(Empire du Ghana). L'or, l'ivoire,
le sel, les dattes, les tissus et le henné constituaient les principaux éléments de ce
commerce.
Le grand Atlas Africain rapporte qu'à la fin du 11ème siècle l'Empire du Ghana
connut son apogée et fonda sa richesse sur l'exploitation des mines d'or du Haut Sénégal
et du Haut Niger d’une part, mais aussi et surtout de ses relations commerciales
transsahariennes intenses par les pistes de l'Ouest d’autre part.
A la fin du 15ème siècle, l'arrivée des Portugais sur les côtes au Sud et à l'Ouest du
Sahara par la voie maritime eut des conséquences lourdes sur la vie et l'économie du
désert en particulier, et celle du continent africain en général.

Page 2 sur 50 841053040
Le passage des commerçants par le Golfe de Guinée pour l'accès aux régions
aurifères, aux produits tropicaux, à la traite des esclaves, etc… provoqua le
désintéressement pour la route des caravanes.
La colonisation Française au Maghreb s’accompagna de mesures protectionnistes,
(barrières douanières en Algérie) qui taxaient les produits africains aux deux tiers de leur
valeur.
Ainsi les échanges séculaires que connaissaient les deux rives du Sahara
ralentirent et le commerce transsaharien perdit sa prospérité.
L'idée d'une liaison transsaharienne réapparut en France en 1860, sous la forme de
projet de chemin de fer, naturellement, puisque c’était le moyen de communication à la
mode à cette époque. L'industrie automobile n’étant pas encore très développée.
De 1875 à 1904 une vingtaine de projets et de tracés potentiels furent ébauchés et
étudiés. Le projet finalement retenu, en 1930 devait relier Oujda en Algérie à Tessalit au
Mali, en passant par Bechar et Reggane. De Tessalit le projet se séparait en deux
branches, l'une vers Niamey par Gao, l'autre vers Ségou par Tombouctou c'est à dire par
le delta du Niger. La capacité de transport était estimée à 4 millions de tonnes de frêt
(dans les 2 sens) et 24 000 voyageurs par an. Il suffirait alors de construire une
transversale d'Oujda à Alger pour mettre cette dernière à 3 jours de train de Ségou.
Les objectifs annoncés par les projets du Transsaharien étaient initialement
stratégiques, doublés, par la suite, d’intérêts économiques. Il s'agissait tout d’abord,
grâce au Transsaharien, de prolonger l'empire colonial vers l'Afrique profonde afin de
contrer les influences Marocaines et Libyennes au Sahara, et ensuite d'atteindre le delta
du Niger afin de le transformer en une région productrice de coton grâce aux eaux du
fleuve Niger.
Le premier tronçon du projet rebaptisé « Méditerranée(Mer)-Niger(Fleuve) » ne se
réalisera qu'en 1942 et atteindra Bechar (Kenadsa) en passant par la ville Marocaine de
Bouarfa. En 1948 le rail sera posé jusqu'à Abadla (275 km) qui sera en fait le terminus.
Au Mali, la construction du Pont-Barrage de Markala et la liaison ferroviaire
Ségou-Markala-Niono vers Tombouctou relevaient du projet Mer-Niger.
Finalement, il ne fut construit que 275 km de chemin de fer, au Magrheb, sur les
2 754 km de Mer-Niger prévus. Le rêve de la boucle du Niger ne se réalisa pas.
Une fois les indépendances politique acquises dans les années 1960, les pays
riverains du Sahara, guidés par une communauté de destin et par la volonté de restaurer
les liens économiques et socioculturels séculaires, ont décidé de conjuguer leurs efforts
pour la construction d'une infrastructure routière.
En 1964, à l'initiative de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),
l'Algérie, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la République Arabe Unie (Egypte),

Page 3 sur 50 841053040
le Tchad et la Tunisie se réunirent à Alger pour ranimer et revigorer l’édification d'un
projet transsaharien.
Un mandat fut donné à un Comité composé de l'Algérie, du Mali, du Niger et de la
Tunisie pour mener les études indispensables à la définition du type d'infrastructure à
réaliser (rail ou route), et au choix du tracé le plus économique.
En 1966, les quatre pays décidèrent d'institutionnaliser le Comité en le dotant de la
personnalité juridique, « Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) » qui
fut chargé de la réalisation de la Route TransSaharienne (RTS) (études et recherche des
financements pour la construction).
En décembre 1972, les études techniques de la Route Transsaharienne furent
lancées par le bureau « TransSaharian Consortium » grâce à un financement de
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement (PNUD). L’étude prenait en
charge les deux branches situées au Sud de Tamanrasset : Tamanrasset-Arlit 600 km vers
le Niger et Tamanrasset- Tin Zaouaten-Kidal-Gao 1100 km vers le Mali. Les études de la
partie située au Nord de Tamanrasset vers Oran et Alger ont été financées par l'Algérie.
Les actions de construction de la Route TransSaharienne (RTS) sont en cours dans
chacun des pays, cependant le constat aujourd’hui en 2002 est que, la Route
TransSaharienne telle qu’envisagée par nos dirigeants au lendemain des indépendances
en 1960, ressemble toujours à un projet virtuel, à l’image de Mer-Niger, au grand dam
des populations sahariennes, ce qui a suscite de nombreuses et récurrentes interpellations
des responsables actuels, dont celle du Ministre chargé des Travaux Publics du Mali
devant l’Assemblée Nationale par le Député de Abeïbara en ces termes : « en 2001, est-il
encore aussi difficile de joindre Ségou à Marseille qu’il l’était en 1860 » ?
Les différents tronçons du projet inter-état de la Route TransSaharienne
doivent-ils continuer à être assujettis à des recherches de financements nationaux,
eux-mêmes soumis à des impératifs de rentabilité économique peu probante et de
prioritisation, ou doivent-ils être intégrés dans un projet global de route tel que
recommandé par le NEPAD?
Les habitants du Sahara voudraient rappeler à leurs Dirigeants que s’il est
universellement admis que les Hommes, pour vivre, ont d’abord besoin de « pain »,
il n’en demeure pas moins établi aussi, que les Peuples, pour survivre, ont surtout
besoin de communiquer.
La présente étude commandée par le CLRT tente de contribuer à cette dernière
approche en décrivant l’organisation du transport au Mali et les échanges commerciaux,
spécifiquement dans le cadre de la RTS, aux fins d’une harmonisation des systèmes du
CLRT, prélude à leur intégration attendue.

Page 4 sur 50 841053040
I. ORGANISATION DU TRANSPORT AU
MALI.
I.1. CADRE GENERAL DE L’ACTIVITE TRANSPORT.
I.1. a. PRESENTATION SUCCINTE DU MALI.
LEGENDE
FLEUVES NIGER ET SENEGAL
ROUTE TRANSAHARIENNE ET INTERCONNEXIONS
CHEMIN DE FER BAMAKO-DAKAR
RESEAU ROUTIER PRINCIPAL
AEROPORTS PRINCIPAUX

Page 5 sur 50 841053040
Le Mali est un vaste pays continental situé en Afrique de l’Ouest. Il couvre une
superficie de quelques 1.241.043 km² et est peuplé d'environ 11,5 millions d'habitants avec
un taux de croissance moyen de 2,1 % par an. Il partage avec sept (7) autres pays voisins,
(Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, et Mauritanie), dont cinq
côtiers, des frontières terrestres communes s’étalant sur 7 200 km.
La densité humaine moyenne est de neuf (9) habitants/km2, répartie inégalement sur
le territoire.
Le pays est subdivisé en huit (8) régions administratives (Kayes, Koulikoro, Sikasso,
Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal) et un district (Bamako), totalisant 701 communes
urbaines et rurales. Les trois Régions Administratives de la zone septentrionale
(Tombouctou,Gao et Kidal), couvrent 2/3 du territoire national avec 11 % de la population.
Le relief est peu accidenté avec une végétation clairsemée au centre et arbustive au
sud, le climat est désertique au nord, sahélien au centre, et soudanien au sud du pays.
La population, multiraciale, est constituée à 80% de ruraux qui s’occupent
fondamentalement d’agriculture, d’élevage, de pêche et d’artisanat.
Le Produit Intérieur Brut (PIB) est de 250 dollars US par habitant.
Deux grands fleuves traversent le pays, le Niger du sud au nord-est sur 1.700 km
environ est navigable 5-6 mois/an, et le Sénégal à l’ouest sur 850 km est navigable 3-4
mois/an à partir de Kayes vers le Sénégal.
Une ligne de chemin de fer « Dakar-Niger », longue de 729 km au Mali, assure la
liaison avec le port de Dakar (Sénégal).
Les infrastructures aéronautiques se composent de quatre aérodromes internationaux,
huit aérodromes principaux, dix neuf aérodromes secondaires et quatre aérodromes privés.
Les aérodromes à desserte régulière sont au nombre de neuf dont cinq disposent d’une piste
revêtue.
Le réseau routier couvre environ 50 000 km, dont 17 156 viables, sur lesquels 13 004
km sont classés.
Il est constitué de 3 638 km de routes revêtues en enduit superficiel (ou en
construction) assurant principalement les liaisons internationales, de 2 388 km de routes en
terre moderne, 6 359 km de pistes améliorées et quelques 37 615 km de pistes saisonnières.
Le réseau routier draine 80% du trafic international pour l’approvisionnement du
pays, sur lesquels 75% transitent par le corridor ivoirien.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%