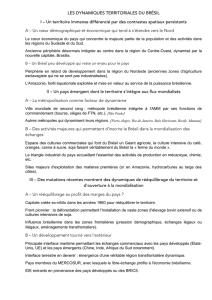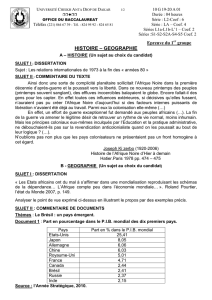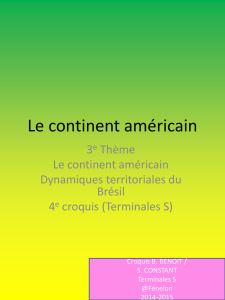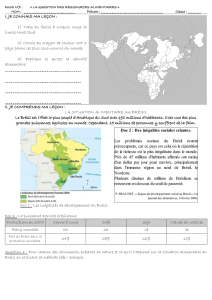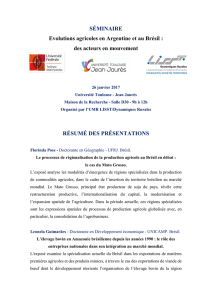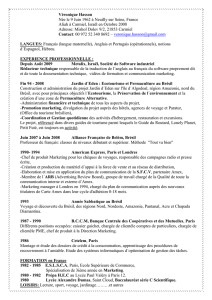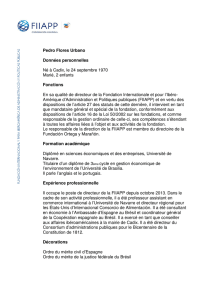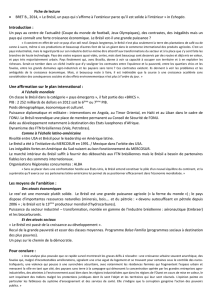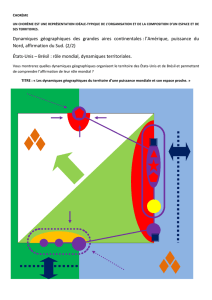La domination de la Finance au Brésil

1
La domination de la Finance au Brésil
Roberto Grün
UFSCAR
Le Brésil est considéré comme un exemple extrême de « financiarisation ».Taux
d’intérêts et marges (spreads) bancaires considérés comme les plus élevés du monde,
prévalence des raisons et des contraintes issues du marché financier sur toute autre
considération et, plus récemment, la soumission visible d’un gouvernement fédéral issu de
l’extrême gauche du spectre politique aux dictats de cette entité que sont les « marchés ».
Comme les marchés sont essentiellement internationaux et que c’est par leur intermédiaire
qu’une grande partie des pressions globalisantes exercent leurs effets sur la société
brésilienne, je crois que c’est un bon exercice de sociologie que de regarder de près les
modalités selon lesquelles cette possibilité se réalise ou parait seulement se réaliser.
Vue de l’extérieur, l’expression la plus visible de la prédominance financière dans la
société brésilienne est le niveau extrêmement élevé des taux d’intérêts pratiqués dans
l’économie brésilienne et, un peu moins visible mais peut-être encore plus éclairant, le coût
énorme de l’intermédiation bancaire1. En comparaison avec les autres pays,, les banques
brésiliennes rémunèrent bien leurs investisseurs, mais accordent leurs prêts à un prix
exorbitant. Il faut le dire, le Brésil est une sorte de « paradis des rentiers », mais surtout des
banquiers, étant donné que ces derniers, en plus de recevoir des rémunérations élevées pour
leur intermédiation, jouissent d’une situation doublement favorable créée par l’afflux des
investisseurs tant nationaux qu’internationaux.
Comme on peut le prévoir, la société brésilienne débat périodiquement de la légitimité
d’une telle situation, des raisons de la changer et des manières de le faire. Du côté des
défenseurs du statu quo financier l’explication la plus répandue se fonde sur l’«incertitude
juridique » : comme les cadres juridiques de la société brésilienne sont peu fiables, les prêteurs
sont obligés de faire payer cher leur argent étant donné que le risque de le perdre est très
grand. A titre d’exemple de cette « incertitude », les décisions judiciaires défavorables aux
1 Pour les chiffres, voir l’annexe.

COLÓQUIO SABER E PODER
Focus, Unicamp, 10/2008
créanciers ou simplement le manque d’empressement des autorités dans les procès en
recouvrement de dettes, la confiscation de valeurs liquides intervenue dans le cadre de ce
qu’on a appelé le « Plan Collor » (1989) et la menace d’un retour de l’inflation qui érode la
valeur des capitaux. Concrètement, on voit constamment des épisodes de ce genre montés en
épingle et transformés en scoops dans les media les plus divers de sorte que la perception de
l’incertitude est constamment répétée. Cela n’arrive pas par hasard : l’idée érudite de
l’«incertitude juridique » est, elle-même, réitérée par une perception culturelle très enracinée
selon laquelle le Brésil est le pays de la débrouille (jeitinho), de l’improvisation et du manque
de planification. Ces caractéristiques imputées à la société brésilienne sont systématiquement
opposées au « sérieux » dont sont crédités les pays centraux, dits du « Premier Monde », dans
lesquels les taux d’intérêt seraient « civilisés ». De sorte que pour avoir droit à des taux
« civilisés » il faudrait d’abord nous convaincre nous-mêmes d’abandonner les idiosyncrasies
nationales pour accepter le modèle dont nous créditons le « Premier Monde » (Grün 2007).
A la thèse juridique est opposée dans le débat l’autre hypothèse, selon laquelle les taux
d’intérêts élevés sont un effet de la concentration du secteur bancaire. Peu nombreuses à
prêter de l’argent les banques auraient ainsi les moyens d’imposer un prix élevé pour leur
marchandise. Il faut relever que cette thèse, encore que constamment invoquée par les
économistes, les politiques et les journalistes les moins impliqués dans la sphère financière,
fait l’objet de bien peu de publicité. Ce n’est pas le lieu ici de discuter la qualité intrinsèque ou
la validité respectives des deux thèses, mais il faut bien constater que la première occupe bien
plus d’espace et que, lorsque les gouvernements sont forcés de donner quelques satisfactions à
l’opinion publique au sujet des taux d’intérêt, ils proposent généralement des mesures qui
diminuent l’incertitude juridique, donnant ainsi raison au premier diagnostic.
Le discours favorable aux finances est normalement réputé « moderne » et « ouvert »,
caractéristiques qui s’opposent au caractère « villageois », «corporatif » et «attardé » des
défenseurs du contrôle des activités financières, normalement les porte-parole de l’industrie.
Les références au « moderne » et à l’ »international sont des armes rhétoriques qui font
toujours leur effet dans ce débat public sur lequel repose la discussion économique interne à la
société brésilienne. « Moderne » et « international » sont des catégories mnémotechniquement
consonantes avec l’idée de « jeunesse » et apparaissent habituellement comme l’arme des
secteurs des élites qui contestent les positions établies. La plupart du temps, la querelle
rhétorique renvoie à des débats de juridiction et à des types différents de capital culturel.
La domination de la Finance au Brésil 2

COLÓQUIO SABER E PODER
Focus, Unicamp, 10/2008
Dans l’histoire récente du Brésil, il y eut la forte discussion entre juristes et ingénieurs
pendant la période des substitutions des importations (1940-1960) dans laquelle le premier
groupe s’identifiait à la tradition nationale et à l’économie agraire-exportatrice et le deuxième
à la modernité principalement anglo-saxonne et à l’industrialisation induite. Selon les
premiers, la monnaie nationale devrait être forte de façon à bien rémunérer les produits
agricoles exportés et, ainsi , entraîner la croissance de cette activité. Selon le deuxième
groupe, la monnaie nationale devrait être moins valorisée, de façon à empêcher que les
importations de produits manufacturés gênent le développement de l’industrie nationale.
Juste après celui-là, apparaît un nouveau conflit dans lequel les ingénieurs s’identifiaient au
développement national qui devrait préserver l’industrie et l’infrastructure économique par la
planification étatique. Finalement, dans les années 1960, arrive le nouveau groupe des
économistes portés par un discours sur l’autorité fiscale qui devrait conduire à la maîtrise de
l’inflation, dont la composante principale serait un État mal administré à cause de ses
volontés irréalistes d’intervention exagérée dans l’économie. Pour résoudre ce problème,
l’Etat devrait progressivement abandonner les velléités, maintenant identifiées négativement
comme corporatives, de diriger le développement et se donner pour tâche principale le
contrôle de la monnaie, laissant au marché la fonction de lancer le développement « naturel »
lorsque les conditions requises seraient réalisées, étant donné que le développement
« artificiel » recherché en d’autres temps n’aurait conduit qu’à la désorganisation sociale ,
dont l’inflation était le symptôme et la composante essentiels. Cette niche culturelle, produite
en grande partie par la diffusion de la pensée économique orthodoxe contemporaine crée le
milieu nécessaire au développement des finances et intronise ses interprètes brésiliens dans la
position d’intellectuels organiques du champ du pouvoir qui s’est formé dans les dernières
décennies. En conséquence de cette configuration, toute critique de l’orthodoxie est
généralement mal perçue et taxée d’attardée et corporative – péchés intellectuels et moraux
dont peu de brésiliens sont capables de porter le poids.
Mais la principale conséquence de ce résultat réside dans la permanence de l’énorme
asymétrie dans la distribution des revenus au sein de la société brésilienne. Bien que
statistiquement cette situation puisse être considérée comme insoutenable, la dynamique
sociale explique sa permanence. Les dernières nouveautés en matière de crédit populaire en
sont un exemple. Les salariés, en particulier ceux du secteur public, et les retraités titulaires
de pensions qui ont des revenus fixes garantis (formalizados) parviennent à obtenir des prêts
La domination de la Finance au Brésil 3

COLÓQUIO SABER E PODER
Focus, Unicamp, 10/2008
dont les mensualités de remboursement seront prélevées directement sur leurs revenus
mensuels(le « crédit consigné). De cette façon l’éventualité du non paiement est réduite à
presque zéro et les taux d’intérêt sont beaucoup moins élevés que les taux normalement
pratiqués par les entreprises de financement qui opèrent avec les clientèles populaires.2
Tandis que les dites « sociétés de financement populaire » exigent des taux d’intérêt qui vont
de 3,5 à 10% par mois, les taux du crédit consigné, accordé aux titulaires de revenus sur
lesquels les mensualités de remboursement peuvent être débitées directement, tournent
autour de 2,3 à 3% par mois (SOFIA 11/02/2008).Ces taux sont très élevés comparés aux
modèles internationaux et rémunèrent grassement les banquiers, mais même ainsi ils restent
bas par comparaison avec ceux auxquels la clientèle qui en use était habituée par le passé.
Cette configuration à la fois grotesque et compréhensible engendre une profonde acceptation
du système qui, au moins à court terme, favorise à la fois les titulaires de rentes et ceux qui
ont besoin d’emprunter.3 En somme, vue de l’intérieur, la relation de la société brésilienne
avec son système financier parait s’être améliorée ces derniers temps, encore que la situation
puisse surprendre un regard familier d’autres latitudes ou d’autres relations de force entre
agents économiques.
Le national et l’international dans les finances
Dans une perspective internationale, quand on regarde les finances à partir des acteurs
les plus en vue dans les media, on observe dans le langage des marchés un modèle semblable à
Sao Paulo, Kuala Lumpur, Paris ou New York. Surgit alors la tentation de considérer
seulement cette fonction homogénéisante des marchés sur les pratiques des champs
2 L’unique possibilité de non-paiement, non encore réalisée à ce jour, serait l’éventualité dans laquelle
l’emprunteur obtiendrait une sentence juridique interdisant au créancier de récupérer son prêt
directement sur le bulletin de salaire ou le bulletin de pension.
3 Elle aussi met en lumière des changements significatifs dans la sphère familiale des familles dont un
des membres peut prétendre à ce type de prêt. Le cas est de plus en plus fréquent du retraité qui
sollicite un prêt en réalité destiné à un fils ou un petit-fils qui sans cela n’auraient pas accès à cette
source de financement bon marché par comparaison avec les sources auxquelles ils auraient accès par
eux-mêmes. Ce procédé devient même progressivement une nouvelle obligation familiale qui a des
conséquences importantes dans la structuration des noyaux familiaux et les relations de force en leur
sein.
La domination de la Finance au Brésil 4

COLÓQUIO SABER E PODER
Focus, Unicamp, 10/2008
économiques et politiques des diverses sociétés. Mais je crois que cette logique cache plutôt
qu’elle ne révèle la logique sociale selon laquelle les marchés opèrent et les influences qu’ils
exercent sur le reste de la société. Un autre piège pour la sociologie de cet espace social réside
dans la tendance universitaire dans les sciences humaines de réaliser des études
ethnographiques systématiques et rigoureuses de groupes spécifiques d’agents qui opèrent sur
ces marchés comme, par exemple, les courtiers en marchandises ou en actions qui sont utiles
pour montrer comment ces groupes se comportent et pourquoi, mais fonctionnent moins bien
pour évaluer la dynamique de l’espace social pris comme un tout étant donné qu’ils finissent
par incorporer les arguments et les théodicées du groupe qui est toujours en conflit de
juridiction avec d’autres segments de l’espace.
Pour éviter, ou au moins relativiser les effets de ces deux pièges, je pense qu’un bon
procédé consiste à analyser la forme donnée au Brésil à quelques instruments financiers de
base qui promeuvent la « financérisation » de la société brésilienne. Ainsi les capitaux et les
stratégies qui s’affrontent dans l’espace des finances seront analysés « d’arrière en avant » à
partir des instruments et des institutions qui apparaissent et, éventuellement, ceux qui
avortent. La « jeunesse » de cet espace et de ses institutionnalités permet une analyse plus
rapide, étant donné que les traces de sa constitution peuvent être retrouvées par l’analyse de
l’activité du gouvernement brésilien et des organes multilatéraux tels le FMI, la Banque
Mondiale et l’OCDE, des acteurs individuels et collectifs qui y agissent, dans les actions et
les réactions dans les espaces d’action des dirigeants syndicaux et, plus récemment, aussi les
dirigeants des diverses ONGs qui s’occupent des causes sociales, environnementales ou de
genre, ainsi qu’à travers leurs reflets dans la presse politique, environnementale et d’affaires.
Les dispositifs financiers les plus amples qui sont importés, retravaillés et dotés de
significations nouvelles dans la société brésilienne sont la gouvernance corporative et
l’émission de fonds communs privée de placement en actions (private equity funds). Tous
deux ont la caractéristique d’être une architecture construite à partir d’ensemble
d’instruments pas toujours homogènes plutôt que des outils clairement définis quant à
l’heuristique, l’usage et les objectifs. De cette manière ils peuvent, du point de vue de
l’analyse, être considérés à la fois comme institutions et comme artefacts culturels. Comme
institutions parce que la logique de leur implantation dans la société brésilienne dépend de
réarrangements dans divers secteurs et espaces sociaux, tels les champs économique,
juridique et politique. Et une fois installés ils produisent des effets irréversibles dans ces trois
La domination de la Finance au Brésil 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%