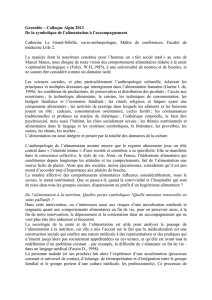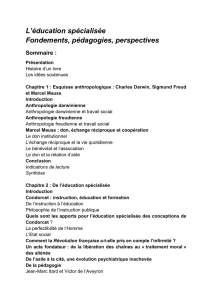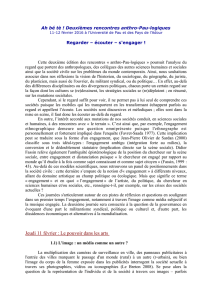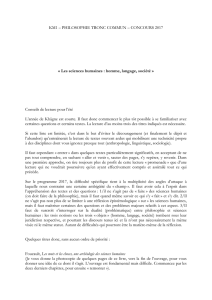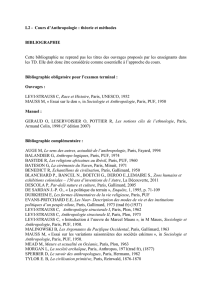Ateliers Thématiques en Philosophie des Sciences Sociales

Ateliers Thématiques en Philosophie des Sciences Sociales
Besançon, 27 Janvier 2010
Expressions et inscriptions sociales du corps
Le corps entre nature, personne, communauté et cosmos
Par rapport à la constitution des grands repères théoriques des sciences
humaines et sociales, l’intervention de la problématique du corps a été plutôt tardive. On
peut en effet voir dans l’article de Mauss sur les techniques du corps (Mauss, 2004) le
point de départ d’une approche sociologique de l’homme sous l’aspect de sa constitution
physique, approche qui n’a fait par la suite que se développer, pour devenir aujourd’hui
un thème largement débattu. En témoignent les publications récentes de grandes
synthèses, qu’elles soient propres à une discipline (Godelier et Panoff, 2009, pour
l’anthropologie ; Corbin, Courtine, Vigarello, 2005-2006 pour l’histoire) ou
interdisciplinaires (Marzano, 2007). Cette conquête d’une autre dimension de la réalité
humaine, sans doute trop laissée de côté par l’idéalisme implicite de nos cadres
théoriques pour lesquels la participation à des formes de vie sociales est d’abord chose
mentale, a progressivement induit la redéfinition des modalités générales de ce que
signifie entrer en société. Ces évolutions récentes ont affecté conjointement les diverses
sciences humaines ainsi que la philosophie, qui, cependant, a peut-être plus tardivement
pris acte des enjeux soulevés, et qui a ainsi donné lieu à une tradition théorique
largement distincte.
Parmi la multiplicité des approches théoriques du corps en société, on peut en
effet noter l’existence en quelque sorte parallèle de deux traditions, d’importance égale,
qui ont souligné chacune de leur côté des aspects différents de ce problème. Depuis les
travaux fondateurs de Foucault sur les dispositifs de discipline et de sécurité (Foucault,
2004), mais aussi peut-être dès les apports de Canguilhem à l’épistémologie des sciences
médicales (Canguilhem, 1966), ce qu’on pourrait appeler une philosophie politique du
corps s’est attachée à décrire les modalités de l’arraisonnement politique des
subjectivités en passant par l’analyse de technologies de pouvoir essentiellement
dirigées vers le corps. Ces technologies biopolitiques qui convoquent l’humain dans sa
naturalité sont devenues peu à peu le modèle de référence pour approcher les divers
points d’application du pouvoir, notamment la constitution performative des genres
(Butler, 2002 ; Haraway, 2009). De l’autre côté, une tradition essentiellement
anthropologique a mis l’accent sur la dimension symbolique du corps. En décrivant les
systèmes de représentation des substances corporelles qui pilotent la constitution des
identités sexuelles et les règles de parenté (Héritier, 1996), l’ordre rituel et politique
(Godelier, 1982), ou encore la définition du pur et de l’impur (Douglas, 2005),
l’anthropologie s’est elle aussi confrontée directement au problème de l’intervention du

naturel dans le social par le biais d’une réflexion sur le corps. Il est frappant que ces
deux grands styles théoriques n’aient pas encore fait l’objet d’une synthèse, si celle-ci est
possible, et coexistent trop souvent dans une ignorance réciproque. Pourtant, de
nouveaux objets suscitent la convergence des problématiques, parmi lesquels on peut
retenir les questions liées à la santé (Fassin, 1996 ; Fassin et Memmi, 2004) et à
l’hygiène (Keck, 2008), ou encore au développement des nouvelles technologies
génétiques et reproductives (Strathern, 1992 ; Rabinow, 2000). L’ouverture de ces
nouveaux fronts actualise en réalité le fait que les traditions de philosophie politique et
d’anthropologie sociale du corps avaient vocation à se rencontrer, notamment en raison
du fait qu’elles partagent certains problèmes fondamentaux. Ainsi, dans les deux
traditions se pose la question tout à fait cruciale de la relation de réciprocité entre ce
qu’on pourrait appeler l’inscription et l’expression politique des corps. En effet, les
structures d’ensemble qui ordonnent les rapports sociaux comme les rapports de
pouvoir s’inscrivent sur la matérialité du corps, et induisent d’ « en haut » des
représentations de soi, et réciproquement, les usages individuels du corps s’expriment
d’ « en bas » dans des contextes collectifs qui forment leur référence obligée et souvent
tensionnelle. Ce jeu de l’inscription et de l’expression, qu’on le saisisse en termes
symboliques ou pratiques, constitue le passage obligé d’une théorie sociale qui voudrait
prendre en compte le rôle du corps, dans la mesure où ce dernier ne surgit jamais de lui-
même, isolément, mais seulement dans son articulation avec des axes plus généraux que
sont les conceptions de la naturalité, de la personne, de la communauté et du cosmos.
C’est donc parce que la problématique du corps nous invite à articuler différents
niveaux de perception et de manifestation de la réalité sociale qu’elle impose un défi à la
philosophie. Les clivages qu’elle manipule ordinairement entre physique et mental,
privé et public, nature et société, ou encore microcosme et macrocosme, se trouvent en
effet déstabilisés, et avec elles les formulations conceptuelles traditionnelles de la
corporéité humaine. Nous voudrions donc lors de cette journée d’études interroger le
complexe théorique où le corps humain intervient comme révélateur et comme
perturbateur, et ce dans l’esprit d’une synthèse philosophique des approches sociales du
corps. Sont donc conviés tous les jeunes chercheurs qui, en philosophe, mais aussi en
sociologie, anthropologie, histoire, rencontrent ces problématiques, et partent à la
recherche de cadres conceptuels originaux pour les développer.
Cette journée destinée aux doctorants et jeunes chercheurs se déroule dans le
cadre des activités du laboratoire « Logiques de l’Agir » de l’Université de Franche-
Comté (EA 2274), le 27 janvier 2010 à Besançon. Elle sera clôturée par une conférence
de F. Keck, organisée en partenariat avec le séminaire « Nature et société ».
Les propositions de communication (une page environ, présentant le domaine
d’étude et le cadre théorique employé + une rapide présentation de l’auteur et de ses
recherches) sont à faire parvenir avant fin Octobre à :
Pierre Charbonnier ([email protected])
Jan Marsalek ([email protected])
Gildas Salmon ([email protected])
La version finale des propositions retenues devra être rendue avant fin Décembre
pour être communiquée aux discutants.
Bibliographie :
Butler, J. La vie psychique du pouvoir, Leo Scheer, 2002.

Canguilhem, G. Le normal et le pathologique, PUF, 1966.
Corbin, A., Courtine, J.-J., Vigarello, G. Histoire du corps, 3 vol., Seuil, 2005-2006.
Douglas, M. De la souillure, Essai sur les notions de pollution et de tabou, La Découverte,
2005.
Fassin, D. L’espace politique de la santé, Essai de généalogie, PUF, 1996.
Fassin, D., Memmi, D. Le gouvernement des corps, Editions de l’EHESS, 2004.
Foucault, Sécurité, territoire, population, Gallimard/Seuil, 2004.
– Naissance de la biopolitique, Gallimard/Seuil, 2004.
Godelier, M. La production des grands hommes, Flammarion, 1982
Godelier, M., Panoff, M. Le corps humain, Conçu, supplicié, possédé, cannibalisé, CNRS,
2009
Haraway, D. Des singes, des cyborgs et des femmes, J. Chambon, 2009.
Héritier, F. Masculin/Féminin I, La pensée de la différence, Odile Jacob, 1996.
Keck, F. « Risques alimentaires et catastrophes sanitaires », Esprit, Mars/Avril 2008.
Marzano, M. (dir.) Dictionnaire du corps, PUF, 2007.
Mauss, M. « Les techniques du corps », in Sociologie et anthropologie, PUF, 2004.
Rabinow, P. Le déchiffrage du génome, L’aventure française, Odile Jacob, 2000.
Strathern, M. After nature, Cambridge University Press, 1992.
1
/
3
100%