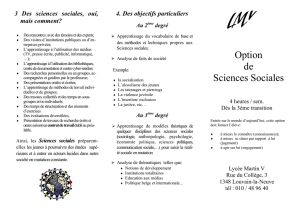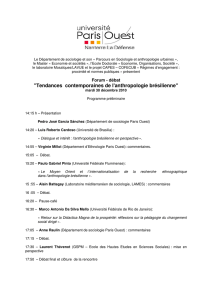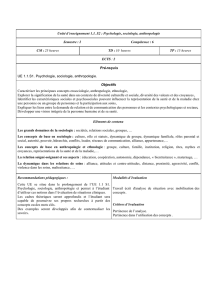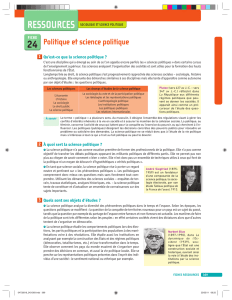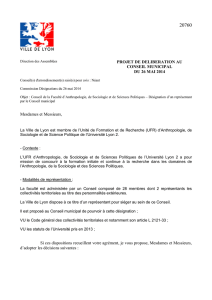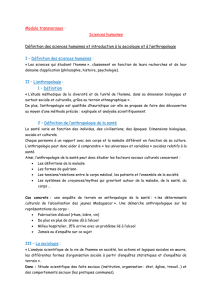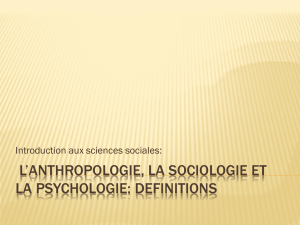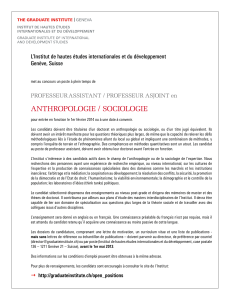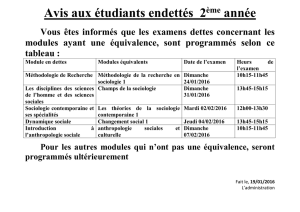Grenoble – Colloque Alpin 2012 De la symbolique

Grenoble – Colloque Alpin 2012
De la symbolique de l’alimentation à l’accompagnement
Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, Maître de conférences, Faculté de
médecine Lille 2.
La manière dont la nourriture constitue pour l’homme un « fait social total » au sens de
Marcel Mauss, nous éloigne de toute vision des comportements alimentaires réduite à la seule
« optimalité biologique » (Foley, W.H.,1985), à une universalité de normes et de besoins, et
ne saurait être considéré comme un domaine isolé.
Les sciences sociales, et plus particulièrement l’anthropologie culturelle, éclairent les
principaux et multiples domaines qui interagissent dans l’alimentation humaine (Garine I. de,
1996): les conditions de productions, de préservation et distribution des produits ; l’accès aux
nourritures ; la technologie alimentaire, la cuisine, les techniques de consommation; les
budgets familiaux et l’économie familiale ; les rituels religieux et laïques ayant une
composante alimentaire ; les activités de prestige dans lesquels les aliments et les boissons
jouent un rôle : cadeaux, consommation ostentatoire, cycles festifs ; les connaissances
traditionnelles et profanes en matière de diététique ; l’esthétique corporelle, le bien être
psychosocial, mais aussi l’habitat, les rôles socialement sexués ; les thèmes nutritionnels et
alimentaires dans le langage et les systèmes symboliques, la littérature, les proverbes, les
contes, les chants, les mythes…
L’alimentation est ainsi intégrée et pensée par la totalité des domaines de la culture.
L’anthropologie de l’alimentation montre encore que le registre alimentaire joue un rôle
central dans « l’identité intime » d’une société et contribue à sa spécificité. Elle se manifeste
dans la conscience collective, le style de vie. Ainsi, en France, l’hédonisme alimentaire qui
conditionne depuis longtemps les attitudes et les comportements, fait de l’alimentation une
source licite de plaisir. Alors que des sociétés, moins épicuriennes, considèrent qu’il est peu
moral d’accorder trop d’importance aux plaisirs de bouche.
La tonalité affective des comportements alimentaires influence considérablement, nous le
savons, le statut nutritionnel. Que se passe-t-il, quand la convivialité et l’hospitalité qui sont
de mise dans tous les groupes sociaux, disparaissent au profit d’un hygiénisme alimentaire ?
De l’alimentation à la nutrition. Quelles pertes symboliques ?Quelle attention renouvelée en
soins palliatifs ?
Dans cette intervention, on s’intéressera aussi aux risques d’une moralisation médicale et
soignante quant aux comportements alimentaires en fin de vie, pour en percevoir aussi, à la
fin de notre intervention, le dépassement et la contestation dans un accompagnement qui ne
veut plus être être réducteur et biocentré.
La sociologie de la santé et de l’alimentation est utile pour analyser le passage de
l’alimentation à la nutrition, car elle a mis l’accent sur le fait que la médicalisation est une
construction sociale qui confère une nature médicale à des représentations et des pratiques qui
n’étaient jusqu’alors pas socialement appréhendées en ces termes, et qu’elle est avant tout la
redéfinition d’un problème existant – par exemple, la difficulté de s’alimenter en fin de vie -
dans un langage médical (Fassin D., 1998).
La personne malade (et ses proches) fait alors l’expérience d’une acculturation (processus
constant et universel de contact, d’échange, de réinterprétation et d’intégration entre le groupe
familial et le groupe porteur d’une culture médicale, les professionnels). Ce processus de

contact culturel est complexe, et peut être porteur d’une forte violence symbolique quand il
prend les voies de l’imposition.
Notre dernière recherche qualitative en cours * conjuguant l’observation participante directe
et l’interview de soignants, de patients et de familles dans plusieurs régions françaises,
permettent de constater que la « médicalisation » de l’alimentation dans les derniers temps de
vie, est contestée et en voie d’être dépassée, particulièrement par la culture des soins
palliatifs. Nombre d’acteurs rencontrés veillent en effet à ce que le nutritionnel ne soit pas
dominant, éclipsant les autres univers alimentaires : le goût, l’identité et la socialité (Poulain
J.P., 2011).
La désirabilité des nourritures, des mets, des vins, et la sensorialité attachée aux préférences
ou aux dégoûts, réinstallent l’alimentation humaine dans ses dimensions socioculturelles.
L’accompagnement se fait alors attentif dans une pensée toujours relancée, qui ne peut jamais
se clore…
Bibliographie :
- Foley W. H., « Optimality theory in anthropology », Man, 1985, 20, 222-242.
- Garine I. de, « Contribution de l’anthropologie culturelle aux enquêtes pluridisciplinaires sur
l’alimentation », in Bien manger et bien vivre, Co-édition L’Harmattan ORSTOM, 1996, 23-
34.
- Poulain J-P., Sociologie de l’alimentation, P.U.F., 2011.
- Fassin D., L'espace politique de la santé. Essai de généalogie, P.U.F. coll. Sociologie
d’aujourd’hui, 1998.
* Cette recherche intitulée « Fins de vie. Plaisirs des vins et des nourritures », est rattachée à l’Espace Ethique
de l’AP-HP, Université Paris Sud-11, dans le cadre du groupe de réflexion « Questionner autrement le soin ».
Pour y participer, merci de me contacter : [email protected]m
1
/
2
100%