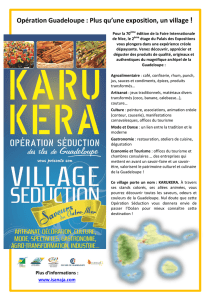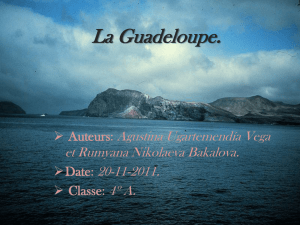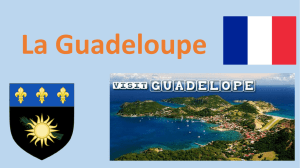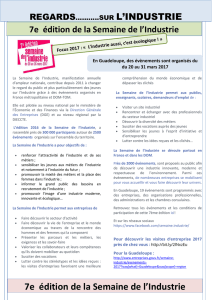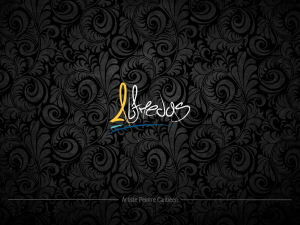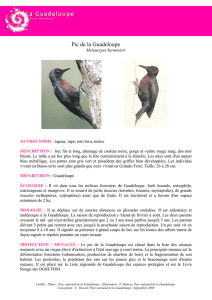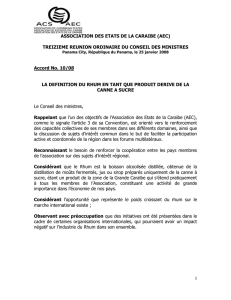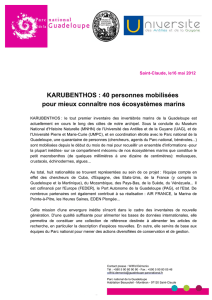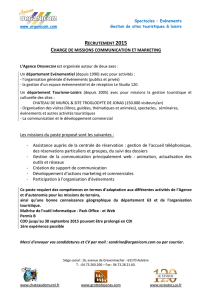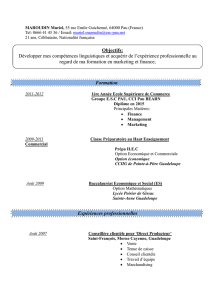80 - Veille info tourisme

1
1.0 Introduction
Les évènements sportifs de dimension internationale représentent des enjeux
économiques importants en raison de l’implication sur le terrain de divers acteurs, au
premier rang desquels figurent : les équipementiers sportifs, annonceurs, médias,
assurances, constructeurs, entreprises commerciales, institutionnels, comité du tourisme,
chambre de commerce, pays organisateur etc. Tous ces acteurs du <sport business>
élaborent des stratégies de marketing et de communication, mettent en place des
politiques de sponsoring, organisent sur place manifestations et animations diverses afin
de pouvoir bénéficier des retombées économiques qu’entraînent ces manifestations
sportives.
Comment alors identifier et apprécier au plan économique et social les véritables
retombées de tels évènements?, les pays d’accueil en tirent-ils réellement profit?, la
population locale se sent-elle véritablement concernée?. A ces interrogations majeures, il
convient de fournir des réponses claires. Pour nous aider, la route du rhum, célèbre
course transatlantique en solitaire, reliant tous les quatre ans depuis 1978 St Malo à
Pointe-a-Pitre est utilisée et analysée ici comme étude de cas pour déterminer à la fois le
poids de cette organisation ainsi que les impacts touristiques et économiques tels que : le
volume des visiteurs étrangers, les flux financiers, et surtout les incidences
macroéconomiques induites par ce type d’évènement. En conséquence, le bilan tiré de
l’expérience de la route du rhum après sa neuvième édition (novembre 2010) devrait
permettre de fournir des enseignements et indiquer si cet évènementiel sportif soutient
ou non le tourisme local et s’il peut-être considéré aujourd’hui comme un levier pour le
développement régional?
L’analyse des impacts économiques et sociaux des évènements sportifs a donné lieu dans
le passé à plusieurs publications et suscité nombre de controverses et débats. Des
évaluations grossières sont quelquefois réalisées avant même la tenue de l’évènement.
Les calculs sont assez souvent approximatifs et surévalués. Cependant, des contributions
récentes et pertinentes ont vu le jour, notamment celles de: J.J Gouguet, E. Barbe et B.
Lapasset (2010) qui, dans une analyse de recherche comparative ont mis l’accent sur des
études d’impact économique relatives à différents sports.
Soulignons également celle entreprise par J.J Gouguet et Barget sur l’analyse d’impact
économique de la coupe du monde de rugby de 2007. Ces auteurs utilisent comme
méthodologie les résultats d’une méta- analyse pour tirer la valeur des multiplicateurs des
régions impactées par l’évènement. Une méta-analyse a de même été employée par S,R.
Baaijens, P Nijkamp, et K.V Montfort (2000) pour estimer à partir d’un échantillon de 11
territoires (dont les Bermudes, les Bahamas, Kiribati, Tonga, Vanuatu, la Turquie..) la
valeur du multiplicateur de revenu touristique de l’île grecque de Lesvos. Les variables
explicatives introduites dans cet exemple ont été: le nombre d’habitants, la superficie, le
nombre d’arrivées de touristes, le pourcentage d’arrivées en provenance du plus
important pays émetteur, l’indice touristique, exprimé par le rapport du nombre de
touristes à la population locale, enfin des variables muettes ont été également intégrées
dans ce modèle telles qu’une variable géographique, prenant la valeur de 1 si la région
concernée est une île ou un archipel et 0 ailleurs, et une variable politique prenant la
valeur de 1 si la région en question est une nation indépendante et 0 ailleurs . Par ailleurs,
J. Fourie et M.S Gallego (11/10/2010) ont pour leur part utilisé un modèle de gravité

2
standard appliqué a 200 pays (dont la Guadeloupe et la Martinique) pour mesurer sur la
période 1995-2006 les bénéfices directs liés à des méga-évènements sportifs. Rappelons
que les modèles de gravité représentent les flux bilatéraux (ici les arrivées de touristes)
entre deux pays. Les variables explicatives employées dans ce modèle sont : le PIB par
habitant, la distance entre les pays pris deux à deux, l’existence ou non d’une frontière
entre eux, d’une langue commune ou non entre-eux, d’une monnaie commune, et
l’existence ou non de liens coloniaux entre ces pays. Quant à Burns et al (1986), ils ont
dans leur évaluation d’impact du grand prix d’Adelaide en Australie utilisé une analyse
coûts-bénéfices, en prenant en compte non seulement les impacts économiques mais aussi
des effets sociaux ou environmentaux comme le bruit engendré par cet évènement, les
temps perdus par les résidents dans les transports ainsi que les accidents routiers
occasionnés par la manifestation. Enfin, concernant la route du rhum proprement dite, la
seule évaluation d’impact économique connue à ce jour est celle réalisée en 2002 par la
chambre de commerce et d’industrie de Pointe-a-Pitre avec l’appui de la cellule Europe.
Cette évaluation présente une méthodologie axée sur les flux de dépenses, fournit des
données chiffrées sur les différentes contributions financières allouées par les organismes
officiels ainsi que leurs incidences notamment en termes de fréquentation. Cependant,
sans nier le mérite de cette étude, force est de constater qu’elle n’appréhende pas dans sa
globalité les différents aspects et impacts de l’évènement au plan macroéconomique.
Aussi, notre périmètre d’étude sera plus large et notre démarche méthodologique plus
rigoureuse afin d’apprécier le plus complètement possible les principaux impacts
économiques engendrés par cet évèment en Guadeloupe. Ce faisant, le présent document
est organisé comme suit:
La deuxieme section aborde le cadre analytique de l’étude avec comme point d’appui les
fondements théoriques appliqués aux principales études d’impact économique dans le
domaine sportif. Le soubassement théorique étant ici le choix des principales injections
dans la determination de l’impact.
La troisieme section est consacrée au calcul de l’impact économique régional et à la
méthodologie utilisée à cet effet, méthodologie qui suit une démarche séquentielle, qui
commence par l’analyse de l’impact de l’évènement en termes de fréquentation, avant-
pendant et après l’evenement, puis par celle des dépenses touristiques associées, pour
aboutir à l’application des principaux modèles d’impact économique.
La quatrième section introduit la synthèse des principaux résultats ainsi que les
enseignements y découlant.
Enfin, la cinquième section présente la conclusion générale de l’étude.

3
2.0 Le cadre analytique
L’évaluation de l’impact économique de tout évènement requiert un cadre qui tienne
compte de (1) la source des dépenses (2) l’identification du lieu d’émission de la dépense
(3) la destination de la dépense et (4) la raison de la dépense. Cette section a donc pour
but de fixer le cadre analytique à partir duquel s’établiront les fondements théoriques de
l’étude, et plus particulièrement les principaux contours du circuit économique spatialisé
de la route du rhum. Ce cadre conceptuel dans lequel devra s’inscrire le travail de
rassemblement des données et la recherche évaluative permettra d’identifier et
d’expliquer les différentes injections des dépenses effectuées à l’occasion de la route du
rhum , et d’être par la suite en mesure d’évaluer les effets directs, indirects et induits de la
dépense des visiteurs étrangers sur le territoire de Guadeloupe.
2.1 Fondements théoriques des études d’impact économique
En choisissant les évènements sportifs ou culturels à financer et le niveau de financement
à leur allouer, les gouvernements et autres autorités locales souhaitent souvent obtenir
une image complète des coûts de l’évènement mais aussi et surtout du retour sur
investissement qu’ils réalisent. Pour ce faire, ils entreprennent quelquefois des études
d’impact économique qui cherchent à identifier toutes les dépenses engagées dans les
différentes étapes de l’évènement, et de déterminer leurs retombées sur l’ensemble de
l’économie. Les impacts économiques d’un évènement proviennent selon Faulkner
(1993) de trois sources principales : (i) les dépenses effectuées par les visiteurs étrangers
(ii) les dépenses en équipements et infrastructures diverses (iii) les dépenses
d’organisation et d’animation.
Aussi, une étude d’impact économique a pour objectif d’estimer l’ampleur des revenus et
emplois locaux supplémentaires créés à l’occasion d’un évènement qui peut être sportif
ou non. Elle cherche à répondre à la question suivante: de combien l’activité économique
de court terme diminuerait dans une zone considérée si cet évènement n’existait plus dans
cette zone?, et dans le cas contraire, de combien cette activité augmenterait dans la zone
si l’évènement existait? (Y. Nicolas 2006). L’évaluation de ces impacts répond donc à un
besoin de rationalité et de transparence. En conséquence, un responsable politique ou
administratif doit chercher à connaître les conséquences de ses décisions ou de son action
de manière à en assumer toute la responsabilité. Autrement dit, il doit pouvoir répondre
aux questions suivantes : les ressources financières mobilisées par la politique ont-elles
été bien utilisées?, les résultats de la politique engagée sont-ils à la mesure des sommes
dépensées?. En clair, l’étude d’impact économique s’intéresse plus particulièrement à la
hausse nette de l’activité économique due aux injections externes en raison de l’existence
d’une manifestation donnée.
Par ailleurs, il faut admettre que l’évaluation des impacts économiques de grands
évènements sportifs donne quelquefois lieu à des controverses parmi les analystes. On
observe assez souvent des divergences entre les résultats de bureaux d’études qui
prévoient des retombées économiques très élevées et ceux notamment d’universitaires qui
revoient à la baisse de telles évaluations.
Ces résultats contrastés sont obtenus pour l’essentiel avec des méthodes liées à des
fondements théoriques différents. Pour notre part, afin d’éviter un certain nombre

4
d’erreurs de calcul, nous adopterons dans le cas de la route du rhum, une démarche
théorique spécifique adaptée à l’évènement, à savoir le choix approprié des principaux
flux du circuit spatialisé.
Le circuit économique de la route du rhum fait apparaître trois sources principales
d’injection et de fuites qu’il convient d’expliquer. Il s’agit des injections liées aux
dépenses d’organisation et d’animation, des injections relatives aux dépenses sur place
des visiteurs étrangers, et des dépenses d’investissement qui concernent principalement
certaines rénovations. Ces injections se traduisent en général en différentes dépenses qui
engendrent à leur tour des effets indirects et induits. Enfin, rappelons que dans le cadre
d’une analyse coûts-avantages, les subventions accordées par les collectivités publiques
pour financer ces dépenses sont considérées en termes économiques comme un coût pour
ces collectivités, mais comme un avantage pour les agents qui les recoivent. Ne pas tenir
compte de l’ensemble des coûts conduit à une surestimation incorrecte de l’impact. Il est
donc nécessaire de mettre en balance les coûts et les bénéfices dans l’analyse. Malgré les
difficultés à mesurer correctement les coûts et à les opposer aux bénéfices, ce type
d’analyse apparaît comme le plus recommendable pour informer le contribuable et aider à
la décision. Parmi ces coûts, il faut distinguer les coûts monétaires tels que: les
investissements dans les équipements locaux, les abattements fiscaux, les subventions
locales aux organisateurs ainsi que les dispositifs de sécurité publique (police,
gendarmerie, pompiers) associés à la manifestation. S’y ajoutent des coûts en termes
d’encombrement de voies, d’accidents de la route, de vandalisme, de dégradation
environnementale, d’hygiène publique etc..Une autre catégorie de coûts est celle intitulée
‘coûts de déplacement’, observé lorsque des visiteurs étrangers attirés par un évènement
y sont écartés soit parce qu’ils n’ont pas pu trouver d’hébergement, soit parce qu’ils ne
sont pas disposés à s’intégrer à la foule.
En conséquence, l’efficacité de toutes ces dépenses publiques doit être recherché à l’aide
d’une analyse coûts-bénéfices, destinée à évaluer leur retour sur investissement, mais
aussi leur retour sur experiences de manière à optimiser les retombées territoriales de
l’évènement et à les apprécier au plan économique, social et environnemental, et donc à
rechercher les limites de la manifestation au plan humain et environnemental. En deux
mots, il s’agit de déterminer les véritables effets multiplicateurs de ces dépenses.
2.1.1 Injections liées aux dépenses d’organisation et d’animation
Ces dépenses reflètent la spécificité de l’organigramme établi pour l’évènement. Un
groupement d’intérêt public (GIP) destiné à superviser l’organisation générale de la
manifestation peut être créé dans ce but, avec en parallele la mise en place dans la région
concernée d’un comité local de coordination ayant pour mission d’élaborer et mettre en
oeuvre les actions de valorisation. Dans le cas de la route du rhum, la structure de
financement est specifique et les fuites proportionnellement plus élevées que dans des
compétitions comme la coupe du monde football ou les jeux olympiques.
Pour sa 7eme édition (2002), la route du rhum avait comme organisateur et proprietaire
de la course, PROMOVOILE, et pour sa 9eme édition (2010), le groupe PEN DUICK qui
a repris l’organisation de la course depuis 2006. La Banque Postale en tant que partenaire
majeur exécutif de PEN DUICK est aujourd’hui associée à l’évènement. En 2002,

5
Promovoile s’etait adjoint les services de: Royale Production, délégataire de la gestion
sportive et responsable de la production audiovisuelle, et de Havas Advertising Sports
pour les activités de marketing et de communication. Le budget global consacré à cette
opération était de 5.2 millions d’euros. Au plan local, une quinzaine de partenaires y
étaient associés.
Selon la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-a-Pitre, la contribution financière
du conseil régional de Guadeloupe aux organisateurs de la course et aux manifestations
diverses s’élevait en 2002 à 1249 milliers d’euros. Les subventions du conseil régional
de l’époque se répartissaient comme suit:
Tableau 1. Route du rhum 2002: Subventions du conseil régional de Guadeloupe
Bénéficiaires
En k(euros)
Parrainage sportif
Parrainage du projet <Région Archipel Guadeloupe>
Animations locales
Ville de Pointe-a-Pire (Animations de Pointe-a-Pitre)
Image Prod’ (Animation nautique Darse en folie)
Communauté de communes de Sud Basse-Terre (Animations)
Animations à Saint-Malo
Staff and line (Animations culturelles)
Guadexport (Village artisanal Saint-Malo)
Avan Van du Moule (Animations carnavalesques)
Promotion touristique
Réalisation et diffusion d’emissions télévisées
Echanges culturels
Echanges socioculturels écoliers St-Malo/Guadeloupe
Association les Alizes: échanges entre Malouins et Saintois
TOTAL
352
352
254.6
94.6
80
80
98.2
60.5
30
7.7
81.2
81.2
13
7.5
5.5
799
Source: Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-a-Pitre. 2002
2.1.2 Injections liées aux dépenses des visiteurs
Il s’agit de dépenses de consommation effectuées sur place par les visiteurs étrangers. En
règle générale, seules les dépenses des visiteurs non locaux, dont le motif principal de
présence sur place est l’existence de la manifestation doivent être comprises dans
l’estimation de l’impact économique. Les dépenses des résidents locaux ne contribuent
pas à l’impact économique de l’évènement car elles représentent une remise en
circulation de sommes qui existaient deja dans la région, dépenses qui, localement
auraient eu lieu de toute facon pour divers motifs. Il y a par conséquent de la part des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%