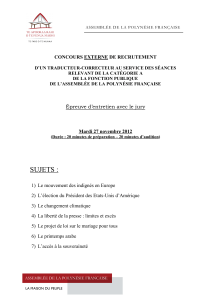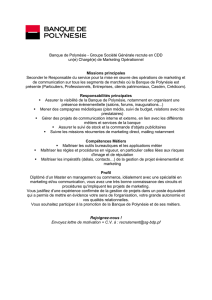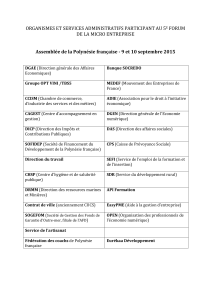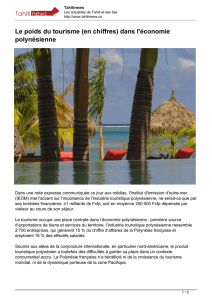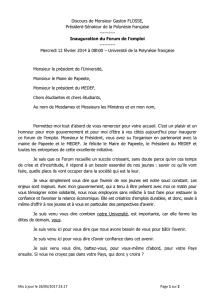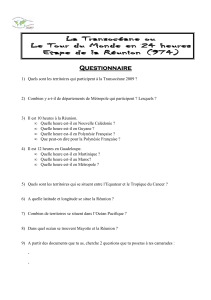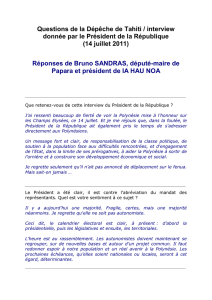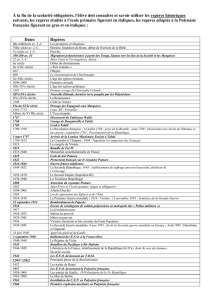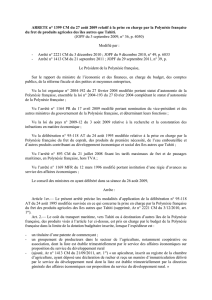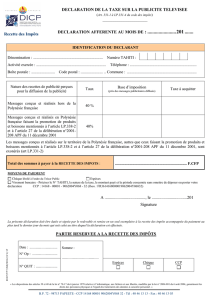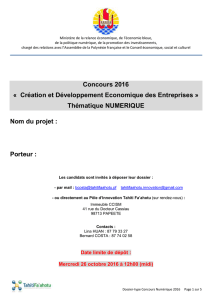TPE 2010-2011 TPE FICHE DESCRIPTIVE Nom des élèves

TPE
2010-2011
TPE
L’impact de l’environnement sur les relations socio économiques en
Polynésie française

2
FICHE DESCRIPTIVE
Nom des élèves associés aux TPE :
- Elèves du Lycée Paul Gauguin de Papeete
Equipe des enseignants associés
- Histoire géographie
- Sciences économiques et sociales
Thème :
L’homme et la nature.
Sujet :
L’influence de l’environnement sur les relations socio-économiques en Polynésie
française.
Problématique :
Quel est l’impact de l’environnement polynésien sur les choix
économiques des acteurs ? Comment l’environnement peut-il aussi
affecter les relations sociales en Polynésie française ?
Production choisie : diaporama.
Établissement : Lycée Paul Gauguin
Année scolaire : 2010 /2011
GE/LPG 6

3
TPE
SOMMAIRE
Parties
Pages
Fiche descriptive
2
Plan
3
Introduction
4
Partie I : L’environnement polynésien influence les choix économiques des
acteurs locaux.
4
Sous Partie I1 : Il est utilisé pour la production de biens.
4
Bloc 1: Ils servent à l’économie locale.
4
Bloc 2: Ils sont aussi exportés
5
Sous Partie I2 : Il concerne tout autant les services.
6
Bloc 1: IL est centré principalement sur le tourisme.
6
Bloc 2: Les activités proche de la nature sont tout autant conservés.
7
Partie II : Les relations sociales sont influencées à leur tour par
l’environnement.
8
Sous Partie II1 :L’environnement influe sur le caractère de la population.
8
Bloc 1: Le cadre des îles entrainent une certaine tranquillité de la population.
9
Bloc 2: Cette tranquillité est cependant teintée d’une atmosphère festive.
9
Sous Partie II2 : IL est aussi sources de liens sociales.
10
Bloc 1: Ce lien est présent au sein des activités productives.
10
Bloc 2: Les activités proche de la nature créent des liens sociaux.
11
Conclusion
11
Annexes
12
Annexe 1 : questionnaire vierge
13
Annexe 2 : calcul
14
Lexique
15
Bibliographie
16
Synthèses personnelles
18
Synthèse élève : Naomi
19
Synthèse élève : Juliette
22
Synthèse élève : Maramahiti
24
Les termes et expressions dans ce TPE marqués du sigle (*) seront explicités et/ ou définis dans un lexique.

4
Introduction : Quant on parle de l’environnement, nous faisons référence à l’ensemble des conditions
naturelles, comme la mer, qui agissent sur les hommes et leurs activités. Par exemple en Polynésie
française l’environnement marin va influencer les hommes à pratiquer des activités aquatiques et marines
comme la production de perles. Le milieu naturel a une influence sur les choix économique des décideurs
locaux. Nous pouvons parfaitement le voir dans notre vie de tous les jours. Tous les pays du monde ne
possèdent pas la même économie, pour la simple raison que tous les pays détiennent des ressources
naturelles différentes qu’ils exploitent plus ou moins. Pour approfondir l’influence de l’environnement sur
les relations socio-économiques en Polynésie française, nous allons répondre à deux questions. Quel est
l’impact de l’environnement Polynésien sur les choix économiques des acteurs ? Et comment
l’environnement peut-il aussi affecter les relations sociales en Polynésie française ? Nous allons dans un
premier temps répondre à la première question en exploitant le fait que l’environnement est utilisé pour la
production locale et dans un second temps montrer qu’il concerne aussi les services. Pour répondre à la
deuxième question nous allons voir que l’environnement est aussi source de liens sociaux.
I) L’environnement polynésien* influence les choix économiques des
acteurs locaux.
1) Il est utilisé pour la production de biens.
Ils servent à l’économie locale.
La Polynésie française possède plusieurs produits locaux qui sont reconnus dans ses îles et dans le
monde entier. Les produits les plus connus, comme la perle, la vanille mais aussi le jus « rotui »
ananas favorisent l’économie locale, non pas seulement par le fait que ces trois produits sont
exportés, mais aussi par leurs ventes et tout autre bienfait sur l’économie du territoire. La vanille et
le rotui ananas participent à l’entrée des devises dans notre économie. Mais le pilier* économique
de la Polynésie française est la perle. L’histoire démarre en 1993 quand une taxe d’exportation
s’est mise en place sur toutes les perles exportées. Cette taxe permet d’alimenter à la fois le
budget du pays (65% des recettes fiscales) mais aussi de financer la promotion de la perle (35%
des recettes fiscales).C’est de cette façon que la perle est devenue le pilier de l’économie locale.
On peut dire que le résultat fut en 2003 convainquant car les recettes destinées au budget du pays
étaient de 1,3 milliards F CFP provenant uniquement de la taxe sur la perle. Concernant la vanille
elle participe à l’économie locale. C’est un produit qui possède une importante production, soit 43
tonnes en 2004. Cette production connut en 1964 une importante baisse de 79 tonnes qui continua
jusqu’en 1984. Mais de 1994 à 2004, la production a augmenté de 30 tonnes. Le facteur qui peut
expliquer cette augmentation serait que depuis 1994 la vanille aurait plus de popularité au niveau
des acheteurs. La vanille provient principalement des îles Huahine, Tahaa et Raiatea. Ces trois îles

5
sont les premiers importateurs à Tahiti, l’île principale de la Polynésie. C’est donc ainsi que la
vanille contribue comme elle peut l’économie du Fenua.
Quant au rotui ananas, c’est un produit local portant aussi l’image de la Polynésie française
puisque celui-ci est un jus qui possède une production de 1500 tonnes par an. Donc on peut
supposer que si sa production est aussi importante et que les planteurs d’ananas souhaitent obtenir
encore quarante hectares pour plus de production, les ventes doivent être importantes. Grâce à sa
surface cultivée de 100 ha et son nombre de production, elle crée des emplois. On parle alors
d’une cinquantaine de planteurs que l’entreprise « jus de fruit de Moorea »a besoin.
C’est donc par ses ventes et ses créations d’emplois que le jus rotui ananas intervient dans
l’économie locale.
En conclusion la perle, la vanille et le rotui ananas sont trois produits locaux de la Polynésie
française portant son image. Ces trois produits jouent un rôle important dans l’économie mais
c’est la perle qui reste le pilier de l’économie.
Ils sont aussi exportés.
L’exportation des biens de l’environnement polynésien subit une importante baisse. C’est le
secteur agro-alimentaire le plus concerné. Malgré cette décroissance, on peut constater que la
Polynésie française possède toujours d’importants acheteurs.
Tout d’abord exporter* signifie le fait de vendre à l’étranger une partie de la production de biens
d’un ensemble économique, d’un pays ou bien encore d’une région.
Sur la tendance générale les exportations du domaine de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentaire
sont en chute de 0,94 (k= 16500cfp/17500cfp=0,94)
Cela est principalement dû à la demande mondialisée des pays extérieurs, comme les pays
d’Europe et les pays des États-Unis, qui s’affaiblit en raison de la crise économique. La deuxième
explication qui justifierait les réductions pourrait provenir du fait qu’à l’échelle mondiale, nos
produits locaux ne sont pas concurrentiels par rapport aux autres. Si l’on regarde les choses de
plus près, on peut s’apercevoir que ces amoindrissements ont commencé à partir de 2005. De 2004
à 2005 les exportations avaient augmenté de 1,17 (k=20000cfp/17500cfp= 1,17) alors que de 2005
à 2007, elles ont chuté de 0,85 (k=17000cfp /20000cfp=0,85) mais on peut remarquer une faible
stabilisation de 2007 à 2008 de 0 ,98 (k=16500cfp/16800cfp=0,98)
Néanmoins, ces produits disposent d’importants acheteurs comme Hong Kong et le Japon qui se
sont pendant longtemps disputés la première place. Mais ce fut à Hong Kong que revint le titre.
Puisqu’en 2004, le Japon importait 5500 F cfp de perles brut et Hong Kong 3800 F cfp. Mais en
2008 les rôles s’intervertir, le Japon importa alors 2500 F cfp de perles brut pour 7000 F cfp de la
part de Hong Kong. En prenant en compte tous les acheteurs entre 2004 et 2008, la baisse fut de
1900 F cfp soit de 10,8%. A Hong Kong la majorité de perles achetées se fait par des grossistes*.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%