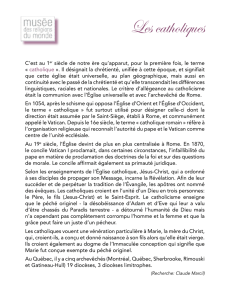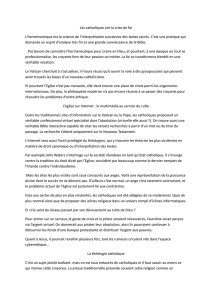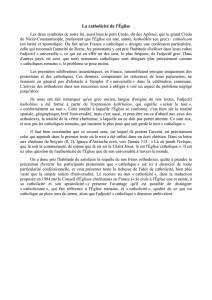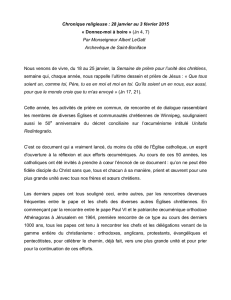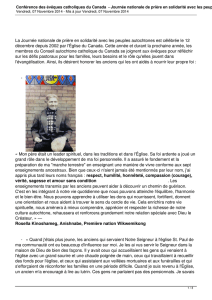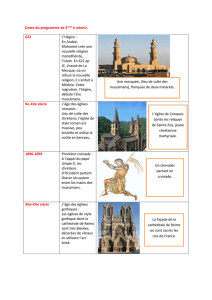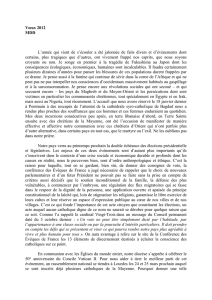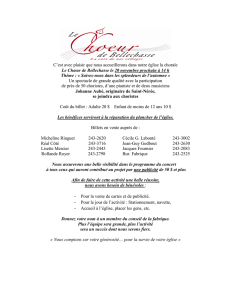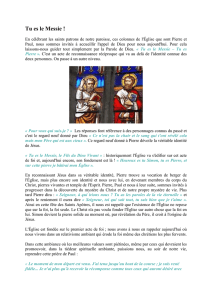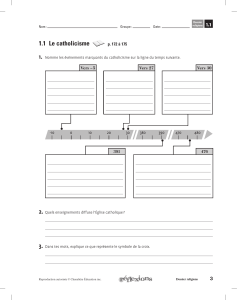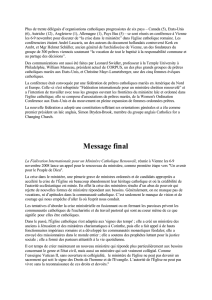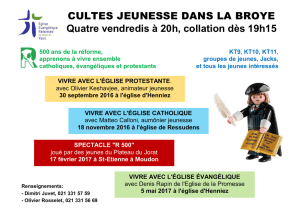Notes sur les 3 conférences du Pasteur Michel

Pasteur Michel Leplay : éléments-clé de la première conférence (15/10/05)
« Le Groupe des Dombes »
- Le fondement de la démarche du Groupe : ouverture et écoute de la conviction des
autres. On se dit tout sans arrière-pensées – avec humour, pour ne pas se prendre trop
au sérieux – mais rien n’est réprimé !
- Vie liturgique intense pendant les sessions de septembre du Groupe : « l’oecuménisme
doit être ruisselant de prière » (Paul Couturier).
- L’objectif du Groupe des Dombes : recoudre le tissu ecclésial déchiré au 16ème siècle.
Cela veut dire : travailler les « grands thèmes diviseurs » entre catholiques et
protestants, dans un souci essentiellement ecclésial et pastoral.
Nota : Le Groupe ne s’est jamais préoccupé des problèmes éthiques.
- Les catholiques ont un christianisme essentiellement ecclésial ; pour les protestants,
L’Eglise est moins une institution, mais plutôt une culture, une manière d’être…
Nous devons tous tendre vers une « conversion », une remise en question de notre
conception de l’Eglise, dans un souci pastoral et missionnaire ; créer un « consensus
différencié œcuménique » sur ce point.
- Les trois éléments de base de l’œcuménisme :
nous sommes tous « enfants de Dieu » (le Notre Père) ;
nous disposons d’une source commune : l’Ecriture Sainte ;
« je crois, nous croyons » : nous avons un « symbole » commun de la Foi.
Pour atteindre la réconciliation pleine et entière, l’idéal serait d’écrire ensemble
notre Histoire dans un climat de « juste mémoire » (comme cela a été fait en Suisse) .
Paul Ricoeur l’a bien exprimé : faire « mémoire » donne la possibilité d’une politique
de pardon ; il y a aussi le « souvenir » dans lequel les différends secondaires sont
oubliés !
- Le texte du Groupe de 1991, « Pour la Conversion des Eglises », reste d’actualité :
la Communion entre Eglises est fondée sur notre identité chrétienne commune,
l’identité de notre baptême ! Elle dépasse nos identités ecclésiales ou
confessionnelles distinctes ;
« Convertir » ces identités distinctes implique une conversion au Christ et à lui
seul : revenir à Jean-Baptiste, à Nicodème, répondre à la question « pour vous
qui suis-je ? »…
Elle implique pour tous une nouvelle conception de l’Eglise de Dieu, Corps du
Christ, Temple de l’Esprit !
…et de prendre la mesure de ce qui est essentiel et de ce qui est secondaire !
Certaines « réalités disciplinaires », acceptées par les uns et refusées par les
autres (célibat, agenouillements, crucifix, etc ) sont secondaires par rapport à
ce qui nous unit de façon essentielle
- Dans l’Evangile, Jésus n’a jamais donné un « catéchisme » : Je SUIS le Chemin , la
Vérité et la Vie…
Corollairement, la vérité que je confesse dépasse infiniment ce que je peux en dire !
- Le Pasteur Michel Leplay conclut sur Ep 5, 20-21 (et suivants) : notre action de
grâces doit être constante…la relation conseillée par Paul entre époux n’est-elle pas
applicable à la relation entre nos Eglises dans leur diversité ?
« J’écoute, Seigneur et me mets sous ta Parole ».

Pasteur Michel Leplay : notes sur la 2ème conférence (05/11/05)
« Un seul Maître », l’autorité doctrinale dans l’Église.
Survol « en hélicoptère » de l’ouvrage architecturé du Groupe des Dombes.
1. Le titre : (avec une majuscule à Maître)
Issu du verset 8 du ch. 23 de Matthieu :… « car vous n’avez qu’un seul Maître ». Par
opposition au « rabbi » qui veut dire « maître d’école, enseignant ». Nous sommes
tous appelés à être enseignants, mais il n’y a qu’un seul Maître qui donne les réponses
et enseigne la Vérité.
Le ch. 23 est au surplus trinitaire : un seul est votre Père qui vous accueille, un seul est
le Fils qui enseigne, le seul Esprit guide l’Église de siècle en siècle…. car vous êtes
tous frères.
Le livre traite de l’Autorité doctrinale DANS l’Église et non DE l’Église. Autorité de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ferme et douce, convaincante, qui accueille et
conduit. Il y a trois aspects de l’Autorité dans l’Écriture : l’Autorité qui enseigne et
parle en vérité ( Moïse et les prophètes), l’Autorité paternelle qui reçoit dans la
Maison, l’Autorité spirituelle qui nous dit : « vous êtes tous frères rassemblés dans une
communion fraternelle ».
2. L’autorité est en crise :
La crise évidente de l’autorité dans le monde touche aussi les Églises. Elle affecte et
infecte les pays occidentaux. Elle s’exprime bien en fait par 4 mots anglais :
- les identités sont brouillées par la tendance à effacer les frontières ; domine
alors une tolérance molle et sensible, « SOFT » :
- en réaction, les intégrismes durcissent les identités, raidissent les références,
forment des clans rigoureux, « HARD » ;
- ce que l’on croit est réduit à un sentiment intérieur et privé ; toute formulation
externe est repoussée ; on mesure les croyances par sondages : c’est « OUT » ;
- mais tout le monde est pour la paix, et toutes les croyances, en final, se valent,
pourvu que l’on soit sincère et tolérant : on est écolo et on est « IN »…
3. La foi confessée en Église :
La foi véritable se confesse, s’exprime et se traduit explicitement sous différentes
formes dans le cadre d’une tradition. Chez les catholiques, plutôt sous la forme de
dogmes permanents, promulgués, à vocation universelle ; chez les protestants, sous
forme de doctrines proposées.
Mais la foi est enseignée et vécue à la fois par catholiques et protestants sous deux
registres qu’expriment bien deux formules latines :
- « FIDES QUAE», la foi qui croit, celle des enfants, celle de ceux qui s’aiment ;
--« FIDES QUA », la foi qui est crue, celle qui s’exprime, qui n’est pas seulement
une idée mais une personne, Jésus le Christ ou bien le Dieu D’Abraham, Isaac et
Jacob.
La révélation en est particulièrement claire dans les deux questions adressées par
Moïse à Yahweh dans leur fameuse rencontre d’Exode 3 :

- « Qui es-tu ? » : Moïse, dans sa confiance aveugle d’enfant, reçoit la réponse « Je
suis, celui qui suis… » ;
- «Que vais-je dire au peuple ? » : on lui demande de transmettre une connaissance
explicite, d’invoquer « le Dieu de nos pères, le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob ».
De nos jours ces deux attitudes s’expriment dans les deux textes fondamentaux
unissant tous les chrétiens :
- le Notre Père, expression de la foi qui se confie ;
- le Credo, expression, à la suite des Apôtres, de la foi confiante qui se confesse.
4. Nos références communes :
L’autorité doctrinale a longtemps appartenu aux conciles, surtout dans les premiers
siècles. Par eux le peuple déléguait et « recevait » l’autorité doctrinale. Peu à peu le
Magistère a empiété sur les conciles. Au 16ème siècle les Réformateurs ont contesté
cette dérive.
Mais, par la suite, les positions se sont durcies de part et d’autre : « infaillibilité
pontificale « (1870), du côté catholique et « symbolo-fidéisme » relativisant, du côté
protestant. Plus l’un devenait raide, plus l’autre se faisait mou…
Heureusement, un recentrement s’est opéré à partir du début du 20ème siècle grâce au
mouvement œcuménique : il a permis que voie le jour en 1975 un texte de
convergence, le « BEM », et que les accords récents situent les divergences dans le
cadre de « consensus différenciés »
Un renouvellement fondamental est résulté par ailleurs du Concile Vatican II. Une
promesse théologique importante se trouve dans le décret du 21 novembre 1964 sur
l’oecuménisme qui précise en son § 11 la manière d’exprimer les vérités de la foi. Il
faut « exposer clairement la doctrine intégrale » et « expliquer la foi catholique de
façon plus profonde et plus droite dans un langage compréhensible pour les frères
séparés ». Le texte admet par ailleurs qu’il existe un ordre et une hiérarchie des vérités
dans la foi catholique.
Trois références communes sont désormais acceptées par tous pour exposer et
exprimer la doctrine de la foi :
- l’Écriture Sainte : la Traduction Œcuménique de la Bible est plus qu’un produit
culturel ; elle a été établie dans une exigence théologique afin d’assurer la
convergence de lecture (à titre d’exemple, il y a dans la TOB 150 lignes de
commentaire pour quelques versets de Romains 1) ;
- le primat de la conscience personnelle, reconnu par toutes les Églises ; chaque
chrétien est responsable de ses réponses devant Dieu et devant ses frères ;
- l’accueil et l’accord des différentes communautés aux formules de foi
proposées pour tous : il existe aujourd’hui un consensus de tous les chrétiens sur
ce qu’on peut appeler « la foi de l’Église » ; il trouve son fondement dans
l’autorité de l’Écriture, la confession de foi commune, les ministères constitués et
deux sacrements. Ce consensus a produit le B.E.M., l’accord luthéro-catholique
d’Augsbourg, la charte œcuménique européenne signée par toutes les confessions.
Il est enseigné dans toutes les Églises.
5. L’articulation différente des valeurs qui font autorité dans les Églises :
Entre protestants et catholiques subsistent toutefois des conceptions opposées de la
façon dont sont définies les vérités à croire.
Le Groupe des Dombes a constaté que les ministères d’autorité doctrinale s’exercent
de trois façons : personnelle, collégiale et communautaire.

Au plan personnel, pour le protestant, le sujet croyant est primordial : c’est le « Je »
proclamé par Luther.
Du côté collégial, les églises locales protestantes exercent l’autorité dans le cadre d’un
système de direction dit « presbytéro-synodal », comprenant une responsabilité locale
complétée par le recours aux synodes « nationaux ». Le problème est qu’il n’existe pas
encore de « synode » commun aux luthériens, aux réformés et aux baptistes… Mais
les protestants réalisent que, même s’ils vivent une dispersion sur la façon d’exprimer
l’autorité, il faut, pour la régulation de la foi, un échelon de décision à un niveau plus
que local,- et peut-être même plus que national.
Jusqu’ici, chacun garde ses méthodes de décision et avance à son rythme : exemple de
la décision d’appeler des femmes au ministère pastoral prise en 1925 en Alsace-
Lorraine luthérienne et seulement en 1965 chez les Réformés de France.
A l’inverse, le mode de proclamation du dogme de l’Assomption par Pie XII en 1950,
raide, précis et rigoureux, est très choquant pour protestants et orthodoxes !
Image : pour le moment, les protestants, c’est un village de maisons distinctes où
vivent des frères croyants, et les catholiques, c’est une cathédrale où est rassemblé un
peuple adorant…
6. Le témoignage de l’Écriture :
La façon de s’exprimer sur l’autorité diffère selon les auteurs des livres du Nouveau
Testament : ils s’adressent en effet, à des époques différentes, à des auditoires
différents, avec des soucis pastoraux différents ; approches et perspectives varient
donc.
Le livre du Groupe des Dombes analyse , par suite , les différences sur le sujet entre
les « synoptiques » (Mt et Mc, puis Lc), les épîtres pauliniennes, les épîtres pastorales
et le canon du Nouveau Testament.
Dans l’évangile de Matthieu sont relevés les textes suivants relatifs à « l’autorité de
Jésus » : Mt 7,28-29, Mt21,23-27, Mt13,53-54. Ce qui frappe, dans cet évangile c’est
la coïncidence et la cohérence parfaites entre ce que Jésus dit et fait et ce qu’il est. Il
dit ce qu’il fait et est ce qu’il dit et fait. Personne ne résiste à cette autorité. Et cette
autorité , il la transmet à ses disciples : Mt18,18.
Dans les textes de Luc (évangile et Actes) cette transmission est particulièrement mise
en valeur : Lc10, 16 (« qui vous écoute m’écoute ») ; l’envoi de l’Esprit authentifie
l’autorité des apôtres ; ces derniers donnent toujours un témoignage collégial et
communautaire de leur autorité, même si un seul (Pierre) exprime parfois l’avis de
tous.
Est particulièrement intéressant le chapitre 15 des Actes relatif au concile de
Jérusalem (soumission des païens aux rites juifs), tant il reste actuel dans nos Églises.
Les apôtres y témoignent de leur ministère. Un consensus se forme avec l’aide de
l’Esprit sur la décision à prendre. Cette dernière est répercutée par une lettre adressée à
toutes les Églises et portée par tel ou tel apôtre pour bien assurer sa « réception ». Il y
a là une régulation de l’autorité tout à fait extraordinaire : autorité de l’Évangile, de
l’Esprit et de la communauté des frères !
Dans nos Églises d’aujourd’hui il y a certes des hiérarchies formelles et
psychologiques mais ,devant Dieu, nous sommes tous frères : chacun est responsable,
comme à Jérusalem alors.
Dans les épîtres pastorales de Paul, il est surtout question de transmettre un « bon
dépôt » à la génération suivante, de confier des ministères à des personnes
exemplaires. Tout est très précis, circonstanciel et inscrit dans des réalités quotidiennes
concrètes.

Dans les écrits johanniques, seule compte l’autorité du Christ et, dans la communauté
active, l’autorité de l’Esprit : on y trouve une vraie « pneumatologie ». Mais, en
définitive, pour Jean, la vraie autorité , c’est l’Amour !
Nota : à propos de l’autorité de l’Esprit, on pourrait dire aujourd’hui, en caricaturant,
que le rôle de l’Esprit est particulièrement « reçu » chez les orthodoxes , alors que
chez les protestants l’Esprit est un peu remplacé par l’Écriture et que chez les
catholiques c’est souvent l’Église qui prime…
En résumé et en simplifiant, Matthieu insiste sur le Christ et le premier des apôtres,
Luc sur l’importance de la collégialité des 12 ; pour Paul c’est l’Évangile qui fait
autorité et pour Jean c’est le Saint-Esprit.
Conclusion :
- Il y a dans nos Églises une évidente diversité dans les sources de l’autorité doctrinale.
- L’autorité de Jésus enseigne, agit et pardonne ; elle est toute entière consacrée à la
proclamation du Règne de Dieu.
- Jésus confie son autorité aux disciples, mais ne l’abandonne pas. Nous sommes,
quant à nous, les serviteurs de la mémoire, rien de plus.
- La vraie force de l’autorité, c’est le service. L’autorité chrétienne est servante, c’est
le sens du mot « ministre », du mot « diacre ».
- C’est en fonction de la mission que l’autorité servante est instituée et établie.
Pasteur Michel Leplay, Père Bernard Sesboüé s.j.
3ème Conférence sur le livre du Groupe des Dombes :
« Un seul Maître »
Cathédrale d’Evry. 3 décembre 2005.
Le Pasteur Michel Leplay, premier orateur, insiste, tout d’abord, sur l’intérêt de
commenter « à deux voix » (catholique, protestante) le livre du Groupe des Dombes sur
l’autorité doctrinale dans l’Église.
Il rappelle la structure du livre :
chapitres I et II sur les enseignements de l’histoire ;
chapitre III sur l’Écriture, lieu de discernement ;
chapitre IV sur les propositions doctrinales ;
un dernier chapitre de propositions pour la conversion des Églises.
DEUX CHAPITRES HISTORIQUES :
Ils concernent respectivement « l’Église ancienne et médiévale » et « la Réforme et les
temps modernes », avec césure au 16è siècle. Le groupe des Dombes n’a pas voulu, là, faire
de l’histoire pour l’histoire, mais expliquer les malentendus successifs, reconnaître la fidélité
de Dieu à son Église et assurer une vigilance mutuelle et fraternelle par rapport à ce qui est
arrivé…
Le premier chapitre évoque tout d’abord, en deux sections, la période des Pères de
l’Église : les 3 premiers siècles débouchent ensuite sur le Concile de Nicée et les grands
conciles orientaux qui marquent un tournant dans la manière dont l’Église s’y prend avec elle-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%