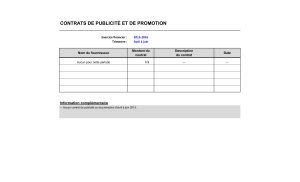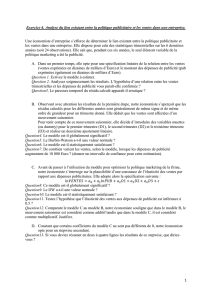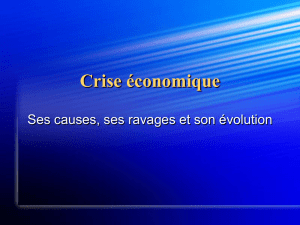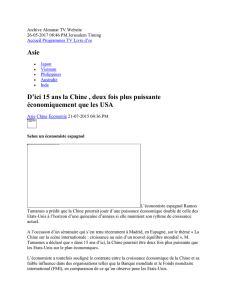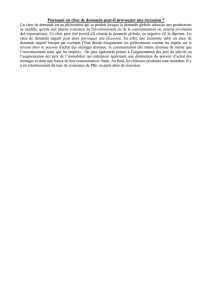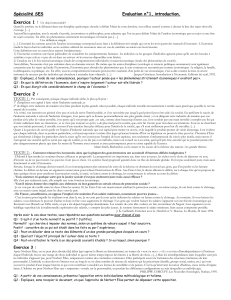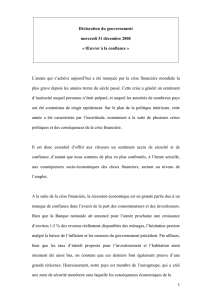Le Monde, 22 août 2009

Le Monde, 24 juillet 2009
En route pour les " trente glorieuses "
1er décembre 1949 : la fin des tickets de rationnement, cinq ans après la Libération, ouvre enfin une nouvelle
ère d'abondance pour les Français
Aucune liesse particulière ne semble avoir rassemblé les Français ce jeudi 1er décembre 1949. Et
pourtant, ce jour fut celui de la fin d'un symbole majeur de la seconde guerre mondiale, mais aussi de
l'après-guerre : celui des tickets de rationnement. Ces derniers, instaurés à l'automne 1940, perdurèrent en
effet plus de quatre ans après la fin des hostilités.
En titrant sur trois colonnes à la " une " l'étude de " la mise en vente libre du sucre, de l'essence et du café
" par le conseil des ministres, Jacques Fauvet avait pressenti que ce 1er décembre 1949 était une date-clé,
qui marquerait le basculement d'une économie de pénurie vers une ère d'abondance - les " trente
glorieuses ", période économiquement faste.
Les événements ultérieurs lui ont donné raison, même si un bémol apparaissait dès l'édition du lendemain
: il faudrait attendre un peu pour que le café ne soit plus rationné, en raison de " vives tensions sur les
marchés internationaux ". Cette restriction n'empêcha pas ce même conseil des ministres du 1er
décembre de supprimer le haut-commissariat au ravitaillement, " définitivement liquidé le 31 décembre ".
Une décision discutée : le commissariat occupait encore 8 200 fonctionnaires en mars 1949 (contre 21
800 en 1946), peut-on lire dans Le Monde du 4 mars 1949.
Les " trente glorieuses " font oublier une partie de la réalité. Le pays libéré en 1944 était dans un état
calamiteux. " Le quart du capital immobilier est détruit ; les réseaux de transport disloqués, les réseaux
électriques gravement endommagés, les mines de charbon également ", rappelle Cyrille Sardais,
professeur adjoint à HEC Montréal, dans son mémoire sur " Les pénuries de l'immédiat après-guerre en
France ".
France colbertiste
Confronté à une telle situation, le maintien d'une répartition autoritaire des quantités et des prix des
ressources disponibles, et donc des tickets de rationnement, s'imposait. A défaut, les prix des aliments
auraient flambé, entraînant une pénurie ; ou alors, pour être sûrs d'être servis, les habitants auraient passé
leur temps à faire la queue devant les commerces, solution peu judicieuse quand la main-d’œuvre est
nécessaire pour reconstruire le pays. Conséquence : la carte de pain, supprimée en mai 1945, est rétablie
dès le mois de décembre de la même année, pour n'être supprimée que le 1er février 1949. En août 1947,
" la ration de pain est à son plus bas niveau depuis 1940 ", rappelle l'historien Fabrice Grenard, dans La
France du marché noir (Payot, 2008).
Les restrictions ne visent pas seulement les biens alimentaires. Jusqu'en avril 1949, il faut une licence
pour acquérir une automobile. Ce qui n'empêche pas d'avoir à attendre deux ans pour obtenir sa voiture !
Car tout fait défaut : la tôle, les pneus, l'énergie pour faire tourner les usines. Une auto est un bien rare,
mais d'un prix abordable, car fixé par le gouvernement. Une voiture d'occasion, qui peut être achetée sans
licence, coûte plus cher qu'une neuve !
Cette focalisation des moyens de l'Etat sur l'industrie automobile, considérée comme un moteur de la
croissance, se fait au détriment de la construction de logements, qui manquent cruellement. Cela conduit
là aussi le gouvernement et les élus à intervenir, en votant, en septembre 1948, la loi, désormais bien
connue sous le nom de " loi de 1948 ", imposant une échelle de loyers, et dont bénéficient encore certains
locataires aujourd'hui.
A partir du 3 avril 1948, date de la signature du plan Marshall, la situation s'améliore. Les 2,7 milliards de
dollars accordés à la France par les Etats-Unis permettent d'importer blé, charbon, machines et tracteurs,
entre autres, et de relancer l'économie. Dès le début de 1949, les bonnes nouvelles se multiplient : le 1er
avril, la confiture et les pâtes sont en vente libre ; les produits laitiers suivront, le 15. A partir de mai,
seuls les produits importés restent rationnés. Les quantités ne sont plus fixées, mais les prix le resteront
pendant des décennies. Celui du pain ne sera libéré que le 1er décembre 1986.
Tout cela ne fera qu'exacerber l'image d'une France colbertiste, où les gouvernements pèsent de tout leur
poids sur les décisions économiques. Où les dirigeants de groupes longtemps publics étaient aussi des "
grands serviteurs de l'Etat ", souvent issus des grandes écoles publiques (ENA, Polytechnique...). Ceux-ci
finirent néanmoins par adopter les règles de gestion anglo-saxonnes, visant à accroître la valeur de

l'entreprise pour ses actionnaires - et pour eux-mêmes ! Et non plus en priorité à servir le pays et ses
habitants.
La crise financière actuelle et les dégâts écologiques de la société d'abondance pourraient remettre au
goût du jour ces " vieilles valeurs " que les ultralibéraux croyaient avoir envoyées au musée. La sortie de
crise passera par une utilisation plus rationnelle des ressources, et des " permis d'émission " de CO2. Mais
sans carte ni ticket. Pour l'instant.
Annie Kahn
Le Monde, 14 août 2009
Le PIB a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre
Une hausse surprise due au redressement de l'industrie automobile et au maintien de la consommation
Est-ce l'amorce d'une reprise encore ténue et la sortie progressive de la récession ? En dépit de prévisions
pessimistes, la croissance est redevenue positive au deuxième trimestre avec une augmentation de 0,3 %
du produit intérieur brut (PIB). Cette évolution est essentiellement due à l'amélioration du solde du
commerce extérieur.
C'est la première inflexion enregistrée depuis un an, selon les comptes publiés par l'Insee jeudi 13 août,
après les reculs de 1,3 % du 1er trimestre et de 1,5 % au dernier trimestre de 2008. " La France se
distingue de ses voisins. Elle est sortie plus tôt du rouge ", s'est aussitôt félicitée Christine Lagarde sur
RTL. La ministre de l'économie considère que : " Cette hausse conforte pleinement le gouvernement dans
sa politique économique en faveur de l'activité et de la compétitivité du pays. " Les mauvais indices du
début de l'année avaient conduit le gouvernement à tabler sur une récession de 3 % en 2009. Le constat
établi en août pourrait infléchir cette crainte, même si, assure-t-on à Bercy, les signes restent fragiles.
Après huit mois de baisse, la production de biens et services est repartie à la hausse, de l'ordre de 0,5 %,
grâce au redressement de l'industrie (+1,1 %). Le rebond est particulièrement spectaculaire dans
l'automobile qui, sous l'effet de la prime à la casse, enregistre une hausse de 5,6 % après une chute de 9,7
%. L'effet se répercute sur les exportations notamment vers l'Allemagne, qui a mis en place une prime à
la casse plus élevée qu'en France. Au total, le montant des exportations s'est amélioré de 1 % après une
chute de 7,1 % au premier trimestre.
La reprise est aussi liée au maintien du niveau de consommation des ménages qui a plutôt bien résisté
avec un rebond de 0,3 % au cours du trimestre et surtout de 1,4 % en juin, là aussi grâce aux achats dans
l'automobile. Autre effet positif sur a consommation : en juillet, les prix ont, pour le troisième mois
consécutif, poursuivi leur cycle à la baisse, de l'ordre de 0,4 %, selon les chiffres publiés mercredi. Sur un
an, la décélération atteint 0,7 %. Le repli de juillet est amplifié par la poursuite de la chute du prix des
carburants (-24,6 % en an) et l'effet des soldes.
En revanche, les hausses restent fortes dans le secteur des services (+2,3 % sur un an) avec celle
traditionnelle en juillet des loyers (+3,1 %). Selon l'Insee, la réduction de la TVA dans la restauration,
passée de 17,6 % à 5,5 %, se traduit par une baisse réelle de 1,3 % dans les restaurants de 0,7 % dans les
cafés.
" Il est difficile de parler de reprise avec certitude, car la hausse de la production industrielle est
essentiellement concentrée dans l'automobile. Le climat des affaires ne se redresse que progressivement
", tempère Benoît Heitz, chef de la division synthèse conjoncturelle de l'Insee. Les signes positifs du
deuxième trimestre ne sauraient atténuer les conséquences de la crise qui continent de peser. Selon
l'Insee, les capacités d'investissement des entreprises privées restent toujours en recul, de 0,9 %, mais le
repli était de 3,6 % à la fin de 2008.
Le marché de l'emploi devrait continuer de se dégrader et le taux de 10 % de chômage pourrait atteint
d'ici à la fin de l'année. Selon l'UNEDIC, 591 000 emplois pourraient être détruits en 2009. Le déficit des
finances publiques public s'est aggravé en début d'année à hauteur de 86,6 milliards d'euros, au lieu de
32,8 milliards lors de la même période de l'année précédente.
Malgré cette importante dégradation, Eric Woerth, ministre du budget, est bien décidé à ne pas varier de
cap. Il a réaffirmé mercredi que " le gouvernement ne prévoit évidemment pas d'augmentation d'impôt qui

conduirait à rajouter de la crise à la crise. " Selon lui, " les autres pays (...) ont des déficits bien
supérieurs. La vraie réponse, c'est de solliciter la croissance ". Le ministre table sur des " réformes
structurelles ", comme celle des retraites, des collectivités locales ou " le non remplacement d'un
fonctionnaire sur deux qui est une réponse directe à cette crise ".
Michel Delberghe
______________________________________________________________________
Les Echos, 31 août 2009
Les doutes grandissent sur la solidité de la reprise économique mondiale
La publication, désormais récurrente, de statistiques économiques encourageantes pousse les marchés
financiers à une euphorie qu'ils n'avaient pas connue depuis plus de deux ans. Pourtant, les économistes
pointent du doigt les nombreux risques qui pèsent sur la reprise.
Simple feu de paille ou retour durable de la croissance ? Depuis quelques semaines, l'optimisme s'est installé sur
la planète économique. Les indicateurs avancés de conjoncture surprennent les économistes agréablement, la
production industrielle se redresse, au point que certains pays, comme l'Allemagne, la France et le Japon, ont
affiché des croissances économiques positives au deuxième trimestre. Il n'en fallait pas plus pour doper des
marchés financiers habitués à la morosité depuis la mi-2007. Ayant retrouvé des couleurs en mars, ces derniers
atteignent actuellement des plus hauts sur l'année 2009. Nouvelle manifestation de l'exubérance irrationnelle des
marchés ou euphorie légitime ?
Pour Véronique Riches-Flores, qui dirige les études économiques à la Société Générale, il n'y a pas que de
l'irrationalité dans cette réaction d'enthousiasme. Compte tenu de la violence sans précédent du choc qu'a connu
l'économie mondiale, « de simples rebonds techniques vont conduire à des ajustements économiques rapides qui
nous surprendront positivement ». Après des mois de déstockage, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de
se remettre à produire, quand bien même ce serait à des niveaux plus faibles qu'avant la crise. Le secteur
automobile, dopé par les plans de relance y compris dans les pays émergents, agit aussi comme un accélérateur
de croissance. Trop conscients de l'importance du soutien à ce secteur, les gouvernements ne vont probablement
pas retirer du jour au lendemain leurs aides. Conclusion de Véronique Riches-Flores : « Nous allons connaître
quelques mois spectaculaires. »
« Une poussée d'adrénaline »
Mais les économistes sont unanimes à pointer les risques qui pèsent sur l'économie mondiale à moyen terme. Si
Pierre Cailleteau, le chef économiste de l'agence Moody's, n'en veut pas aux marchés de connaître « une poussée
d'adrénaline au moment où le monde découvre qu'après un choc majeur il est toujours vivant », il pointe du
doigt la question du crédit : va-t-il repartir ? Les dernières statistiques en provenance d'Europe ne sont pas
rassurantes sur ce point (« Les Echos » du 28-29 août). Or, sans reprise substantielle du crédit, l'investissement
ne pourra pas redémarrer et le secteur privé ne prendra pas le relais de la croissance.
Les ménages, de leur côté, risquent de ne plus être à la hauteur. Si leur consommation a remarquablement résisté
à la tempête au premier semestre, c'est « en bonne partie grâce à la désinflation » , note Sylvain Broyer, qui
dirige les études économiques chez Natixis. Le monde a profité de la baisse du baril de brut, qui a soutenu le
pouvoir d'achat dans un contexte où le chômage augmentait. Mais Véronique Riches-Flores a calculé que « le
pouvoir d'achat devrait repartir à la baisse dès le quatrième trimestre 2009 ». Car la désinflation touche à sa fin.
Les mois qui viennent verront les prix et le chômage repartir à la hausse. La consommation n'en sortira pas
indemne.
Enfin, la question des finances publiques est probablement la plus épineuse. Les Etats ont investi 2.900 milliards
de dollars, soit 5,3 % du PIB mondial, pour soutenir l'activité. Peu d'économistes critiquent cette injection
massive d'argent, tant elle était indispensable pour empêcher l'effondrement du système. Au moins ce scénario
catastrophe a-t-il été évité et c'est là « la véritable bonne nouvelle », estime Sylvain Broyer. Mais son résultat est
l'envolée de l'endettement public. Si certains pays, comme la Chine, ont de la marge en la matière, ce n'est le cas
d'aucun des grands pays développés. Plus dur sera l'ajustement. Pour Pierre Cailleteau, « cela va rendre encore
plus indispensables les réformes que les pays développés repoussent depuis vingt ans, comme celle des
retraites ».
Entre chômage élevé et diminution de la marge de manœuvre des Etats, le scénario qui se profile n'est pas
enthousiasmant. Reste éventuellement une planche de salut : la dynamique des grands pays émergents. Encore
faut-il remarquer que le rebond constaté en Chine, au Brésil et en Inde « tient beaucoup à la relance du secteur
automobile, qui est elle-même assez autocentrée et génère peu de flux commerciaux », constate Véronique
Riches-Flores. Conclusion de cette dernière : « Le pire est derrière nous... mais le plus dur est devant. »
GABRIEL GRESILLON

Libération, 11 août 2009
Une douce brise souffle sur la crise
«Décélération de la récession», «vitesse de contraction ralentie»… les analystes rivalisent de prudence et de
périphrases pour évoquer une éventuelle reprise. Il n’empêche, depuis le milieu de l’été, l’ambiance générale a
changé et la perspective d’une sortie de crise est évoquée par certains pour la fin de l’année. Méthode Coué ou
véritable tendance ?
Les raisons d’y croire
Ce sont surtout à des chiffres que les économistes s’accrochent pour déceler les bonnes nouvelles. Aux Etats-
Unis, d’abord. Le PIB fond toujours, mais moins vite (-1,5 % au 2e trimestre, contre -6,4 % le précédent), le
rythme des suppressions d’emplois ralentit. Et le taux de chômage connaît même une légère baisse. Barack
Obama, malmené dans les sondages, navigue entre satisfaction («Nous avons évité le pire au système financier»)
et prudence («Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir»).
Un groupe d’une cinquantaine d’économistes indépendants, auteur du Blue Chip Economic Indicators, est venu
ajouter hier une couche d’optimisme : 90 % d’entre eux misent sur la fin de la récession au 3e trimestre, la seule
vraie incertitude restant «la vitesse, la force et la durée de la reprise économique».
Et ailleurs ? L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) confirme une tendance à
l’amélioration dans les pays de sa zone, avec des «signaux de reprise plus forts en Italie et en France». Les
exportations allemandes ont enregistré leur plus forte hausse depuis trois ans. En Chine, la production a connu en
juillet son meilleur mois de l’année. Au Japon, le PIB repart, doucement, à la hausse. Rassurées par ces
indicateurs et une série de résultats d’entreprises encourageants, les Bourses mondiales rebondissent, atteignant
la semaine dernière leur plus haut niveau de l’année.
Automobile, banque : les dessous d’une reprise
L’activité industrielle montrerait-elle des signes de redémarrage ? Prenons le cas de l’automobile française : en
juillet, les immatriculations de véhicules particuliers ont affiché une progression de 3,1 % par rapport à
juillet 2008 (+2 % depuis le début de l’année). Vraie sortie du tunnel ou simple «reprise technique», comme
disent les économistes ? «Il y a un mouvement de stabilisation dans la crise, mais c’est un phénomène technique
de restockage, estime Nicolas Bouzou, économiste d’Asterès. Les stocks ayant beaucoup baissé dans le monde
ces derniers mois, les entreprises sont bien obligées de refaire des stocks.»
Une autre raison explique ce léger mieux : le succès de la prime à la casse, présente dans 15 des 27 membres de
l’Union européenne… et, depuis fin juillet, aux Etats-Unis. Mais elle n’est pas éternelle. En France, le secteur
appréhende déjà l’arrêt progressif de la prime, prévu à partir de janvier. Même si les gros du secteur se sentent
tirés d’affaire et en cours d’assainissement financier, la santé des petits sous-traitants est précaire. Christine
Lagarde, la ministre de l’Economie, le dit elle-même : ils «souffrent d’un manque de fonds propres» et auront
«des besoins en trésorerie accrus, probablement à la fin octobre». Côté finance, les bons résultats de certaines
banques françaises ou américaines (profits colossaux pour les quatre grosses du secteur : 2,7 milliards de dollars
- environ 1,9 milliard d’euros - pour JPMorgan Chase, 3,2 milliards pour Bank of America et Wells Fargo et
4,3 milliards pour Citigroup) ne doivent pas cacher la multitude des plus petits établissements. Les banques
régionales aux Etats-Unis par exemple, pour lesquelles la situation reste précaire, vue la montée des impayés…
qui pourrait atteindre ensuite les plus grosses. Enfin, les bénéfices des grands établissements sont essentiellement
dus à leurs activités de banque d’investissement, et donc aux marchés, et pas à l’activité de financement de
l’économie «réelle» : prêts pour les particuliers, pour les investissements des entreprises (lire page suivante)…
L’emploi reste le point noir
Ce fut la bonne surprise de juillet en France : une légère baisse (-0,7 %) du chiffre officiel des inscrits à Pôle
Emploi, soit 18 600 chômeurs de moins. De son côté, l’intérim a, en mai, légèrement augmenté par rapport à
avril (+2,8 %), après des mois de chute libre (mais il baisse tout de même de 29,9 % par rapport à mai 2008). Le
gouvernement lui-même a pris ces chiffres avec prudence. Décryptée, la hausse de juin est avant tout statistique
(Libération du 28 juillet). Ensuite, les récentes annonces de restructurations n’apparaîtront dans les chiffres que
dans deux, trois mois, une fois les négociations et les préavis achevés. Et les experts prévoient qu’à la rentrée de
nombreuses entreprises couperont dans leurs effectifs. «La fin 2008 et le début 2009 ont été marqués par une
forte destruction de l’emploi intérimaire, les entreprises faisant tout pour ne pas s’attaquer aux CDI», note
Marion Cochard, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Résultat, la
productivité française a baissé : -2,2 % contre +1,6 % en rythme annuel en temps normal. «Même si elles ont
déjà été conséquentes, les suppressions de postes n’ont donc pas encore été ajustées à l’ampleur de la récession.
La productivité est désormais tellement dégradée que les entreprises ne vont plus pouvoir éviter de supprimer

les CDI. On risque de voir une nouvelle vague de licenciements en septembre.» A tel point que l’OFCE, qui
avait tablé en début d’année sur une prévision de 550 000 emplois supprimés en 2009, compte revoir ses
prévisions à 650 000, voire 750 000 destructions pour ses nouvelles prévisions de septembre.
Le phénomène est identique aux Etats-Unis. Les suppressions d’emplois sont tombées à 247 000 le mois dernier,
contre 443 000 le mois précédent. Sauf que le porte-parole d’Obama lui-même, Robert Gibbs, n’exclut pas de les
voir remonter et dépasser la barre symbolique des 10 % de chômeurs - ce qui est déjà le cas dans quinze Etats -
d’ici à la fin de l’année. «Personne ne perd de vue qu’un quart de million de personnes ont perdu leur emploi le
mois dernier», recadre-t-il.
D’où viendra la reprise
Certains experts, tel Paul Jorion, considèrent que la reprise viendra de la Chine, qui affiche un taux de croissance
insolent en ces temps de disette (+7,8 %). D’autres la voient plutôt venir des Etats-Unis. «La Chine va bien, c’est
vrai, mais ça risque de ne pas durer, explique Nicolas Bouzou. Sa croissance n’a jamais vraiment ralenti. Donc,
beaucoup des déséquilibres qui nous ont plombés, nous Occidentaux, subsistent là-bas, la bulle immobilière par
exemple. Le ménage n’a pas été fait, les problèmes de l’économie chinoise sont donc devant elle. Pour moi, ce
sont les Américains les mieux placés pour rebondir les premiers. Du coup, l’Europe suivra, mais cela va prendre
encore du temps». Pour l’heure donc, le mot «reprise» est excessif. «"Moindre mal", c’est mieux», estime
Bouzou.
Service Economie
__________________________________________________________________________________________
Le Monde, 14 août 2009
La croissance française sera molle en 2010 "
ENTRETIEN, LAURENCE BOONE, chef économiste chez Barclays analyse les chiffres de la croissance
française
Les signaux passent au vert. La France est-elle sur le point de sortir de la récession ?
De façon purement technique, oui, on peut affirmer que nous sommes sortis de la récession. Mais cela ne
veut pas dire grand-chose. Il faut analyser les moteurs de la croissance pour savoir si celle-ci est pérenne.
Or les deux moteurs, consommation et production industrielle, sont fragiles.
Que voulez-vous dire ?
D'abord, la consommation a été encouragée par le recul de l'inflation tirée par des prix de l'énergie en fort
retrait. Or ceux-ci se stabilisent et vont augmenter de nouveau ; l'inflation devrait se situer aux alentours
de 1 % vers la fin de l'année (au lieu de - 0,5 % ce trimestre). Surtout, la consommation est tributaire de
l'évolution du marché du travail, qui devrait rester atone les prochains trimestres, voire se détériorer, avec
très peu de créations d'emplois, et donc une hausse du chômage.
La production industrielle a, elle, été soutenue par la prime à la casse qui a dopé la production dans
l'automobile et les secteurs associés. Cette mesure devrait disparaître progressivement.
Mais le soutien budgétaire pourrait continuer si le grand emprunt d'Etat cible des investissements
rapidement mis en œuvre. De même, la politique monétaire devrait continuer d'apporter son soutien, avec
des taux à 1 %, probablement tout l'an prochain, afin de continuer à solidifier le secteur bancaire. La
croissance sera aussi soutenue par un rebond plus significatif de l'Asie et des Etats-Unis.
A quoi faut-il s'attendre en 2010 ?
La croissance française sera molle, de l'ordre de 0,7 %, à comparer à 1,1 % pour la zone euro. Mais cela
fera suite à une récession de 2,6 % en 2009 (de - 4,2 % pour l'ensemble de la zone euro). La reprise sera
mesurée tant que le secteur bancaire ne sera pas rétabli et n'aura pas retrouvé sa capacité de prêter à
nouveau aux entreprises et aux ménages, ce qui devrait nous amener au-delà de 2010.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%