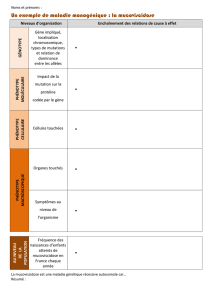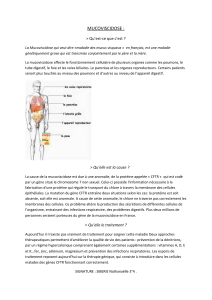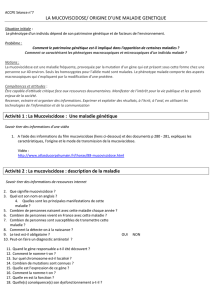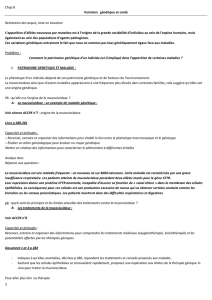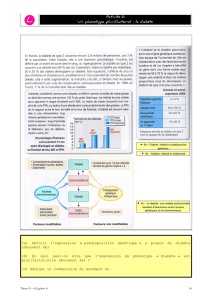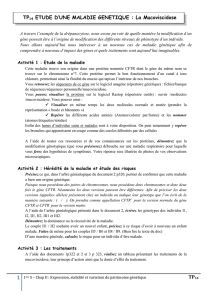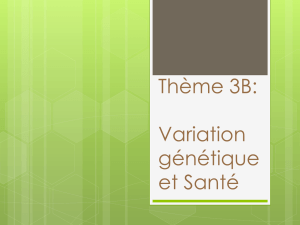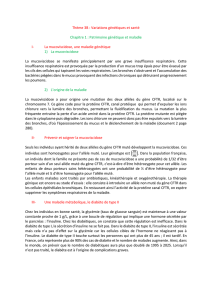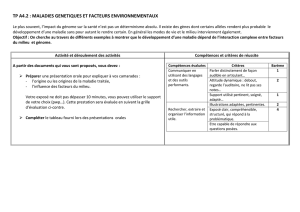Journaliste dans une revue de vulgarisation scientifique, il vous est

841049600 - 26.05.2017
SVT – Première S Contrôle n° 5 – Jeudi 18 avril 2013
Durée 1 h 30 minutes
Sujet de type partie 1
Patrimoine génétique et maladie
Question
Journaliste dans une revue de vulgarisation scientifique, il vous est demandé de rédiger un
article expliquant de manière argumentée la différence qu’il convient de faire entre une
maladie génétique et une maladie multifactorielle.
Votre article s’appuiera sur vos connaissances et les documents proposés.
Document 1
Prévalence de la mucoviscidose
Aucun cas de
mucoviscidose
connu auparavant
dans la famille
Frère ou sœur
atteint de
mucoviscidose
Jumeau vrai
atteint de
mucoviscidose
Risque pour un
enfant d’être
atteint de
mucoviscidose
0,02%
25 %
100 %
Document 2
Prévalence du diabète de type 2 (valeurs moyennes)
Parenté
Aucun parent
diabétique*
Un seul parent
diabétique*
Les deux
parents
diabétiques*
Frère ou sœur
diabétique*
Jumeau vrai
diabétique*
Risque de
développer un
diabète de type 2*
4 %
14 %
25 %
14 %
67 %
* Avant l’âge de 50 ans. Source : SVT 1S, Belin 2011 p. 262

841049600 - 26.05.2017
Éléments d’évaluation
Critères
Indicateurs
Synthèse
Mise en relation et
articulation des
connaissances
Question comprise clairement posée et respectée
Introduction qui définit les termes du sujet, pose clairement le problème et annonce sa
résolution
Plan (apparent conseillé)
Argumentaire mêlant faits (exemples, observations…) et idées, intention claire d’expliquer
Conclusion qui répond au problème posé
Eléments
scientifiques attendus
Issus des
connaissances
scientifiques acquises
et / ou des documents
La mucoviscidose est due à une défaillance du gène CFTR.
La mucoviscidose est un phénotype récessif.
On peut calculer la probabilité pour un fœtus d’être malade (document 1).
La mucoviscidose est une maladie génétique.
Le diabète de type 2 a une composante familiale (document 2).
De nombreux gènes sont impliqués dans le diabète de type 2.
La probabilité de transmission du diabète ne correspond pas à la probabilité de
transmission d‘une maladie génétique.
Des composantes environnementales interviennent dans le développement du diabète de
type 2 :
- obésité et tour de taille (obésité androïde) ;
- alimentation hypercalorique (trop riche en lipides et en glucides) ;
- sédentarité ;
- âge.
Notion de gène de susceptibilité (= de prédisposition).
Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle (à composantes à la fois génétiques et
environnementales).
Barème (la note sur 20 est multipliée par 2,5)
Synthèse pertinente
Effort de mise en
relation, d'articulation,
des connaissances
Synthèse maladroite ou partielle
Peu de mise en relation,
d'articulation des connaissances
Aucune synthèse
Éléments scientifiques complets
Éléments scientifiques partiels
Aucun des
éléments
scientifiques
attendus
8
7
6
5
4
3
2
1
0

841049600 - 26.05.2017
Mucoviscidose et diabète de type 2 :
la génétique n’est pas toujours seule
en cause
La mucoviscidose et le diabète de type 2 sont des
maladies peu fréquentes qui touchent respectivement
0,02 % et 4 % de la population française. Pourtant, si
on possède un frère ou une sœur atteint, le risque
d’être soi-même malade passe à 25 % pour la
mucoviscidose alors qu’il n’est que de 14 %, près de la
moitié, pour le diabète de type 2. S’il y a donc une
prédisposition familiale à ces deux maladies, comment
expliquer des prévalences différentes à l’intérieur d’une
fratrie ?
I. La mucoviscidose : le rôle déterminant du
gène CFTR
La mucoviscidose est due à une mutation du gène
codant la protéine CFTR qui intervient dans les
échanges d’eau entre les cellules épithéliales et le
milieu extérieur. Il en résulte une accumulation de
mucus épais à la surface de ces cellules, ce qui
entraîne de graves complications respiratoires,
digestives et infectieuses dès la naissance.
Un phénotype récessif
Des parents non malades peuvent avoir un enfant
malade. Dans ce cas ils transmettent chacun l’allèle
CFTR muté (a) à leur enfant tout en possédant l’allèle
sauvage (A), ils sont donc hétérozygotes (Aa). Un
échiquier de croisement permet alors de calculer la
probabilité pour ce couple d’avoir un enfant
homozygote, donc malade
Gamètes du père
A
probabilité
0,5
a
probabilité
0,5
Gamètes
de la mère
A
probabilité
0,5
AA
probabilité
0,25
Aa
probabilité
0,25
a
probabilité
0,5
Aa
probabilité
0,25
aa
probabilité
0,25
Échiquier croisement
de deux parents hétérozygotes
Un résultat statistique en accord avec la
théorie
D’après cet échiquier de croisement :
- si l’un des enfants d’une famille est malade, c’est
que ses deux parents sont hétérozygotes, ses
frères et sœurs ont donc une probabilité de 25 %
d’être eux même atteints de mucoviscidose ;
- si l’un des jumeaux vrais est malade, l’autre l’est
aussi forcément car, issu de la même cellule œuf,
il possède le même génotype homozygote (aa).
Ces résultats théoriques sont en accord avec les
résultats statistiques (cf. document 1).
II. Le diabète de type 2 : une génétique
soumise à l’environnement
Le diabète de type 2 n’apparaît qu’à l’âge adulte et
se manifeste par une hyperglycémie chronique
(supérieure à 1 g.L-1). Il est dû à un épuisement
progressif des cellules pancréatiques quoi ne
parviennent plus à produire suffisamment d’insuline car
les cellules cibles deviennent résistantes à cette
hormone.
Un résultat statistique qui ne correspond pas
à celui d’une maladie monogénique
Si on considère que le diabète de type 2 un
phénotype dominant deux parents non diabétiques,
tous deux de génotype aa, ne peuvent pas avoir
d’enfant diabétique possédant l’allèle A. Or cette
probabilité est de 4 %.
Si on considère que le diabète de type 2 a un
phénotype récessif deux parents diabétiques, tous deux
de génotype aa, devraient avoir 100 % d’enfants
diabétiques. Or cette probabilité n’est que de 25 %.
Plusieurs gènes en cause,
mais pas toujours…
S’il y a effectivement une prévalence familiale
accrue dans le cas du diabète de type 2, elle ne peut
provenir que d’une prévalence complexe. En fait, les
scientifiques ont découvert plus d’une trentaine de
gènes impliqués dans l’apparition du diabète de type 2.
Mais aucun de ces gènes n’est ni absolument
nécessaire ni suffisant pour être atteint de la maladie.
On parle alors de gènes de prédisposition (= de
susceptibilité) qui ne font qu’augmenter la probabilité
d’avoir la maladie.
Un rôle de l’environnement,
mais pas toujours…
À côté des facteurs génétiques, des facteurs
environnementaux ont été statistiquement mis en
évidence :
- l’obésité associée au tour de taille (obésité
androïde) ;
- une alimentation hypercalorique (trop riche en
lipides et en glucides) ;
- la sédentarité ;
- l’âge
Tout comme les facteurs génétiques, aucun de ces
facteurs environnementaux n’est ni absolument
nécessaire ni suffisant pour provoquer la maladie.
Alors que la mucoviscidose est une maladie
génétique, qui repose sur la défaillance d’un seul gène
(monogénique) et qui se manifeste dès la naissance, le
diabète de type 2 apparaît comme une maladie
multifactorielle où se mêlent à la fois des facteurs
génétiques, faisant appel à plusieurs gènes, et divers
facteurs environnementaux. Le diabète de type 2
n’apparaît donc qu’à l’âge adulte.
Il en résulte des stratégies différentes pour
combattre les deux maladies :
- un traitement uniquement symptomatique dans le
cas de la mucoviscidose (la thérapie génique
n’étant pas encore durablement efficace) ;
- une possibilité de prévention dans le cas dans le
cas du diabète de type 2 en agissant sur les
facteurs environnementaux des personnes
présentant un risque familial.
1
/
3
100%