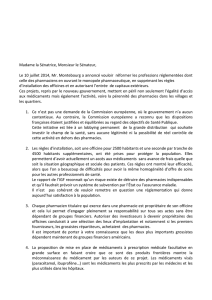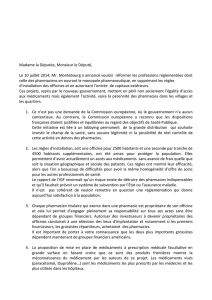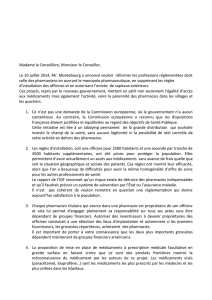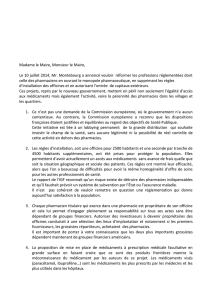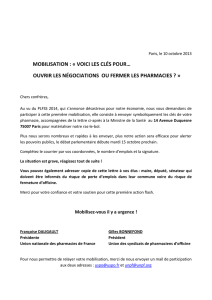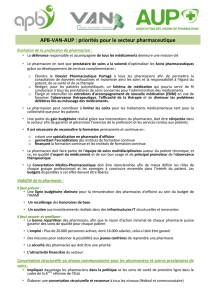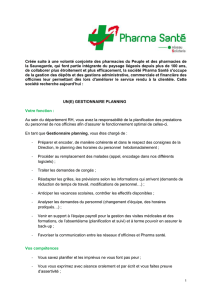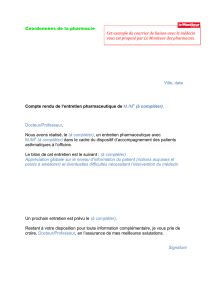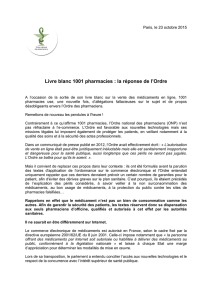Questionnaire - Pratispharma

Questionnaire pharmaciens
1. Situation économique des officines
1.1 Comment apprécier la situation économique des officines ?
La mission de l’IGAS considère, en première analyse, que l'indicateur le plus synthétique et donc le
plus approprié pour juger de la situation économique des officines est le revenu des titulaires
d'officine (résultat de l'exercice officinal qui rémunère le travail du professionnel et
l'immobilisation du capital), les autres données (évolution du CA, taux de marge, taux d'EBE, taux
de charges….) sont utiles pour l'analyse mais ne donnent qu'une vision partielle. Partagez-vous ce
sentiment ?
A cet égard, la mission constate que les dernières données établies par la DREES et l'INSEE
relatives aux revenus des titulaires portent sur l'année 2006, disposez-vous de données actualisées ?
Dans l'hypothèse ou vous accepteriez que le revenu des titulaires d'officine soit considéré comme la
variable pertinente, pensez-vous que les pouvoirs publics doivent prendre les décisions (taux de
marge, niveau des forfaits…) avec une cible de revenu moyen (la dispersion autour de ce revenu
moyen relève des choix et des performances de chaque professionnel) ou que les pouvoirs publics
devraient développer des politiques différenciés (par exemple soutien aux petites pharmacies, aux
pharmacies rurales, aux pharmacies dans les zones à démographie médicale réduite….) ?
Dans le cas d'une politique différenciée, quelles devraient être les caractéristiques des officines
soutenues et donc de celles qui seraient "moins favorisées" ?
Dans l'hypothèse où les pouvoirs publics se donneraient pour cible un revenu moyen, à quel niveau
devrait-il se situer ? Par exemple, en 2006 (DRESS), le revenu brut moyen se situait à 132 000
euros. Quel serait, selon vous, le niveau pertinent compte tenu du capital moyen immobilisé, des
qualifications exigées, des responsabilités assumées, du temps de travail des titulaires …? A partir
de quelles références construisez-vous cette appréciation ?
Si le revenu du titulaire ne vous paraît pas la variable pertinente quelle devrait-être l'indicateur
privilégié de la situation économique des officines qui servirait de cible pour les pouvoirs publics ?
1.2 Appréciation de la situation économique.
La mission IGAS, au-delà du questionnement précédent sur les modalités d'appréciation de la
situation économique des officines, souhaite connaître votre appréciation sur cette situation.
Quelle appréciation portez-vous sur la situation économique des officines ?
Cette appréciation s'applique-t-elle à l’ensemble des officines, quelle que soit leur taille et leur
localisation ?
Quelles sont les principaux facteurs qui ont conduit à la situation actuelle ?
Quels sont les éléments de prospective (par exemple sur les volumes, les prix des médicaments, les
charges) dont vous disposez ?
Quelle appréciation portez-vous sur l'évolution du prix de cession des officines ?
Les pharmacies dispose-t-elle de marges de manœuvre pour améliorer leur situation : progrès de
productivité interne, négociation des prix de la parapharmacie et de l'OTC, dynamisation des ventes
de la parapharmacie et de l'OTC, mutualisation/externalisation de certaines fonctions (enseignes
groupement) ?

Certaines pharmacies sont en concurrence (notamment dans les zones urbaines), pensez-vous que
cette concurrence s'exerce dans un espace fermé (les pharmacies gagnent aux dépens des autres) ou
que le dynamisme commercial de certaines élargit le marché de l'ensemble ?
1.3 Evolution du mode de rémunération (hors rémunération de nouvelles
missions, cf. infra.)
La rémunération de l'officine est actuellement fondée sur un système mixte : une marge dégressive
et un forfait par boite.
Il est parfois avancé qu'une rémunération forfaitaire (à la boite, à la ligne, à l'ordonnance) est plus
cohérente avec le rôle de professionnel de santé du pharmacien (c'est son expertise et son conseil
qui sont rémunérés) que la rémunération à la marge (dimension commerciale), qu'en pensez-vous ?
Souhaitez-vous, à enveloppe constante, une évolution vers une rémunération plus/moins forfaitaire
? Quels avantages et quels inconvénients pour l'économie de l'officine, pour le patient, pour les
pouvoirs publics ?
Si l'on devait évoluer vers une rémunération plus forfaitaire, faudrait-il privilégier la boite, la ligne,
l'ordonnance ? Pourquoi ?
Une telle évolution, même à enveloppe globale constante, entrainerait certainement des gains pour
certaines officines, des pertes pour d'autres. Avez-vous une appréciation des gagnants/perdants ?
Est-ce un problème très sensible ou un obstacle surmontable dès lors que l'évolution est étalée dans
le temps ?
Même si la réforme est réalisée initialement à enveloppe constante, la dynamique des ressources de
l'officine sera différente selon que la rémunération est plus ou moins forfaitaire. Avez-vous une
appréciation sur la dynamique comparée d'une rémunération forfaitaire ou d'une rémunération à la
marge ?
1.4 Faillites
Disposez-vous de données sur les "faillites" d'officines (sauvegarde, redressement, liquidation,
localisation, taille, ancienneté du titulaire…) ?
Dans quelles proportions, ces procédures aboutissent-elles d'une part à la disparition de l'officine,
d'autre part à une reprise ?
Les "faillites" d'officine constituent-elles un phénomène qui appelle une action des pouvoirs où une
réalité normale dans un secteur d'entreprises indépendantes où, par construction, chaque titulaire est
responsable de ses choix ?
Les pouvoirs publics doivent-ils apporter une aide spécifique aux officines en difficulté ? A quelles
conditions, selon quelles modalités ?
Observez-vous une dégradation des conditions d’accès au crédit des pharmaciens pour
l’investissement en officine? Si oui, quelles pourraient-être les causes selon vous ?
Les durées de remboursement des emprunts pour les achats des pharmacies sont généralement
inférieures à 15 ans pouvant conduire à des difficultés financières lorsque le chiffre d’affaire évolue
peu. Pour quelles raisons, les emprunts ne sont-ils pas remboursés sur des durées plus longues ?

2. Les missions "traditionnelles"
21. L'analyse pharmaceutique et le conseil.
L’analyse pharmaceutique et le conseil associé à la délivrance des médicaments sont les missions
primordiales des pharmaciens. Elles nécessitent le recours à des logiciels de gestion des officines et
les pharmaciens sont amenés à contacter les médecins pour dans certains cas faire modifier des
prescriptions voire refuser les délivrances.
Quelle appréciation portez-vous sur la prise en charge de la mission d'analyse pharmaceutique dans
les officines ?
Les études (CNAM/2003, Polychrome) montrant que des ordonnances délivrées comportent parfois
des interactions contre-indiquées (niveau 4), quelle est votre appréciation sur ces études ?
Une étude par testing d’UFC-Que choisir met en exergue des défauts de conseil dans une grande
proportion d'officine. Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous une appréciation de la fréquence (1 ordonnance sur…) avec laquelle le pharmacien
intervient auprès du médecin :
- pour éventuellement modifier l'ordonnance (interaction) ;
- parce que l'ordonnance est suspecte (fraude, falsification) ;
- parce que l'ordonnance est illisible ou comporte une erreur manifeste (posologie…).
Dans le premier cas, avez-vous une appréciation sur la part des ordonnances confirmées/modifiées
?
Le médecin est-il facilement joignable et disponible ou l'intervention auprès de lui est-elle une
charge importante ?
Quelle est en règle générale l'attitude du médecin par rapport à l'intervention du pharmacien ?
L'attitude des médecins est-elle un obstacle à une bonne gestion des ordonnances problématiques ?
Les pharmaciens québécois sont spécifiquement rémunérés lorsqu'ils interviennent sur une
prescription (sollicitation du prescripteur, refus de délivrance) dès lors que l'intervention est
documentée/tracée. Qu'en pensez-vous ?
Le contrôle du pharmacien doit-il aller au-delà du contrôle de cohérence des consommations de
médicaments ou vérifier que les médicaments prescrits sont bien adaptés au patient (contrôle
externe au-delà du contrôle interne) ?
L'opinion pharmaceutique promue par l'Ordre se développe-t-elle ? Si non quels sont les freins ?
Quel est l'apport des logiciels pharmaceutiques au contrôle des prescriptions ? Quelle est selon
vous la part des ordonnances qui sont, avant délivrance, soumises à un contrôle informatique ? Y a-
t-il des données sur cette question ? Quel est le taux d’équipement en logiciels de détection des
associations, quelles sont les modalités de mise à jour des logiciels et quelle est la base de données
des interactions habituellement utilisée ? Un contrôle par logiciel de toutes les délivrances y
compris pour les médicaments vendus doit-il être imposé réglementairement ? Dès lors que le
logiciel émet une alerte (niveau 3 et 4), le préparateur ne devrait-il pas confier l'analyse à un
pharmacien ? Les logiciels ou le DP permettent-ils de "tracer" toutes les interventions des
pharmaciens (contact médecin, délivrance avec conseils, refus de délivrance) ?

La formation des préparateurs est-elle suffisante pour réaliser le contrôle des prescriptions ? A
votre connaissance, existe-t-il dans les pharmacies des procédures documentées pour préciser les
circonstances dans lesquelles le préparateur doit solliciter le pharmacien ? Pensez-vous que, même
en l'absence de telles procédures, la qualité du travail en équipe préparateurs/pharmaciens au sein
de l'officine permet un contrôle pertinent des prescriptions ?
Dès lors qu'un DP est constitué, pensez-vous qu'il est systématiquement/souvent/parfois consulté
lors de la dispensation ?
Il existe peu d'études et d'évaluations sur la qualité de la fonction analyse/conseil dans les officines.
Les deux études d'observation repérées par la mission semblent tirer un bilan mitigé. (Etude BPI
pour l'ONDPS " Si dans le discours, les professionnels rencontrés s'accordent dans leur grande
majorité à considérer leur rôle de conseil comme incontournable et valorisant, il n'en reste pas
moins qu'ils semblent dans le même temps assez peu impliqués dans la réflexion et le
développement de cette fonction conseil. Ils se forment peu et demeurent dans des pratiques orales
peu formalisées construites au fil du temps et laissés à la discrétion des différents membres des
équipes officinales". Etude Interface Etude Conseil Formation pour la DGTEFP " L'enquête de
terrain a permis de démontrer que dans toutes les situations observées, les préparateurs exercent
fréquemment une activité de contrôle et de conseil sans contrôle effectif"). Pouvez-vous nous
fournir d'autres études d'évaluation ?
Quelle est la charge de travail liée à un signalement de pharmacovigilance ? Serait-il pertinent de
prévoir une rémunération spécifique pour cette activité ?
2.2 Libre accès aux médicaments
La nouvelle réglementation a prévu un libre accès à certains médicaments à prescription non
obligatoire dans les pharmacies pour faciliter le développement de ce type de marché et accroître
la transparence sur les prix. Seule une étude sur la dispersion des prix, commanditée par un groupe
de grande distribution a été publiée mais le dispositif n’a pas été évalué dans son ensemble.
Quelle est votre appréciation de la facilité désormais offerte de vendre les médicaments non
remboursables sur linéaire ? Faut-il aller plus loin ?
Les ventes de médicaments OTC ont-elles progressé suite à cette mesure, si oui de quel ordre ?
Quelle est la nature des conseils associés (remises de documents) ? Comment est réalisée la
recherche d’interactions ?
L’Ordre des pharmaciens précise que le DP pourrait être utilisé pour les ventes sans prescription,
est-ce matériellement possible ?
Le libre accès rapproche le médicament OTC de la parapharmacie, pensez-vous qu'il y a un risque
que se développe une approche commerciale des médicaments OTC, des démarches de
"dynamisation des ventes" (techniques de merchandising, formation des préparateurs aux
techniques de vente….) ?
3. Nouveaux services
3.1 Nouveaux services et situation économique des officines.

Il est souvent fait l'hypothèse que le développement des nouveaux services va contribuer à
améliorer plus ou moins significativement la situation économique des officines. Cela pourrait être
le cas si ces nouveaux services sont développés sans charges supplémentaires pour l'officine c'est-
à-dire si ses nouveaux services sont réalisés en utilisant des temps morts, non productifs des
équipes officinales. Si ce n'est pas le cas et si pour développer les nouveaux services les officines
doivent rémunérer du temps de travail supplémentaire, les nouveaux services ne contribueront à la
santé économique de l'officine que s'ils sont rémunérés bien au-delà de leur coût (hypothèse peu
probable).
Quel est à cet égard la situation des officines ? Existe-t-il de manière significative du "temps
disponible" ou des moyens pour dégager du "temps disponible" dans les officines ?
S'il existe du "temps libre", du "sous emploi", pourquoi rechercher une solution dans l'extension
des services plutôt que dans la réduction des charges ?
En ce qui concerne les charges, le nombre de pharmacien est normé en fonction du CA de
l'officine. Cette norme vous paraît-elle pertinente ? Est-elle respectée systématiquement ?
S'il n'existe pas de "temps libre", pourquoi les pouvoirs publics investiraient-ils pour développer de
nouveaux services dans l'officine plutôt qu'auprès d'autres prestataires de soins (cabinet du
généraliste, programme d'accompagnement par des infirmières…) ?
3.2 Nouveaux services et stratégies commerciales
Le réseau officinal semble évoluer vers des stratégies d'enseigne et de marques soit des stratégies
de différenciation fondées notamment sur une différenciation en termes de qualité de services. Le
développement de services de santé publique dans les officines renvoie plutôt à une logique
d'universalité, d'égalité soit à une certaine uniformité dans la diffusion des services.
Y a-t-il une contradiction entre les deux logiques ?
Si la prestation de nouveaux services s'inscrit dans des stratégies de concurrence pour capter des
clientèles, générer des flux de passage pourquoi les pouvoirs publics financeraient-ils ces services ?
Le service n'est-il pas rémunéré par les ventes liées aux flux ?
Certains observateurs notent que certaines enseignes/regroupement ou certaines pharmacies
s'orientent les unes vers des stratégies de concurrence sur les prix, les autres vers des stratégies de
concurrence par la qualité et le service, qu'en pensez-vous ?
Il est parfois évoqué des stratégies de service où des enseignes salarieraient des professionnels
(diététiciennes, infirmières…) ayant vocation à intervenir dans les pharmacies, pensez-vous que
cette pratique est développée, appelée à se développer ?
Faut-il laisser se développer des stratégies de services sous l'égide des regroupements, des
enseignes ou développer un socle plus ou moins normé de services universel dans toutes les
pharmacies ?
3.3 Pharmacien correspondant /renouvellement des prescriptions
La notion de pharmacien correspondant pouvant renouveler les prescriptions est une des mesures
phares de l’article 38 de la loi HPST (alinéa 7). Sa mise en œuvre implique la signature d’une
convention avec le médecin prescripteur et l’accord du patient. Cette convention doit être autorisée
par l’ARS.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%