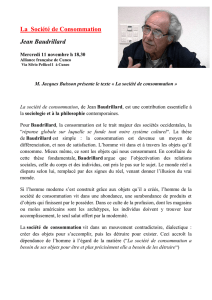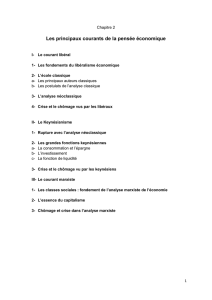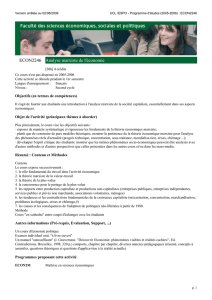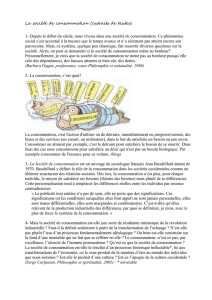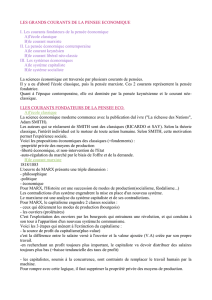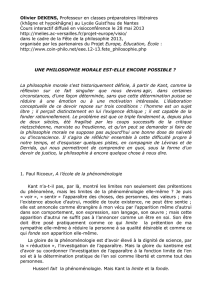1987-clouscard-reponse-a-claude-morilhat - Clouscard

Réponse de M. Clouscard.
1987.
« Société Française » me proposant de répondre à la critique de Claude Morhillat dès son
prochain numéro, c’est « à chaud » et très rapidement que j’ai rédigé cette première réponse,
comptant plus tard proposer une réponse systématique à la critique du « projet d’ensemble ». Je
remercie tout d’abord Claude Morilhat du très bon esprit de sa critique constructive. J’assumerai
même son jugement d’introduction : « Clouscard indispensable mais … insatisfaisant ». Je
pourrais même dire que j’en suis fier ! C’est un parfait et à mon avis élogieux « positionnement »
dialectique. Ma contribution à la recherche marxiste, en particulier pour combler le « retard
théorique », est reconnue, et cela dans la mesure où la critique de cette contribution peut
permettre un nouveau progrès de cette recherche.
Ma réponse – aussi constructive – à la critique de Claude Morilhat sera ordonnée selon une
double progression : du moins « grave » au plus « grave », des points particuliers à la critique
fondamentale. « L’auteur donne souvent l’impression de travailler à la hache ». C’est ce que je
voudrais beaucoup en dire, trop sans doute, j’en conviens, étant donné que la place, pour le faire,
est très limitée. Très souvent, en effet, je ne fais qu’indiquer, désigner, marquer. Je ne fais que
prendre date, montrer l’idée, le problème. J’ai voulu avant tout proposer un travail de repérage
global, de mise en situation, de délimitation d’un champ culturel. Il faut savoir désigner les
cibles, dégager très vite les topiques, les enjeux. Et c’est en partie, inévitablement, un travail de
guerre idéologique, à la hache.
A propos des grands auteurs : « le dessin à grands traits se distingue mal de la caricature faute
du recul culturel nécessaire ». Mais Claude Morilhat a très bien compris, aussi, que ces grands
auteurs ne font que me servir de signifiants majeurs de la phénoménologie de la bourgeoisie. Je
suis indifférent à leurs œuvres en tant que telles. Ils ne m’ont servi qu’à désigner les articulations,
les thèmes, les figures, les « étants » de cette phénoménologie ; du néo-kantisme théorique. Cette
démarche peut évidemment surprendre. Réduire Sartre, Lévi-Strauss, Foucault, Barthes, Lacan,
Bourdieu, Baudrillard, à n’être que l’os qui permet de reconstituer l’animal, (phénoménologique),
comme Cuvier a pu le faire, cela peut même paraître scandaleux à ceux qui ont pu croire aux
messages et à l’unicité des grands maîtres. Mais cela relève d’une méthode qui se veut très
rigoureuse, j’y viendrai.
Pour Claude Morilhat, « Incontestable, la réussite de « l’exercice de style » s’affirme en partie du
détriment du « travail de fond » ». Il écrit même « Totem, potlatch, principe de réalité … le
détournement de notions qui ont fait les beaux jours de la théorie est habile, mais l’extraction de
leur champ d’horizons ne suffit pas à leur assurer une dimension conceptuelle, si elles font
images elle n’autorisent pas pour autant une meilleure compréhension de la société capitaliste ».
Pourtant l’expression : « potlatch de la plus-value » ne dit-elle pas, en deux mots, l’essentiel ?
N’y a-t-il pas, presque, adéquation de l’image et du concept ? Après avoir préparé le lecteur, en
me servant des catégories du « culturo-mondain », je lui impose un bien surprenant glissement de
sens qu’il ne peut plus récuser. En partant de cette aimable notion de l’ethnophilosophie qu’est le
potlatch, j’en viens à dire la nécessité même que ce genre de discours permet de cacher. Mon
style « imagé » n’est que la réponse à la question même de la pédagogie : comment, à partir du
langage idéologique usuel, en venir à la nécessité du concept ? C’est le problème de Socrate. J’ai
voulu aussi y répondre : « le potlatch de la plus-value ». N’y a-t-il pas un bon usage, didactique
et même conceptuel, de l’image ?

Mais venons-en à des critiques qui me semblent plus importantes. Claude Morilhat me fait un
autre reproche, bien plus grave sur mon « schématisme » et « manque de rigueur » qui deviennent
même « laxisme théorique ». Et tout d’abord sur un problème fondamental pour la pensée
marxiste : le problème de l’Etat. Claude Morilhat me reproche une interprétation
« instrumentale » de l’Etat et même, ce qu’il n’explicite pas mais qui à mon avis se lit en
filigrane, dans son texte, une interprétation opportuniste.
J’ai voulu redéfinir le statut théorique de l’Etat. Je crois que c’est une urgence, une priorité
même, car cette notion est devenue une hypostase, qui à la limite devient même mythique. L’Etat
a été substantialisé, réduit à une univocité monolithique. Cette réification a eu deux effets
pervers. D’une part, le blocage de la recherche marxiste, une inhibition devant une notion que
même Marx n’a pas théorisée. Et d’autre part, un usage commun au dogmatisme et au
gauchisme : l’Etat bourgeois purement répressif. L’Etat n’est pas une chose en soi, une bûche,
ou un « monstre froid » mythique . J’ai voulu rendre l’Etat à la dialectique et à l’histoire, pour
débloquer la recherche, lutter contre les déviations et surtout pour permettre à la stratégie
révolutionnaire de « s’articuler » sur l’Etat et même pour proposer les lieux et les moyens des
interventions stratégiques sur une réalité historique que la grande bourgeoisie et le grand
capital ont su, eux, démythifier par son un usage instrumental, opportuniste, hyper-réaliste. En
effet, dans les livres cités par Claude Morilhat tout cela n’est qu’indicatif, allusif même. Je ne
ferai que proposer le schéma de ma recherche aggravant ainsi le reproche de … « schématisme ».
Mais, dans mon dernier livre, « Les Dégâts de la pratique libérale », j’explicite ces propositions
théoriques et stratégiques.
Ma thèse est que l’Etat est à trois dimensions, trois attributs dirait Spinoza, trois rôles, trois
fonctions. L’Etat français n’est-il pas, quand même, aussi républicain ? Le gaucho-fascisme
qui voulait détruite l’Etat n’aurait-il pas du coup, liquidé la République ? Peut-on définir l’Etat
français comme si la Révolution Française n’avait pas eu lieu ? Aussi « le mythique Etat de la
volonté générale » comme dit Claude Morilhat, me semble être au contraire, une composante très
réelle, institutionnelle et constitutionnelle, que la théorie aurait grand tort de négliger car la
conséquence serait une fatale erreur stratégique. L’Etat est aussi, et surtout évidemment,
l’expression de la classe sociale dominante, l’émanation politique du mode de production ; je
cite constamment « le capitalisme monopoliste d’Etat ». Troisième dimension de l’Etat : il est
l’Etat-nation. Il gère l’appareil infrastructural et superstructural de la Nation. Et là, je
récidive, relaps : l’Etat est aussi, en plus des deux essentiels attributs cités, appareil de gestion,
instrument d’une nécessaire planification et centralisation ou décentralisation qui pourrait
même être dit « neutre » … si cette gestion n’était pas, par excellence, le lieu d’affrontement de
l’Etat républicain et de l’Etat capitaliste, de la contre-révolution et des droits de l’homme.
Mais ce n’est pas tout : il faut proposer une deuxième ligne (théorique) de la notion d’Etat. Il faut
le rendre, encore plus, au matérialisme dialectique et historique : l’Etat doit être défini selon le
système de sa relation dialectique et historique avec la société civile et avec l’appareil
d’Etat. Ce système de définitions est très important car il permet, après s’être articulé sur la
première ligne théorique, de définir la stratégie révolutionnaire dans les pays dit post-
industrialisés. Dans les « Dégâts de la pratique libérale », j’ai explicité les modalités de cette
stratégie. Je ne ferai qu’en dégager l’idée fondamentale. Le socialisme démocratique et
autogestionnaire est maintenant possible à cause du nouveau dispositif que je viens d’énoncer.
Le travailleur collectif, autre entité produite par le CME, peut et doit maintenant intervenir sur les
éléments dialectiques et historiques qui engendrent la réalité « pratique » de l’Etat. En se servant
de ce cheval de Troie qu’est l’Etat républicain, au nom des droits de l’homme, en agissant sur la

société civile (qui est son négatif), en investissant l’appareil d’Etat, en se glissant dans le jeu des
rapports de force, en s’emparant même de certaines bastilles de gestion (La Sécu pourrait être
proposée comme un cas privilégie de ce combat). Il faut bien comprendre l’inversion réalisée par
le capitalisme : ce n’est plus l’Etat qui décide de la société civile. L’Etat est devenu
l’émanation d’un capitalisme qui a totalement maîtrisé la société civile en la réduisant à un
marché généralisé, le marché du désir.
Aussi, il ne faut pas se tromper de cible, se laisser duper par la stratégie du libéralisme social
libertaire. L’Etat est aux ordres de la société civile dans la mesure où celle-ci est soumise au
capitalisme. L’Etat est devenu, essentiellement, l’instrument de gestion d’une nation qui est
devenu un marché généralisé. C’est sur cet Etat-là que le travailleur collectif peut maintenant «
travailler » en profitant de sa déliquescence opportuniste, en jouant sur ses articulations et
expressions historiques. Faire de l’Etat une abstraction monolithique – à la manière d’Althusser –
c’est s’interdite toute stratégie autre que celle de la dictature du prolétariat : on prend l’Etat ou
rien.
Ma définition du politique me semble être alors l’expression même de cette situation ; elle est
dialectique et historique, contrairement à ce qu’en dit Claude Morilhat lorsqu’il interprète ma
phrase : « le politique n’est plus que le combat pour la gestion ». Je précise : dans la mesure
où la gestion se révèle être le politique même de l’économique. Tout cela va dans le sens du
marxisme : c’est bien l’économique qui, en dernière instance, décide du politique. L’époque,
la crise, le révèlent. Mais alors que le discours dominant de l’idéologie est devenu l’économisme,
le marxiste, lui expliquant ce jeu des catégories, accède au politique. Expliquer que la
problématique de la gestion est devenue l’effectivité du politique, c’est un savoir politique,
nécessaire à qui veut proposer une stratégie révolutionnaire.
Autre reproche de Claude Morilhat, qui je l’avoue, m’a ulcéré. Il me comparer à Baudrillard, à
propos d’une problématique théorique fondamentale, sur laquelle je vais revenir, alors que des
millions d’années-lumière gnoséologiques, politiques, spirituelles, éthiques, nous séparent.
Baudrillard est l’une de mes caricatures, l’autre étant Bourdieu, caricatures de la
phénoménologie de la praxis que je propose. Je n’ai rien de commun avec le subjectivisme
naïvement mondain de Baudrillard ni avec ( et là Claude Morilhat en convient ) le positivisme
naïvement scientiste de Bourdieu. Comment Claude Morilhat peut-il me réduire à une
caricature alors toute la première partie de son article a consisté à définir ma différence avec
Baudrillard ? D’ailleurs, ce n’est pas moi qui « reprends » les thèses de Baudrillard. C’est lui qui
a tiré les marrons du feu de ma recherche fondamentale, théorique, en l’expurgeant de toute ma
reconstitution de la lutte des classes pour n’en proposer qu’une profiteuse expression culturo-
mondain, qui n’est autre que la figure privilégiée de la mondanisation de la culture que je
dénonce : le discours BCBG sur la société de consommation. Claude Morilhat a bien montré
pourtant comment j’expliquais la généalogie de la société de consommation ?! Baudrillard fait
l’inverse : il explique par la société de consommation. Il en fait une abstraction globalisante qui
recouvre a priori toute détermination. La description tient lieu d’explication. Ce qui permet de ne
pas parler de la lutte des classes. Et mieux : de la considérer, au fond, comme dépassée,
recouverte par la société de consommation. La mise en forme permet de liquider le problème de
fond.
La société de consommation pour Baudrillard, c’est les autres. (de même pour la pornographie).
Pour moi, la société de consommation c’est Baudrillard, le discours culture qui a permis
d’inventer et d’imposer la notion d’idéologique qui doit empêcher l’explication par la lutte des
classes. Baudrillard est le porte-parole des nouvelles couches moyennes, du cadre qui parti de la
contestation de mai 68, a maintenant parfaitement « réussi » et qui tire le pont-levis derrière lui.

Baudrillard est le porte-parole des nouvelles couches moyennes, du cadre qui, parti de la
contestation de mai 68, a maintenant parfaitement « réussi » et qui tire le pont-levis derrière lui.
Baudrillard est le « signifiant » même qu’il prétend dénoncer. Il est le discours culturel qui se
croit « post-marxiste », de la fin (prétendue) de la lutte des classes. Il représente la plus grande
effectivité et actualisation idéologiques. Il a réussi cette magistrale opération : prendre au
marxisme tout ce qui lui permet de le récuser. La société de consommation n’est pas le
dépassement du marxisme. Tout mon travail a consisté à montrer, au contraire, que [ la
société de consommation ] est lutte des classes généralisée, forme ultime du capitalisme.
[lutte des classes selon le niveau de vie et le genre de vie ] Et cette perfection de la civilisation
capitaliste est aussi la meilleure condition de sa fin, ce que je montre dans « Les dégâts de la
pratique libérale ».
Mais venons-en à ce qui me semble être l’essentiel. Cette comparaison avec Baudrillard serait
justifiée, pour Claude Morilhat, par l’usage abusif que je fais des notions de valeur d’usage et
de valeur d’échange. Cet abus, ce détournement de catégories, serait révélateur d’une méthode
qui tournerait même « au laxisme théorique » Je crois qu’il s’agit d’un malentendu qui peut être
tout d’abord très vite écarté, en faisant une très nette distinction entre le domaine de
l’économie politique et celui de la philosophie de la praxis, entre les acquis du marxisme et
la recherche.
Pour élaborer la phénoménologie de la praxis, j’ai effectivement procédé à un « détournement de
sens » : j’ai extrait les notions de valeur d’usage et de valeur d’échange du
champ de l’économie politique pour les importer dans le domaine de la
phénoménologie. Elles me permettent de définir deux axes phénoménologiques, deux a priori
d’ordre économique, qu’il faut ensuite – toute la problématique de la phénoménologie est là –
articuler sur l’existentiel. Ce projet vaut ce qu’il vaut. ( Je le justifierai plus tard pour conclure).
Qu’il n’y ait donc pas de confusion, celle qui permettrait de me traiter de confusionniste. Je n’ai
fait que proposer une « opération » méthodologique. C’est une construction qui repose sur une
extraction et importation de notions. Celles-ci s’exercent en un nouveau champ de recherche,
qui de lui-même, se distingue, tout en l’utilisant, du champ de l’économie politique. Mais il
est vrai que si j’ai bien distingué les deux champs de la connaissance, c’est bien leur
articulation, leur mise en relation, qui est le problème gnoséologique fondamental : quels
sont les rapports de l’économie politique marxiste et de cette philosophie de la praxis ? Cette
philosophie prétend se fonder sur l’économie politique marxiste, sur « Le Capital », et même sur
le travail collectif du « capitalisme monopoliste d’Etat ». Il ne peut y avoir de philosophie de la
praxis que dans la mesure où l’économie politique marxiste [ est constituée et ] l’autorise. C’est
parce que cette économie politique existe que la philosophie de la praxis est possible et que,
corollaire, elle n’a pas à justifier ses fondements, à reconstituer ses références (de là mes ellipses
allusives qui sont tout le contraire de la désinvolture qui m’est prêtée)
Je n’ai jamais prétendu, moi, re-lire « Le Capital » de telle manière qu’il soit ré-écrit en termes
de philosophie. [ Althusser ] Tout au contraire, ma phénoménologie de la praxis ne le remet
jamais en question. Je le considère comme acquis. Je ne donne dans aucun révisionnisme
théorique. De plus, je cite abondamment le CME ( ce qui par ailleurs m’a été vivement reproché).
On sait en effet que sa théorisation « le capitalisme monopoliste d’Etat » est très ambiguë. C’est
un énorme travail collectif d’actualisation « de l’économie politique marxiste » et en même
temps l’origine de l’erreur politique du Programme Commun. C’est à ce niveau qu’intervient ma
recherche théorique. Elle s’appuie dont sur « Le Capital » de Marx et sur la définition du CME.
C’est un travail qui a été fait, dont je profite. Mais je critique aussi « le Capitalisme
monopoliste d’Etat » pour deux raisons essentielles.

La première est du domaine de l’économie politique, où je suis particulièrement incompétent et
par conséquent, particulièrement prudent. Aussi je ne ferai qu’interroger les économistes
marxistes : « que faites-vous de ce que, faute de mieux, faute d’analyses économiques, j’appelle,
image qui en vaut d’autres, le marché du désir ? Ne peut-on pas quantifier l’industrie du loisir,
du plaisir, du développement, du jeu, de la mode, etc ? Quels sont les rapports de la politique
des revenus – qui fonde ce marché – et des investissement productifs ? Dans quelle mesure la
redistribution d’une part des profits aux nouvelles couches moyennes modifie-t-elle le jeu de
l’économie politique traditionnelle ? »
J’ai proposé trois caractéristiques essentielles de ce nouveau marché : il est la cause de nouveaux
profits, il dynamise – ou ralentit ? – le marché traditionnel, et, enfin, cette énormité : [le marché
du désir ] ne permet-il pas de « compenser » la crise, de rattraper les défaillance de
l’économie traditionnelle, en un mot, d’empêcher ce qui s’est passé en 1929 ?
Ma seconde critique porte sur une interprétation possible du « capitalisme monopoliste d’Etat »,
dont le mécanisme est analysé dans la thèse 39 de mon dernier livre : « les dégats de la pratique
libérale » et qui consiste essentiellement à identifier économie et politique : ce qui se passe dans
l’économie doit nécessairement se répéter dans le politique. Le CME exploitant presque toute la
population, un front anti-monopoliste devrait se créer. Or, c’est le contraire qui s’est produit : le
développement du consensus anti-communiste. Aussi pour « critiquer » cet économisme,
fondement théorique d’une erreur stratégie désastreuses, j’ai entreprise de reconstituer la
phénoménologie et la logique de la « société capitaliste » selon les trois livres dont Claude
Morilhat rend compte : les mœurs, les classes sociales, les idéologies. Alors est possible
l’élaboration d’une stratégie révolutionnaire adéquate à cette modernité capitaliste ( cf. « Les
dégâts de la pratique libérale » )
[ les mœurs ] Il fallait dire le rôle nouveau de la société civile, devenue le lieu de la création
« spontanée » du marché du désir, de la demande, qui identifie maintenant idéologisation et
mercantilisation, société civile qui a eu le vertigineux pouvoir d’inverser en termes existentiels
et politiques l’ordre de la nécessité économique. [ les classes sociales ] Il fallait dire les
nouvelles relations de la société civile, de l’Etat, de l’appareil d’Etat. [ les idéologies ] Il
fallait montrer aussi le rôle des philosophies néo-kantiennes dans la production du consensus
du libéralisme social libertaire. Etc..
Je peux maintenant définir les rapports de l’économie politique marxiste et de la philosophie de la
praxis. Mon double travail critique – de l’économie politique définie par « Le capitalisme
monopoliste d’Etat » - s’appuie sur les acquis de l’économie politique marxiste. Aussi, s’il
n’apparaît pas trop prétentieux de mettre sur le même plan un travail collectif et une contribution
personnelle, le second mouvement de ma démarche consistera à proposer une synthèse de
l’avancée théorique du « Capitalisme monopoliste d’Etat » et de ma critique.
Mon hypothèse de recherche est que l’unité du matérialisme dialectique et historique doit être la
synthèse des acquis théoriques de l’économie politique et de l’actualisation phénoménologique de
la lutte des classes. Le commencement de cette synthèse me semble devoir être apportée par la
réponse des économistes marxistes aux interrogations du marché du désir.
C’est du moins ce que je suggère, comme prospective, euristique. Autremen dit, ma démarche,
critique et synthétique, loin d’être un « laxisme théorique » témoigne, au contraire, d’une bien
inactuelle et rarissime vigilance théoricienne. Elle est une actualisation de la lutte des classes qui
 6
6
1
/
6
100%