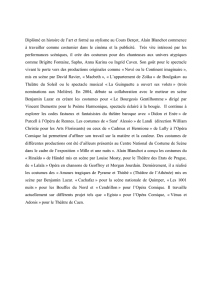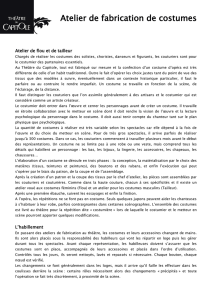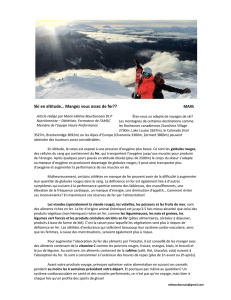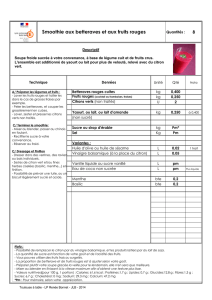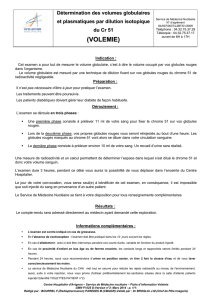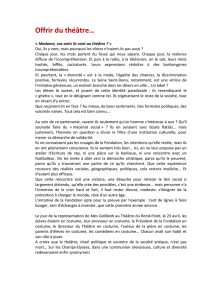Un bain de rouge

Un bain de rouge
La couleur rouge est la couleur par excellence (dans plusieurs langues, c’est le même mot qui
signifie “rouge” et “coloré”). Mais elle est aussi, depuis le XIXe siècle, la couleur du théâtre : celle du
rideau, des fauteuils et de bien des décors et des costumes.
Au gré de ses goûts et de sa fantaisie, Christian Lacroix présente, autour de cette couleur, un large
choix de dessins et de costumes pour la scène issus des collections de la Bibliothèque nationale de
France (Bibliothèque-musée de l’Opéra, département des Arts du spectacle), de l’Opéra national de
Paris et de la Comédie-Française. Les documents ainsi rassemblés contribuent certes à une
symphonie de couleurs et de textures, pour la satisfaction des yeux ; mais ils sont aussi des objets de
mémoire, renvoyant chacun aux spectacles, aux décorateurs, aux acteurs et chanteurs qu’il a vus,
appréciés ou aimés. Enfin, et grâce à la collaboration de Michel Pastoureau, ils montrent que les
fonctions et significations du rouge sur scène ne sont pas très éloignées de celles du rouge dans la
vie : le rouge de la joie et de l’enfance, le rouge de l’amour, le rouge du sang, le rouge du feu...
La théâtralité du rouge par Michel Pastoureau
Depuis des époques très anciennes, la couleur rouge a été en Occident associée à la mise en scène
du pouvoir et du sacré. Probablement parce que c’est dans la gamme des rouges que l’homme
européen a été performant le plus tôt, bien avant toutes les autres couleurs, et ce aussi bien en
teinture qu’en peinture. Par là même, le rouge a longtemps été considéré comme la couleur par
excellence, celle du sang et du feu, celle de la vie et de la vigueur, celle de l’autorité et de la beauté.
Dans plusieurs langues mortes – et même encore dans quelques langues vivantes, le russe par
exemple – il y a synonymie entre "rouge" et "coloré", "rouge" et "puissant", "rouge" et "beau".
À l’époque romaine, le rouge, qui est à la fois la couleur de la guerre et celle de l’empire, participe à
toutes les victoires et solennités. On distingue même souvent plusieurs nuances de rouge, comme le
montre un emploi précis et diversifié du vocabulaire. Le rouge du manteau des légionnaires, par
exemple, teint avec de la simple garance, n’a pas le même aspect ni la même valeur symbolique que
celui de l’empereur, obtenu à partir du précieux murex et dont les reflets pourprés se situent à mi-
chemin entre le rouge, le violet et le noir.

Le christianisme médiéval a repris et prolongé une partie de ces usages solennels du rouge, mais en
diminuant la dimension guerrière de la couleur et en développant au contraire sa fonction sacrée. Le
rouge est devenu une des trois couleurs liturgiques principales, liée aux fêtes de l’Esprit et de la
Croix. Associé au blanc, il est devenu également la couleur symbolique de l'Église, de la papauté et
d’une bonne partie des rituels et cérémonies qui leur sont associés. Les cardinaux eux-mêmes,
censés donner leur vie et leur sang pour le Christ, sont entièrement vêtus de rouge à partir du milieu
du XIIIe siècle. Leur réunion lors d’un conclave ou d’un concile s’accompagne d’une omniprésence
vestimentaire de cette couleur, à un degré jamais vu par ailleurs.
À l’époque moderne, cette mise en scène du rouge ne disparaît pas des églises ni des palais mais
elle s’étend à d’autres lieux et circonstances, les uns tout aussi solennels, comme les palais de
justice, les autres plus profanes et plus ludiques. Le rouge devient en effet la couleur dominante des
lieux de plaisir et de divertissement. Non pas tant celle des maisons de prostitution, dont une lanterne
rouge signale parfois la présence, que celle des salles où se donne un spectacle, s’écoute de la
musique, se joue une pièce de théâtre ou un opéra.
Même si, au XVIIIe siècle, le bleu lui fait un moment concurrence dans ce rôle, le rouge demeure
jusqu’à des dates très récentes la couleur de la théâtralité. Partout des salles sont entièrement
habillées de rouge, du sol au plafond, des fauteuils aux rideaux, pour exprimer tout à la fois le
caractère exceptionnel du lieu, et le plaisir que l’on éprouve à y être. Sans le rouge, la fête ne serait
pas complète, le plaisir moins grand, le lieu plus ordinaire.
Les quatre rouges chrétiens par Michel Pastoureau
Du point de vue symbolique, le rouge, comme toutes les autres couleurs, est ambivalent : il y a un
bon et un mauvais rouge comme il y a un bon et un mauvais noir, un bon et un mauvais vert, etc.
Toutefois, par rapport aux autres, le rouge présente la particularité d’avoir deux référents principaux :
le feu et le sang. De ce fait, c’est autour de quatre pôles, et non de deux, que s’organise la force de
cette couleur : un bon rouge feu, un mauvais rouge feu, un bon rouge sang, un mauvais rouge sang.
Le christianisme a de bonne heure adopté cette distribution du rouge entre quatre pôles - distribution
en partie héritée de la Bible - et en a fait un véritable système qui, en Europe, a peu à peu imprégné
tous les aspects, même profanes, de la symbolique de la couleur rouge.

Pris en bonne part, le rouge feu est celui de la Pentecôte et de l’Esprit Saint. C’est à la fois une
lumière et un souffle, puissant et chaleureux. Il brille, il anime, il purifie. Pris en mauvaise part, ce
rouge est celui des flammes de l’enfer. C’est un rouge qui détruit et qui torture, qui ravage et qui
supplicie. C’est aussi un rouge qui trahit et qui ment (il devient alors souvent roux), puisqu’il crée une
lumière pire que les ténèbres, à l’image du feu infernal qui brûle sans éclairer. C’est enfin la couleur
du Diable lui-même qui est rouge comme le feu et noir comme le monde souterrain. Son vêtement
est fréquemment rouge, ou bien rouge et noir.
Pris en bonne part, le rouge sang est celui du Sauveur : c’est un rouge rédempteur et sanctificateur qui
purifie et donne la vie. C’est lui qui est présent, sous l’espèce du vin, dans le sacrifice de la messe. Ce
rouge est dense, vif, dynamique ; il jaillit, procure joie et santé et représente le pôle le plus éloigné du
rouge infernal. À l’opposé, ce même rouge sang, pris en mauvaise part, n’est plus celui du Christ et de
la rédemption mais celui de la colère et de la violence. Il est Rubis, prince des gemmes, gemme des
princes par Jean-Luc Chassel *
Rouges, les gemmes peuvent l’être comme rien au monde. La densité de la couleur, magnifiée par la
lumière, la richesse des nuances, la dureté de la matière ont suscité la fascination, excité la
convoitise depuis l’aube des temps. Mais la rareté fait le prix : le faible nombre des sites producteurs,
les difficultés de l’extraction, la multiplicité des intermédiaires et les aléas des routes de commerce
ont longtemps réservé la possession de ces gemmes aux princes ou, tout du moins, aux élites.
Escarboucles, "balais" et grenats
La gemmologie distingue aujourd’hui trois principales familles de pierres rouges. L’appellation rubis
est réservée aux corindons (oxydes d’aluminium) ; par ordre de dureté et de préciosité, viennent
ensuite les spinelles (oxydes d’aluminium et de magnésium, qui n’ont été scientifiquement isolés
qu’au milieu du XIXe siècle) et les grenats (silicates bi-métallifères, aluminium et manganèse pour les
pyropes, aluminium et fer pour les almandins).
Avant l’avènement des principes de la chimie et de la physique modernes, le chromatisme était le
fondement essentiel de classification des pierres. Toutefois certaines propriétés naturelles des
cristaux (forme et dureté), ou encore leur provenance, étaient connues par les gens de métier et
interféraient dans la typologie. Ainsi la terminologie occidentale ancienne, bien que très fluctuante,
avait tendance à ranger les gemmes rouges en trois catégories :
- Les plus précieuses de toutes étaient de couleur rouge sang, rouge ardent : elles méritaient, par
excellence, les noms de "rubis" (du latin rubinum, de ruber, rouge) ou d’"escarboucles" (lat.
carbunculus, petite braise). Les meilleures brillaient même dans l’obscurité, disait-on. Cette catégorie
devait regrouper indistinctement des rubis provenant d’Inde, de Ceylan ou de Birmanie, les spinelles
les plus rouges voire quelques grenats d’une nuance exceptionnelle.

- Les variétés plus pâles, d’un rouge lavé, cendré ou virant au rose, constituaient les rubis "balais".
Leur tonalité moins forte les faisait considérer comme l’habitacle (le palais !) dans lequel naissait
l’escarboucle, ou bien comme le genre femelle de celle-ci. Certains auteurs rapportaient cependant
que les "balais" devaient leur nom à la région d’Orient où ils étaient principalement extraits et que l’on
identifie aujourd’hui comme le Badakshan – région montagneuse limitrophe de l’Afghanistan et du
Tadjikistan, aux sources de l’Amou-Daria et de son affluent, le Shignan – ou encore le Balaghat – sur
les rives du Penner, un fleuve côtier du sud-est de l’Inde, au nord-ouest de Madras.
Ces belles pierres sont aujourd’hui reconnues comme la variété rouge des spinelles ; mais dans le
monde arabe, on avait les déjà distingués par la forme du cristal et le degré de dureté, et on leur
réservait l’appellation de "la’l". Partout, de l’Orient à l’Occident, ces pierres étaient très recherchées,
surtout les plus grosses.
- Enfin, les espèces plus sombres, violacées, vineuses ou tendant au brun, portaient le nom de
grenats, du latin granatum, grain, inspiré de la forme des cristaux, trapus, aux nombreuses facettes,
auxquels l’érosion donne souvent un aspect grossièrement sphérique. Ce nom a été conservé pour
une famille de gemmes bien connue, dont les spécimens communs sont en effet d’un rouge sombre.
L’Orient et la Bohême en étaient, et sont encore, les principaux producteurs.
Cette classification ternaire laissait de côté d’autres variétés chromatiques, d’autres matières
précieuses ou communes. La cornaline, par exemple, très appréciée dès la préhistoire, et souvent
chauffée pour devenir plus rougeoyante, ou encore le jaspe rouge n’ont jamais eu qu’une valeur
modeste. Le corail, recherché pour sa couleur somptueuse, mais trop tendre et opaque, ne pouvait
rivaliser avec les gemmes.
Pierres glorieuses d’Orient
Par leur magnificence les pierres précieuses exprimaient plus que tout autre matière les vertus
symboliques de la couleur rouge rappellées par Michel Pastoureau. L’association avec le sang, le vin,
le feu, la puissance semble avoir été communément reconnue par les civilisations d’Orient et
d’Occident. Il n’est pas étonnant que les rois, les potentats, les castes guerrières, les élites aient
rivalisé pour s’approprier les plus beaux spécimens et en illuminer leurs parures.
Le malheur, pour les grands de l’Europe, fut que leurs homologues d’Orient eurent longtemps, grâce
au contrôle de sites de production et la maîtrise des voies de transit, l’avantage de se servir les
premiers ! De l’Inde au Moyen Orient, se constituèrent ainsi d’invraisemblables accumulations de
joyaux. Les sources ne permettent pas de juger précisément de toute l’ancienneté du phénomène,
mais l’exemple des Moghols, aux XVIe et XVIIe siècles, pousse au paroxysme une tradition bien
antérieure. Insatiables collectionneurs de rubis et de spinelles, les Moghols développèrent l’usage de
graver leur nom et ceux de leurs ancêtres sur les plus remarquables. Cette identification était efficace
à double sens : marquage des gemmes comme propriété de ces princes, et aussi célébration d’une
dynastie digne de posséder de tels trésors. Dans cet échange symbolique de puissance entre les

trésors et leurs détenteurs, les spinelles du plus beau rouge et du poids le plus impressionnant
acquirent en Inde moghole une sorte de statut officiel et reçurent le nom de "la’l jalâli" (spinelle rouge
glorieux) qui les attribuait d’office au prince.
Associées aux perles et aux émeraudes, plus rarement aux saphirs – dont la couleur était peu prisée
en Orient –, les gemmes rouges resplendissaient sur les aigrettes de turban, les attaches de
manteaux, les colliers et bracelets, les trônes… ou s’amoncelaient dans les coffres, comme un
capital de puissance au service des princes.
Quelques-uns de ces grands spinelles ont franchi les siècles et leurs tribulations ont accompagné
toute l’histoire politique de l’Orient et de l’Occident ! Le plus fameux, sinon le plus lourd (352 carats
tout de même !) appartenait aux sultans de Delhi lorsque Tamerlan s’en empara en 1398 et, le
déposant à Samarcande, lui donna le nom de "Tribut du monde". Il passa aux Séfévides d’Iran,
vainqueurs des Timurides, puis regagna l’Inde en guise de cadeau diplomatique aux Moghols.
Lorsque Nâdîr Châh pilla Delhi en 1739, il revint en Iran : là, en souvenir de sa lointaine et illustre
origine, il reçut une inscription au nom de Tamerlan. C’est sous le nom de "Tibur ruby" que les
Anglais le désignent, depuis qu’il fut offert à la reine Victoria. On peut l’admirer aujourd’hui, au centre
d’un collier, à la tour de Londres, entouré de deux autres spinelles gravés de noms d’empereurs
moghols.
Couronnes médiévales d’Europe
Rares donc à échapper à l’appétit des magnats orientaux, les gemmes rouges étaient d’autant plus
convoitées en Occident. Là encore, les sources nous manquent pour en retracer l’histoire aux
époques les plus anciennes. Les premières attestions sûres montrent en revanche qu’elle n’ont pas
seulement participé à l’apparat des princes, comme de simples éléments de parure ou de faste : par
leur exceptionnelle préciosité, c’est à la sacralité du pouvoir qu’elles ont été associées.
Le témoignage le plus précoce, semble-t-il, concerne les Capétiens.
Épousant en 1051 le roi Henri Ier, la princesse Anne de Kiev apporta dans sa dot une très belle
pierre rouge de plus de deux cent cinquante carats. D’où la principauté russe tenait-elle ce joyau ?
De péripéties commerciales avec le nord de l’Afghanistan, via l’Amou-Daria, la mer d’Aral, la
Caspienne et la Volga ? D’un cadeau diplomatique du califat de Bagdad ? Nous ne le saurons
jamais. Parvenue dans le trésor des Capétiens, la lourde gemme semble avoir joui d’un grand
prestige : au témoignage de l’abbé Suger, elle fut remise à Saint-Denis et sertie sur la plus
importante couronne du trésor royal, juste sur le bandeau frontal. On ne se contenta pas de lui
donner cette place d’honneur : elle fut chargée de protéger une des plus insignes reliques tutélaire de
la royauté, une sainte épine de la couronne du Christ déposée à Saint-Denis depuis l’époque
carolingienne. Au-delà du souci de parure, la combinaison ainsi réalisée énonçait une véritable
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%