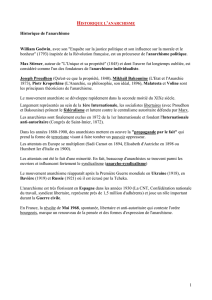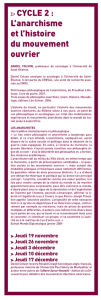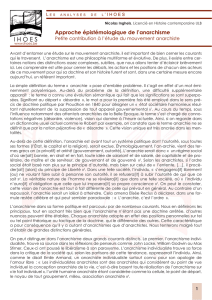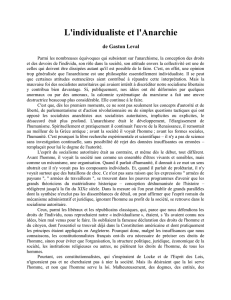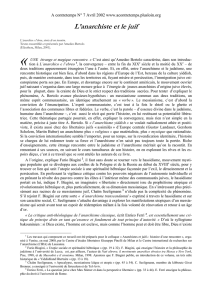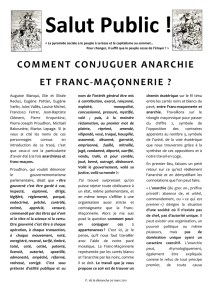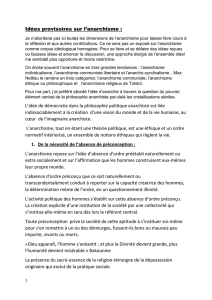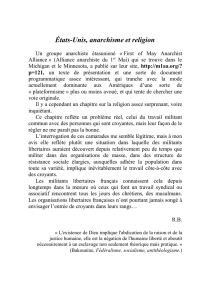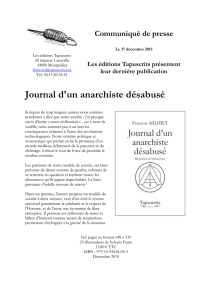PDF 520 Ko - Anarlivres

— 1 —
Charles-Auguste BONTEMPS
L’anarchisme
et le réel
Essai d’un rationalisme libertaire
Groupe Maurice-Joyeux
Paris 2002

— 2 —
L’ANARCHISME ET LE RÉEL
Le texte que nous proposons au lecteur
dans les pages qui suivent est la reproduction
intégrale de celui publié en 1963 par les édi-
tions “ Les cahiers francs ”.
Groupe Maurice-Joyeux

— 3 —
Ch.-Aug. BONTEMPS
L’ANARCHISME ET LE RÉEL
“ L’Anarchisme et le Réel ” est essentiellement, comme le
précise le sous-titre, un “ Essai d’un rationalisme libertaire ”, une
étude de la condition évolutive de l’homme, à la fois dans son
milieu biologique et dans son milieu social. La moitié de
l’ouvrage est consacrée à ce que fut l’anarchisme et à ce qu’il ne
peut plus être, à ses œuvres dans le passé et à leur continuité
dans l’avenir selon des méthodes nouvelles inspirées des leçons
de l’histoire. Il s’agit, selon ce que l’auteur appelle un “
individualisme social ”, d’impulser les évolutions vers “ un
collectivisme des choses et un individualisme des personnes ”
par une action propre à l’anarchiste qu’il définit comme étant
une constante intervention dans le social, “ en manière de
ferment ou de bactérie ”, par des injections de sérum “ tantôt
vivifiant et tonique, tantôt virulent ”, qui “ élabore des cellules
neuves et dissout les crasses ”.
Selon cette conception, l’anarchiste est un franc-tireur qui
doit, volontairement, renoncer à parvenir. En cela, il se situe
dans l’ordre de la primauté de l’esprit, mais de l’esprit fondé sur
le réel de la psychosomatique. Il lui faut donc d’abord se cons-
truire une philosophie fondamentale, se situer dans l’univers et
déterminer la condition de son destin, La seconde partie de
l’ouvrage étudie ces problèmes en analysant l’origine et le carac-
tère des religions, leur évolution du totémisme aux religions de
Salut.
La conclusion de cette étude dépasse l’anarchisme ou bien, si
l’on préfère, l’insère dans un contexte qui concerne tous les
hommes en tant que s’y définit le problème de leur destin.
•••

— 4 —
Motivation
L’essai que voici n’est pas une histoire critique de l’anarchisme. Son objet est
tout autre. J’ai voulu projeter une vue sur un devenir possible de l’anarchisme tel
que je le conçois, après quelque cinquante ans de réflexions sur des constats de
carences en regard de réussites telles que le syndicalisme et le fédéralisme dont
on ignore trop les sources libertaires, sans omettre la gémination de l’école, la
maternité consciente et la contraception, issues d’un Auguste Forel, d’un Paul
Robin, d’un Havelock Ellis, d’un B. Russell et de leurs émules.
Si les vues que j’expose ont l’inconvénient de m’être en partie personnelles,
tout au moins dans leurs motivations actuelles et dans un concept de vie rationa-
liste qui tient une grande place en cette étude et qui la conclut, elles restent néan-
moins fondées sur le meilleur de ce que nous ont laissé les pionniers de
l’anarchisme et qui a résisté à l’épreuve du temps.
Acquis et rejets sont envisagés de façon globale. Ce n’est point par choix dé-
libéré que des noms sont omis à mon regret. Je répète que je n’ai pas écrit une
histoire qui serait, d’ailleurs, incomplète et fautive comme celles qui ont été ten-
tées, tant l’anarchisme est divers par nature et peu en situation de conserver des
documents trop souvent compromettants en des temps héroïques. Les noms appa-
raissent lorsqu’ils sont particulièrement significatifs du fait considéré et peuvent,
par préférence, être cités au passé afin que nul ne se tienne comme étant mis en
cause.
Je confesse volontiers que mes réflexions doivent sans doute autant à l’étude
“ réactive ” des philosophes et des sociologues étrangers à l’anarchisme qu’à
celle de nos théoriciens. Ce sont aussi les polémistes avec lesquels j’ai controver-
sé tant de fois — des prêtres en particulier — qui m’ont fait mesurer les failles et
noter certaines incompatibilités.
Dans la partie conclusive de cet essai : “ L’anarchisme et la destinée ”, et
dans l’avant-dernier chapitre : “ Vue critique des religions ”, je me suis spécia-
lement attaché à une coalescence (fusion serait trop dire) des thèses modernes de
la philosophie scientifique et de la philosophie religieuse, sensible chez un Teil-
hard de Chardin, par exemple, bien qu’il me paraisse, en dépit de ses intentions
affichées, ne concevoir les antithèses que de façon à écarter les synthèses où le
christianisme se perdrait. Les conciliations ne s’inscrivent sans doute que dans un
avenir éloigné.
Dès maintenant, les prospections pourraient s’orienter dans ce sens puisque,
de part et d’autre, les droits de la personnalité sont affirmés, ce qui implique la
réciprocité et l’ouverture du dialogue. C’est dans cet esprit que la dernière partie
du présent ouvrage considère un rationalisme de l’anarchisme, le génitif étant,
dans ma pensée, signifiant de l’antisectarisme.
Ce livre a été écrit aussi en réaction à l’opinion fausse selon laquelle
l’anarchisme ne serait pas constructif. On ne conteste pas que ce préjugé se fonde
sur des raisons, entre autres les inconséquences découlant de formules peu ou

— 5 —
prou périmées. Il ne s’agit que d’une crise doctrinale comme en supportent toutes
les écoles dans la profonde révolution des idées qui affecte notre siècle. C’est à
cette crise que je propose de remédier.
Je crains que mes suggestions ne mécontentent quelques uns de mes vieux
camarades. Sont-ils sûrs de leur diapason ? Je n’ai cessé de constater, à
l’occasion de polémiques répétées — au Club du Faubourg notamment où le pu-
blic fut toujours très divers, changeant et bien informé — qu’une audience est
constamment ouverte aux idées libertaires dès qu’elles sont objectives et accor-
dées au réel. La vivacité même de nos critiques retient par l’accent de la fran-
chise, par ce qu’elles comportent d’effectif et de constructif si elles ne sont pas
faites en jonction d’un avenir problématique — ce qui n’est qu’une métaphysique
— mais dans la relativité du milieu où se débat l’homme vivant.
Mon objet est de donner aux jeunes, que le non-conformisme attire sans les
retenir, des raisons de durer dans une philosophie qui les a séduits et dont la pra-
tique les déconcerte. Combien, durant un demi-siècle d’activité, en ai-je vu
s’écarter de notre route et confirmer ainsi le fameux : “ Qui n’a pas été anar-
chiste à vingt ans ?” A quoi je réponds : “ Qui n’a pas commencé de vieillir
à vingt ans ?”
Or c’est avoir vieilli que de s’accrocher à de vénérables principes. Rien, pour
un libertaire, n’exige qu’un principe demeure ne varietur dans un milieu qui ne
cesse d’évoluer, rien sinon un atavisme de fidélité abstraite reçu du christianisme,
un sentiment conditionné d’aversion à l’égard du renégat, et surtout du renégat
de bonne foi, ce balafreur de dogmes.
Il faut avoir pris très tôt l’habitude de ne pas vivre derrière soi pour n’être
point enserré dans un héritage de manières de penser. Qu’on veuille bien consi-
dérer que si toute une vie s’est organisée à partir d’une philosophie anarchiste
découverte à dix-huit ans, que si l’on ne s’en est laissé détourner ni par les occa-
sions de parvenir ni par les revers et si, à un âge fort avancé, on continue de
s’identifier à cette philosophie, c’est sans doute que l’adaptation pragmatique
qu’on en fit n’est pas sans logique ni sans efficacité. Elle peut valoir pour
d’autres. Ne seraient-ils qu’une pléiade, qu’un trio, c’est assez — s’ils jouent et
parlent juste — pour que l’anarchisme, cette intégration de l’individu pensant,
soit assuré de sa pérennité.
•••••
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
1
/
106
100%