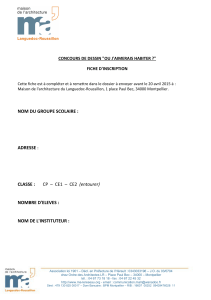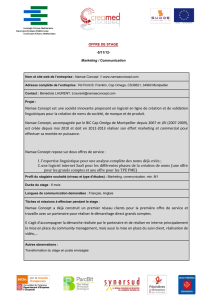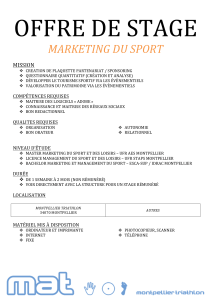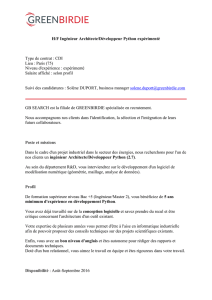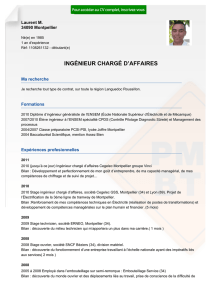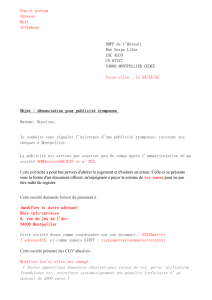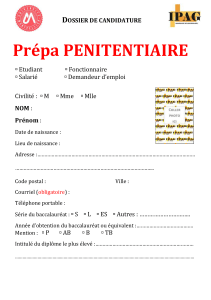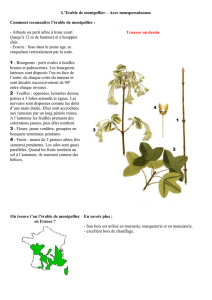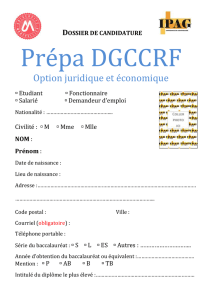le lycée pierre-mendès-france de montpellier

Le lieu
Entre champs d’oliviers et vignes, l’entrée sud-est de Montpellier,
en plein développement, vient d’acquérir sa figure de proue : le
lycée professionnel Pierre-Mendès-France réalisé par Nicolas Crégut
et Laurent Duport. Jusqu’ici mité par les bâtiments sans âme du
complexe ludique et commercial l’Odysseum, ce territoire en devenir
se distingue désormais par cet établissement scolaire au fronton
républicain. La composition orthogonale de cet îlot urbain hiérarchise
entre elles les différentes entités du programme, chacune dessinée
en tant qu’édifice remarquable.
L’Esprit du Lieu - Architecture
Collection dirigée par Michèle Leloup
Cette collection a pour volonté de sélectionner les bâtiments perti-
nents qui honorent l’architecture contemporaine. Retracer les étapes
majeures de leur édification, c’est raconter la genèse des nouveaux
espaces.
12,90 E
Collection L’ESPRIT DU LIEU
Architecture
Archibooks
Collection L’ESPRIT DU LIEU
Architecture
Collection L’ESPRIT DU LIEU Architecture
Archibooks
ISBN 978-2-35733-138-9
LE LYCÉE PIERRE-MENDÈS-FRANCE
LE LYCÉE PIERRE-MENDÈS-FRANCE
DE MONTPELLIER
CREGUT | DUPORT ARCHITECTES
Texte par Lionel Blaisse
Dans la même collection
LAM, le musée d’Art moderne de Lille Métropole,
Manuelle Gautrand architecture
Le lycée Élisa Lemonnier (Paris), Léonard | Weissmann
Dans le bois : halle de sport à l’INSEP
(Vincennes), François Leclercq
Le siège social de Bouygues Immobilier
(Issy-les-Moulineaux), Christian de Portzamparc
La Tour de Jussieu (Paris), Thierry van de Wyngaert
L’UFR de chimie Paris VII (Paris), X-TU
Lionel Blaisse
Architecte libéral jusqu’en 1998 et titulaire d’un
certificat en aménagement et management urbain,
Lionel Blaisse se consacre dorénavant à l’écriture
et au conseil spécialisé en architecture.
Rédacteur de dossiers et reportages pour la presse
magazine et professionnelle (Archicréé, Archistorm),
il est également l’auteur de treize ouvrages dont
le livre collectif périodique Temps denses (créé en
1999) qui analyse de façon transversale les temps
forts de la création en matière d’architecture, de
beauté, de communication, de design et de mode.
Il travaille régulièrement comme consultant auprès
de maîtres d’ouvrage, de cabinets d’architecture,
d’industriels du bâtiment, de marques de luxe et de
distributeurs de design.

NICOLAS CRÉGUT ET LAURENT DUPORT
Quel était, au départ, l’esprit du lieu ?
Laurent Duport : Ce nouveau quartier en périphé-
rie cumulait diverses contraintes sonores en raison de
la proximité de l’autoroute et de l’aéroport. L’étude de
faisabilité faisait cependant état d’une coulée verte, un
élément positif qui a retenu notre attention ; elle conduit
à un ancien mas du xviiie qui abrite un hôtel-restaurant,
sorte d’enclave paysagère au cœur d’un champ d’oli-
viers qui se situe en lisière de notre terrain en forme
d’équerre.
Nicolas Crégut : Ce mas historique est la mémoire du
lieu. Le schéma d’aménagement du concours mention-
nait sa conservation et nous avons décidé d’en faire un
atout, car cette entrée de ville ne nous offrait que très
peu d’éléments structurants auxquels nous raccrocher,
hormis le pôle commercial et ludique de l’Odysseum.
Comment avez-vous intégré ces contraintes ?
L.D. : Nous avons tenu compte de la nuisance de l’auto-
route pour implanter les ateliers de mécanique de ce
côté-là, afin de créer une barrière avec le reste de l’éta-
blissement. Ensuite, nous avons pris en compte une autre
contrainte, hydraulique celle-là, car les orages sont vio-
lents dans notre région : lorsqu’il pleut, les quantités
d’eau sont conséquentes sur un laps de temps très court,
c’est pourquoi nous avons organisé des noues paysa-
gères permettant la rétention de l’eau, afin qu’elle soit
stockée et qu’elle s’écoule plus lentement.
L’eau récupérée est-elle destinée à un usage domestique
ou s’agit-il seulement d’une technique de régulation ?
L.D. : D’évidence, l’eau récupérée servira à l’arrosage
des espaces verts, mais ce dispositif n’est pas l’ap-
plication d’une réglementation de la HQE. Pour nous,
construire « durable », c’est respecter des notions très
basiques comme l’orientation du bâtiment, ou privilégier
ENTRETIEN

des règles de bon sens qui consistent à éviter d’installer
des parois vitrées au sud, ou des auvents en prise directe
avec le mistral. En ce qui concerne l’eau, il ne s’agit pas,
ici, de faire une économie substantielle, même si c’est
le cas, mais d’être attentifs à la gestion de ce territoire
soumis à certains excès climatiques.
Pourquoi la porte d’entrée est-elle si majestueuse ?
L.D. : La porte d’entrée est imposante afin de marquer la
présence du premier établissement public dans ce mor-
ceau de ville en devenir ; il était donc impératif de lui
donner un fronton lisible et repérable tel un signal. Cette
volonté n’est pas étrangère au fait que les seuls bâti-
ments visibles depuis l’autoroute sont ceux du complexe
Odysseum et des entrepôts Ikea, autrement dit, il nous
fallait trouver une autre échelle d’intervention.
Le fronton est d’un blanc immaculé, quelle en est la
raison ?
N.C. : Montpellier est une ville du Moyen-Âge dont les
hôtels particuliers ont été construits dans des blocs
de pierre blanche, ce matériau spécifique présent
depuis l’époque romaine en Languedoc-Roussillon (la
Narbonnaise) et sa couleur appartiennent au patrimoine
architectural du Sud. Ce contexte pris en compte, notre
parti pris de travailler avec un béton autoplaçant à l’as-
pect de marbre poli devait trouver sa légitimité. Nous
avions vérifié la pertinence de ce choix en le testant sur
un gymnase construit à Nîmes en 2002 que nous avions
traité en panneaux de béton poli. Cette première expé-
rience étant concluante, nous avons poursuivi avec la
construction du lycée lui-même, en décidant de couler
les panneaux sur place. C’est un point sur lequel nous
ne voulions pas lâcher. La réalisation du portique s’est
avérée assez complexe mais nous avons eu la chance
d’opérer avec l’entreprise Dumez/Eiffage qui a relevé ce
défi en apportant des solutions techniques innovantes,
notamment des poutres inspirées des ouvrages d’art, et
des calepinages très précis afin de couler le béton en
pente, pour concevoir des voiles de 12 mètres de hauteur
et le dévers en porte-à-faux sur 8 mètres, lesquels ont
été réalisés en une seule fois afin d’éviter la différence
de texture et de couleur. Ce fut de l’expérimentation pure,
mais quelle satisfaction !
Les délais qui vous ont été accordés ne vous ont-ils pas
mis une pression constante ?
L.D. : En effet, il s’est passé trois ans pour boucler les étu-
des et le chantier, ce qui est peu pour réaliser un lycée de
29 000 m² composé de sept bâtiments. Par conséquent,
aucun frein ne devait ralentir le déroulement des travaux.
La Région, maître d’ouvrage, avait choisi de traiter en
entreprise générale pour se prémunir de l’éventuelle
défaillance qui peut exister dans les marchés en corps
d’état séparés ; de fait, ce choix implique de bons rap-
ports humains, sinon personne n’arrive au bout en temps
et en heure. La confiance fut acquise à partir du moment
où la constructibilité était réglée. Certes, notre conduite
du chantier a beaucoup compté dans l’exécution des tra-
vaux, car c’était la première fois que l’entreprise mettait
en place ce béton autoplaçant. Ce moment-là s’est révélé
un élément important de cohésion sur le chantier.
Le patio semble avoir gouverné le dispositif spatial. Est-ce
lui qui a conditionné votre réflexion ?
N.C. : Ce n’est pas un patio, mais un espace formel ins-
piré du cloître. L’élément déterminant qui a participé à
cette écriture spatiale tient au mail existant très ordon-
nancé. Cette collection d’arbres en alignement, non seu-
lement nous l’avons gardée mais nous l’avons magnifiée,
et, à partir de là, nous « tenions » une articulation entre
les deux grands bâtiments principaux qui se font face. De
fait, le vide occasionné se trouve dans le prolongement
du portique de manière à ce que l’on arrive dans le lycée
par ce jardin offert comme une promenade. Il est dessiné
en creux et à son extrémité un plan en croix distribue,

d’une part, cinq bâtiments en peigne, et d’autre part, la
maison des élèves et le réfectoire. Ce croisement est le
point d’équilibre de la composition nord/sud.
L.D. : Les passerelles aériennes servent à traverser les
séquences plantées pour passer d’un bâtiment à l’autre,
mais les étudiants peuvent éventuellement prendre les
passages annexes pour rester à l’ombre.
L’ombre et la fraîcheur tiennent ici un rôle clef, comme si
un cadran solaire avait guidé votre esprit. Est-ce le cas ?
L.D. : Montpellier est une ville à fort ensoleillement une
grande partie de l’année, et notre désir était d’organiser
des déambulations protégées toute la journée. Par exem-
ples, le grand auvent devant le restaurant autorise des
haltes ombragées ; les escaliers à claire-voie, en tête des
bâtiments abritant les salles d’études, sont eux aussi des
passages où l’on peut se croiser ou bavarder au frais.
De la même manière, la coursive extérieure longeant le
grand bâtiment d’enseignement situé plein sud permet
un usage annuel puisqu’elle est à l’abri du vent dominant
du nord et dégage une vue extraordinaire vers la mer.
Notre objectif était de donner aux élèves des perspecti-
ves uniques afin qu’ils aient la sensation d’être dans un
lieu valorisant. L’aménagement d’une salle d’expositions
à l’entrée participe de cette démarche, qui accueille des
œuvres prêtées par le Frac de la Région. Quant au CDI
traité en double hauteur, il est traversant nord/sud, et ses
baies équipées de brise-soleil sont orientables de façon à
offrir aux élèves, été comme hiver, un climat de bien-être
pour étudier.
Y a-t-il eu une volonté de donner à cet établissement tech-
nique une image d’excellence ?
L.D. : Il y a surtout eu la volonté d’inverser le regard. Ce
dessein passait par une attention portée sur le confort
d’usage. On retrouve cette constance dans la salle de
restaurant ; sa spatialité autorise la rotation de plusieurs
services pour les 1 500 élèves. D’où la nécessaire qualité
acoustique traitée par travail spécifique sur le plafond
en forme de vagues qui absorbent le bruit. Confort aug-
menté par le patio et le jardin japonisant arrosés par
une lumière naturelle est/ouest. Cette notion de confort
est également présente dans les ateliers de mécanique :
leurs sols ne sont pas goudronnés comme à l’accoutumé
et le traitement de l’acoustique et de la thermique rend
l’atmosphère plus calme, ni trop chaude ni trop froide ;
aussi les portes des garages ont-elles été redessinées
pour s’inscrire dans l’écriture douce qui est la nôtre. Ce
lycée a été externalisé au milieu de nulle part, il fallait
donc lui donner davantage, c’est pourquoi nous avons
mis toute notre énergie dans certains détails.
Propos recueillis par Michèle Leloup

Entraperçu depuis l’autoroute, le sculptural fronton du lycée impose son
statut républicain ; il est le premier bâtiment public dans ce quartier en
devenir où sont prévus des immeubles de cinq étages.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%