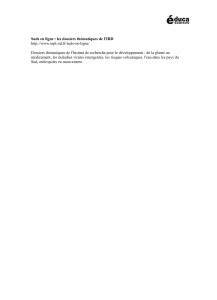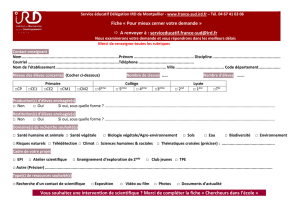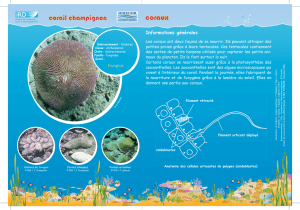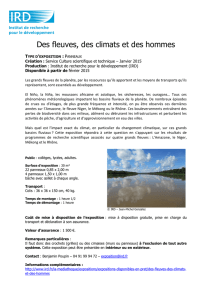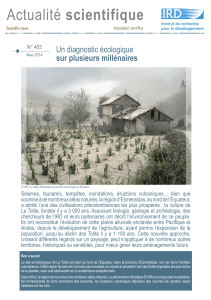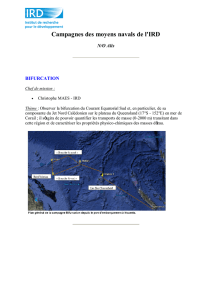Les voies alimentaires d`une meilleure nutrition Marbre

Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 23 - janvier/février 2004
2
Actualités
E
n Afrique de l’Ouest, des
retards de croissance touchent
plus d’un tiers des enfants de
moins de 5 ans et environ 10 %
d’entre eux présentent un poids insuf-
fisant pour leur taille. Parallèlement,
des carences en micronutriments, en
particulier en vitamine A, fer, zinc et
iode, affectent les groupes les plus vul-
nérables, enfants, femmes enceintes
ou allaitantes. Ces carences sont res-
ponsables d’un ralentissement de la
croissance et du développement intel-
lectuel et physique des
enfants, d’une aug-
mentation de la mor-
talité infantile et de
manifestations plus
spécifiques (cécité,
goitre, anémie…).
Dans de nombreux
pays d’Afrique, la situa-
tion est particulièrement
préoccupante dans la
mesure où,
contrai-
rement à ce que l’on observe sur les
autres continents, l’état nutritionnel
des populations s’est aggravé au cours
de la dernière décennie.
La lutte contre les carences en micro-
nutriments fait classiquement interve-
nir deux types de stratégies : la supplé-
mentation ou les voies alimentaires. La
supplémentation consiste à distribuer
les micronutriments sous la forme de
médicaments (capsules, comprimés…)
dont les fréquences de distribution
dépendent de la nature du micronutri-
ment concerné. Les voies alimentaires
encore appelées approches fondées sur
l’alimentation (« food-based approa-
ches ») considèrent les aliments, qu’ils
soient à l’état brut, transformés ou
enrichis, comme le principal moyen de
prévenir les déficiences nutritionnelles.
Cela correspond à un ensemble de
stratégies complémentaires qui impli-
quent les secteurs de l’agriculture, de
la technologie alimentaire et de l’édu-
cation/communication. Parmi les diffé-
rentes voies proposées, on distingue
généralement : la diversification de la
production des aliments ; l'améliora-
tion des procédés technologiques uti-
lisés pour la transformation, le stoc-
kage et la commercialisation des
aliments riches en nutriments ;
et la fortification qui a pour
objectif d’enrichir
en micronu-
t r i m e n t s ,
© IRD/S.Trèche
Organisé conjointement par les
universités de Ouagadougou
et de Wageningen, l’IRD et la FAO,
l’atelier international de Ouaga-
dougou a réuni 189 participants en
provenance du Burkina Faso (91),
de 18 autres pays africains (61), de
5 pays européens (33), des États-
Unis, du Canada, du Mexique et du
Viêt-nam. Par rapport aux objectifs
du premier atelier tenu en 1999 sur
les petites industries agroalimen-
taires pour une nutrition saine en
Afrique de l’Ouest, cette deuxième
rencontre a pris en compte l’en-
semble des approches alimentaires
susceptibles de contribuer à amé-
liorer les situations nutritionnelles
en Afrique. Douze chercheurs ou
ingénieurs et 10 doctorants de l’IRD
y ont présenté leurs travaux. Les
résumés des 105 contributions
orales ou posters et les textes inté-
graux d’une cinquantaine de ces
contributions sont accessibles sur le
site Internet de l’atelier
Un concours de posters réservé
aux jeunes scientifiques a éga-
lement été organisé. Parmi les
22 candidats, le jury interna-
tional a choisi de récompen-
ser Ayassou Kossiwavi
(ancienne stagiaire de DEA de
l’IRD Burkina Faso), Tahirou
Traoré, allocataire de
recherche de l’IRD, et
Lynda Njongmeta, docto-
rante de l’université de
Ngaoundéré (Cameroun).
●
dans les unités de production, certains
aliments d’usages fréquents. Depuis
peu, les Centres Internationaux de
Recherche Agronomique (CIAT,IFPRI)
développent une nouvelle voie, la bio-
fortification. Elle consiste à créer, sélec-
tionner et diffuser, pour les principaux
aliments de base, des variétés ayant
des teneurs naturelles en micronutri-
ments considérablement plus élevées
que les variétés traditionnelles.
Par rapport à la supplémentation, les
voies alimentaires sont considérées
comme durables et d’un meilleur rap-
port coût/efficacité. Elles présentent, par
ailleurs, l’avantage de permettre la prise
en compte simultanée de plusieurs
types de carences. Elles diffèrent néan-
moins de manière importante selon les
niveaux d’implication des (bio)techno-
logues et des éducateurs et par les coûts
nécessaires pour leur mise en œuvre.
L’atelier international qui vient de se
tenir à Ouagadougou a principalement
permis d’analyser l’état actuel des
connaissances, les expériences et les
leçons sur les voies alimentaires élabo-
rées et mises en œuvre en Afrique de
l’Ouest, en s’intéressant tout particuliè-
rement au rôle des technologues ali-
mentaires et des nutritionnistes. Il en
est principalement ressorti que, pour
chaque contexte, le choix des voies à
privilégier devrait s’appuyer sur des
diagnostics précis de situation. En
Afrique de l’Ouest, compte tenu de
l’importance de l’autoconsommation
pratiquée par les populations encore
très majoritairement rurales et du faible
niveau de développement des indus-
tries agroalimentaires, les voies les plus
prometteuses restent la diversification
et l’amélioration des procédés techno-
logiques traditionnels. La supplémenta-
tion et la fortification restent cepen-
dant souvent préférées par les
gouvernements et les bailleurs de
fonds persuadés de leur plus grande
efficacité à court terme. Enfin, comme
tous les ateliers s’intéressant à l’amélio-
ration des situations nutritionnelles, la
réunion de Ouagadougou a insisté sur
l’impérieuse nécessité de favoriser l’in-
terdisciplinarité ainsi que la circulation
de l’information entre chercheurs et
acteurs du développement.
●
Contact
Serge Trèche
Serge.T[email protected]
WEB http://lombila.univ-
ouaga.bf/fn2ouaga2003
© IRD/J.-J. Lemasson
© IRD/S.Trèche
Les voies alimentaires
d’une meilleure nutrition
Du 23 au 28 novembre 2003, Ouagadougou accueillait un atelier international sur les
Voies alimentaires d'amélioration des situations nutritionnelles en Afrique de l'Ouest : le
rôle des technologues alimentaires et des nutritionnistes.
IRD - 213, rue La Fayette -
F - 75480 Paris cedex 10
Tel. : 33 (0)1 48 03 77 77
Fax : 33 (0)1 48 03 08 29
http://www.ird.fr
Directeur de la publication
Serge Calabre
Directrice de la rédaction
Marie-Noëlle Favier
Rédacteur en chef
Olivier Dargouge ([email protected])
Comité éditorial
Marianne Berthod, Jacques Boulègue,
Patrice Cayré,
Jean-Michel Chassériaux,
Nathalie Dusuzeau, Yves Hardy,
Jacques Merle, Jean-Claude Prot,
Yves Quéré, Anne Strauss,
Hervé de Tricornot, Gérard Winter
Rédacteurs
Marie-Lise Sabrié (rubrique Recherches
Marie Guillaume ([email protected])
Samuel Cordier ([email protected])
Olivier Blot ([email protected])
Correspondants
Fabienne Beurel-Doumenge (Montpellier)
,
Jacqueline Thomas (Dakar),
Mina Vilayleck (Nouméa)
Ont collaboré à ce numéro
Cédric Duval
Michel Dukhan
Photos IRD – Indigo Base
Claire Lissalde
Danièle Cavanna
Photogravure, Impression
Jouve, 18, rue Saint-Denis,
75001 Paris - Tél. : 01 44 76 54 40
ISSN : 1297-2258
Commission paritaire : 0904805335
Dépôt légal : février 2004
Journal réalisé sur papier recyclé.
Le journal de l'IRD
Pourquoi, dans certaines régions d’Asie, les gisements
de rubis se trouvent-ils toujours inclus dans des
marbres ? C’est la question à laquelle des géologues
ont essayé de répondre en étudiant les mécanismes
tectoniques et géochimiques impliqués dans la
formation des gisements. La solution est plutôt salée.
À
l’image du célèbre gisement
de Mogok au Myanmar (ex-
Birmanie), d’où sont extraits
les rubis de la plus haute qualité
gemme, les régions d’Asie Centrale et
du Sud-Est hébergent les gisements de
rubis les plus prisés.
Ces gisements présentent une particu-
larité qui intéresse les scientifiques de
l’IRD et CRPG/CNRS1depuis plusieurs
années : les cristaux de rubis qu’ils
recèlent se présentent systématique-
ment inclus dans des marbres, qui sont
des calcaires transformés à haute tem-
pérature. Or, certains constituants
majeurs du rubis – principalement
l’aluminium, le chrome et le vanadium
– sont normalement absents des
marbres. Sur le plan minéralogique en
effet, le rubis est la variété chromifère
du corindon gemme, c’est-à-dire un
oxyde d’aluminium dont quelques ions
aluminium ont été substitués par du
chrome. Celui-ci contribue avec le
vanadium à donner au cristal sa cou-
leur rouge. Des recherches ont donc
été lancées pour comprendre les
mécanismes de formation de ces
gisements, leur âge et leur significa-
tion dans le fonctionnement des zones
profondes de la couche terrestre. En
combinant les données de terrain et les
résultats d’analyses géochimiques réali-
sées au laboratoire sur des échantillons
provenant des différents gisements
répertoriés de l’Afghanistan au Viêt-
Nam, les chercheurs sont parvenus à
établir un modèle génétique inédit,
valable pour l’ensemble de ces gise-
ments de rubis associés aux marbres2.
Ainsi, l’analyse des inclusions liquides
piégées par les rubis lors de leur cristal-
lisation a révélé l’intervention de
fluides nourriciers salés et riches en gaz
carboniques. Ces derniers proviennent
de la dissolution à hautes températures
de sels contenus dans des couches
dites à évaporites3que l’on retrouve
dans les marbres impurs de certaines
régions d’Asie, riches en argiles et en
matières organiques. Ces fluides ont
ensuite été mis en mouvement à la
faveur
des contraintes
tectoniques, provoquant ainsi des réac-
tions chimiques qui ont permis la mobi-
lisation de l’aluminium et des éléments
chromophores du rubis, présents en
très faible quantité. La dissolution des
sels des couches à évaporites a
entraîné au sein des marbres la créa-
tion de cavités dans lesquelles du rubis
très pur, aux facettes bien développées
a pu cristalliser.
Contrairement aux études précédentes,
le modèle proposé met donc en évi-
dence l’intervention de sels et de fluides
minéralisateurs d’origines métamor-
phiques. Inédit pour le rubis naturel, il se
révèle par ailleurs proche de la méthode
des sels fondus utilisée dans l’industrie
pour la production d’aluminium.
●
Contact
Gaston Giulini
1. Ces recherches associent l’UR 154,
Déformation de la lithosphère continentale
en zones de convergence et transferts de
matière, de l’IRD, le Centre de recherches
Pétrographiques et Géochimiques / CNRS de
Nancy, l’UMRG2RR de l’Université Henri-
Poincaré de Nancy et l’UMR 5025 LGCA
(Laboratoire de géodynamique des Chaînes
Alpines) de Grenoble. Le projet de recherche
sur les gemmes, développé au sein de l’UR
154 de l’IRD est orienté sur l’étude des gise-
ments de rubis en Asie du Sud-Est. Depuis
1998, des partenariats ont été établis au
Viêt-nam avec l’Institut des Sciences Géolo-
giques de Hanoï et avec le service géolo-
gique du Pakistan et le soutien du Service
culturel de l’Ambassade de France à
Islamabad.
2. Ces travaux ont fait l’objet de la thèse de
Virginie Garnier.
3. Ces évaporites correspondent à de l’an-
hydrite (sulfate de calcium) et des sels
comme la halite et la sylvite (chlorures de
sodium et de potassium).
Marbre, sel, et rubis
© IRD/ G. Giuliani
1
/
1
100%