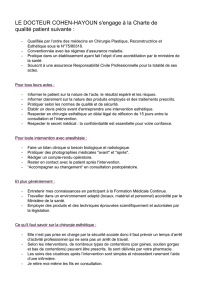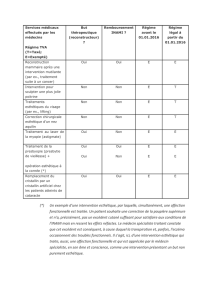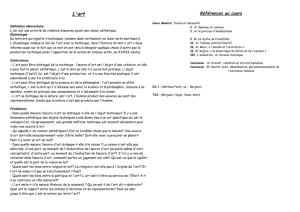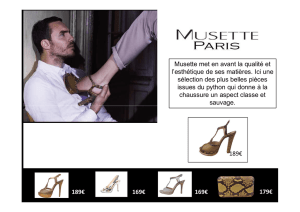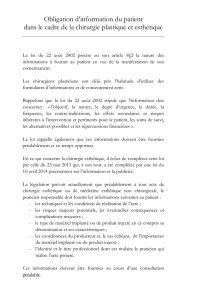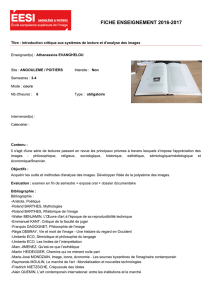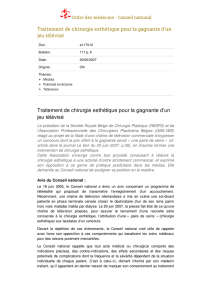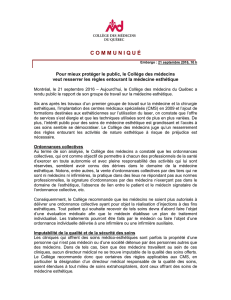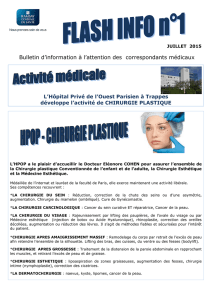Appel à communication [PDF - 237 Ko ]

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL
TOUT CE QUE L’ESTHETIQUE PERMET !
(A L’ENDROIT ET AU-DELA DU CINEMA)
Colloque international organisé par Térésa Faucon et Barbara Le Maître
(CRECI/Centre de recherche en esthétique du cinéma et des images)
à l’Institut National d’Histoire de l’Art du 15 au 18 février 2012.
Appel à communication
« Cinéma » qualifie un objet complexe – éparpillé, comme on le sait, entre commerce,
spectacle, industrie, art, dispositif(s), ensemble d’images en mouvement. Nombreuses
sont les disciplines qui s’en saisissent et définissent la méthodologie de recherches
engagées à son endroit. Il sera ici question de mettre l’accent sur les différentes
modalités selon lesquelles la recherche consacrée à ce médium emprunte les voies de
l’esthétique.
Une conviction se trouve à l’origine de ce colloque, dans le prolongement du constat
formulé par Jeff Wall : « J’ai toujours pensé que la photographie avait obtenu son statut
artistique grâce au cinéma, et qu’avant que le cinéma ne devienne, à l’évidence, une
forme d’art majeure, personne n’était en mesure de comprendre les problèmes posés
par la photographie face aux traditions picturales.1 » Le cinéma a bouleversé, redéfini
la relation entre les médiums, et cela suffit à dire à quel point il constitue un problème
essentiel pour l’esthétique. Reste à savoir à quoi nous pensons lorsque nous
prononçons le terme d’esthétique.
L’esthétique et ses objets
Que signifie, en effet, le terme d’esthétique ? Doit-on en limiter l’acception aux seules
philosophies de l’art, ou bien le terme englobe-t-il désormais toute approche soucieuse
1 « Mark Lewis, un entretien avec Jeff Wall » (1993) in Jeff Wall. Essais et entretiens 1984-2001, Ecole
nationale supérieure des beaux-arts, Paris, 2001, 2004 (édition établie et présentée par Jean-François
Chevrier), p. 238.

de comprendre la plasticité, le jeu des formes ? Cas échéant, toutes les formes, tous
les objets visuels (ou audiovisuels) sont-ils susceptibles d’être ressaisis au moyen d’un
seul et unique appareil conceptuel, ou bien l’esthétique est-elle contrainte de se re-
spécifier en fonction des exigences inhérentes à tel ou tel objet ? C’est que, pour le
dire brutalement, une chose est de parler d’esthétique, une autre, d’esthétique des
images, une autre encore, d’esthétique du cinéma.
On pourrait, au demeurant, se demander dans quelle mesure l’esthétique peut encore
s’étalonner sur un médium, ou sur un dispositif corrélé à ce médium. Plus largement,
quels sont (ou peuvent être) les objets de l’esthétique ? Sans doute, au temps présent,
l’idée d’esthétique du cinéma ne peut avoir ni le même sens, ni la même pertinence
que dans les années 1920, dès lors qu’elle ne coïncide plus qu’en partie avec l’état
contemporain des images en mouvement – l’image filmique étant désormais, ainsi
qu’on le sait, à la fois au-dedans et au-dehors du cinéma (ici identifié au dispositif selon
lequel il s’est majoritairement établi).
Questions de disciplines
Se demander « ce que permet l’esthétique » implique aussi de revenir sur certaines
découpes structurantes qui informent nos tentatives d’élaboration de savoirs vis-à-vis
du cinéma. Au premier chef, celle-ci : Histoire, esthétique. Quoique communément
énoncée, cette articulation ne va pas de soi et mérite, à ce titre, d’être réexaminée :
« Comment faire l’histoire de ces images ? comment faire l’histoire des dispositifs dans
lesquels elles ont été produites ? et l’histoire des conceptions de l’image dont elles
relèvent2 ?» Si, ainsi que le suggère Jacques Aumont, ce qui concerne le cinéma en
tant qu’image (ou ensemble d’images hétérogènes) et les singularités formelles des
films ne se laisse guère agencer sans difficulté selon la raison historienne, comment
articuler, malgré tout, histoire et esthétique ? Selon quelles modalités ou sous quelle(s)
forme(s) ? Les modèles en vigueur dans le champ de l’histoire de l’art, par exemple,
l’usage régulier de périodisations conçues en termes de styles, peuvent-ils être de
quelque secours, s’agissant du cinéma ?
L’interaction disciplinaire, par laquelle l’esthétique trouve à se redéfinir, ne s’arrête
évidemment pas là. Quoique rapportable, en premier lieu, à l’histoire et à la philosophie
de l’art, la théorie esthétique se nourrit aussi bien, et c’est particulièrement visible
aujourd’hui, des acquis de l’anthropologie ou de la biologie. Voilà une dizaine
d’années, un colloque au Fresnoy intitulé Plasticité, signes des temps avait ainsi
regroupé, autour d’une même table, un biologiste, un philosophe et un historien d’art.
Aujourd’hui, l’exposition sur La Fabrique des images, présentée au Musée du Quai
Branly, repense le territoire du figurable à partir de quatre modèles, dressés sur des
catégories d’ordre anthropologique.
Rappelons que les théories esthétiques ont aussi, tout au long de leur histoire, joué
d’autres articulations disciplinaires, en empruntant des outils théoriques aux
mathématiques (la géométrie, les algorithmes, la théorie des catastrophes) et à la
physique (les lois de la relativité, de la physique quantique). Ces modèles ont permis
2 Jacques Aumont, « L’histoire du cinéma n’existe pas » in Cinémas, vol. 21, n° 2-3, Des procédures
historiographiques en cinéma, à paraître.

de réfléchir aux paramètres fondamentaux des arts du temps et de l’espace, en
particulier des images en mouvement, et de repenser le paradoxe du continu et du
discontinu, comme plusieurs théories en témoignent (Bergson, Epstein, Merleau-Ponty,
Deleuze). Tous ces échanges attestent la part d’inventivité de théories essentiellement
heuristiques.
Analyse esthétique, Théorie esthétique
Enfin, outre ces différents ensembles de problèmes, il sera utile d’interroger
l’articulation entre théorie esthétique et analyse formelle – cette dernière formule
exigeant, bien entendu, d’être précisée. D’un côté, le profit escompté du geste
analytique n’est pas toujours de contribuer à une élaboration théorique – dans ce cas,
l’analyse est en un sens auto-suffisante, l’étude de son objet constituant son propre
horizon. D’un autre côté, il existe bien des manières de concevoir la relation entre le
geste analytique et la réflexion théorique, depuis l’étude d’un objet convoqué à titre
d’exemple, afin de discuter ou d’enrichir une théorie déjà constituée, jusqu’à la
proposition théorique « inédite », forgée au moyen d’une analyse pour ainsi dire sans
précédent.
En somme, qu’elle informe le geste analytique ou l’élaboration théorique, qu’elle soit
considérée comme une discipline ou un carrefour disciplinaire, héritant ou initiant
d’importantes refontes méthodologiques, quels que soient, encore, les objets qu’elle se
donne, comment penser l’esthétique ?
Rappel des axes du colloque :
• Croisements disciplinaires : esthétique et autres disciplines (anthropologie, histoire,
etc.)
• Esthétique « de quoi ? » : Objets de l’esthétique (médium ? image ? etc.)
• Articulation entre geste analytique et théorie esthétique
Lieu : Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA) : 2, rue Vivienne, 75002, Paris, en
salle Vasari.
Date limite pour la remise des propositions : les propositions d’intervention peuvent
être envoyées, jusqu’au 30 septembre 2011, à teresa.faucon@univ-paris3.fr et
ainsi qu’un résumé d’environ 1500 signes, et une bio-bibliographie d’une dizaine de
lignes (mentionnant l’appartenance institutionnelle de l’auteur et ses principales
publications).
Durée des interventions : la durée prévue pour chaque intervention est de 35
minutes. Un temps conséquent sera ensuite laissé à la discussion.
1
/
3
100%