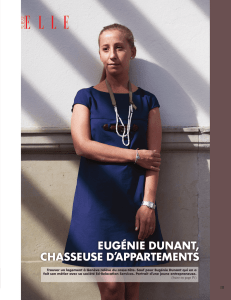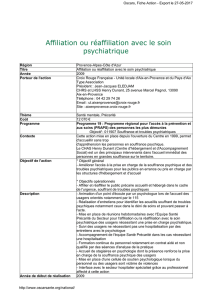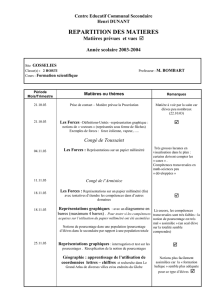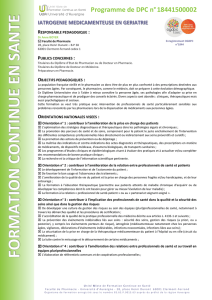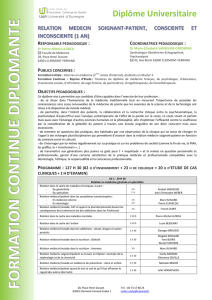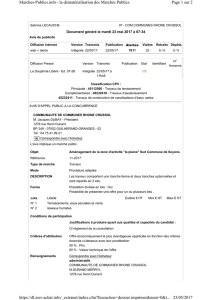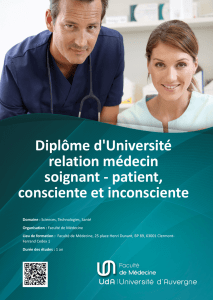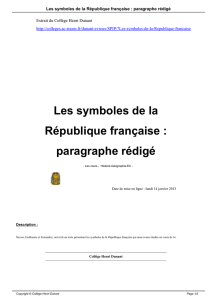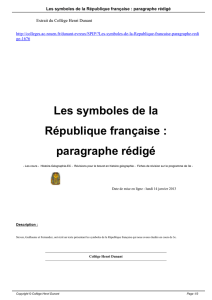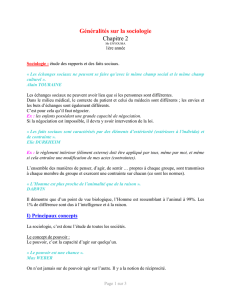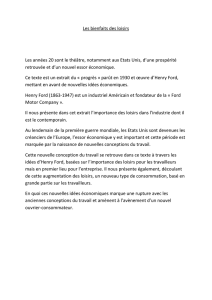Chronologie de la vie d`Henry Dunant

Sommaire
1. Chronologie de la vie d’Henry Dunant
2. Extrait de Un Souvenir de Solférino d’Henry Dunant
3. Le pays d’Henry Dunant
4. Où va l’humanitaire ?
5. Pour en savoir plus…
6. Ecrire une pièce sur Henry Dunant
7. Dunant – les personnages de la pièce
8. Dunant – résumé de la pièce
9. Dunant – Scène 6
10. A quoi servent les images ?

Chronologie de la vie d’Henry Dunant
8 mai 1828 – naissance au 12 de la rue Verdaine à Genève. Son père Jean-Jacques Dunant,
négociant, est juge à la Chambre des Tutelles qui s’occupe du sort des orphelins ; sa mère,
Antoinette Colladon, très pieuse, s’occupe de charité.
Mauvais élève au collège, le jeune Henry ne remporte que les prix de piété. Il visite les pauvres,
les malades et les prisonniers. Grand lecteur de la Bible, il forme en 1847 un groupe d’études
bibliques avec des jeunes gens de son âge – la Réunion du jeudi – qui deviendra en 1852 les
Unions chrétiennes de jeunes gens.
1849 – Henry Dunant commence son apprentissage à la banque Lullin & Sauter, qui l’envoie en
mission en Algérie. Il rêve de fertiliser et d’industrialiser le pays. En 1855, le gouvernement
français lui accorde sa première concession en Algérie ; il construit un moulin, mais ne reçoit pas
de réponse quant au développement futur de son domaine.
8 janvier 1858 – Le Conseil d’Etat de Genève autorise la Société anonyme des Moulins de Mons-
Djemila fondée par Dunant.
Avril 1859 – Arguant qu’il descend d’une famille exilée de France pour des raisons religieuses,
Dunant demande la nationalité française pour faire avancer ses affaires qui stagnent en Algérie.
25 juin 1859 – Sans réponse de l’administration pour sa colonie algérienne, Dunant veut
s’adresser à Napoléon III en personne et se rend en Italie où l’Empereur s’est rendu pour livrer
bataille, aux côtés des Italiens, à l’Autriche, puissance occupante. Dunant arrive à Solférino le
lendemain de la bataille et se dévoue aux blessés abandonnés par des services sanitaires
insuffisants.
8 novembre 1862 – Dunant publie à compte d’auteur Un souvenir de Solférino et l’envoie aux
souverains et gouvernants de l’Europe. Le livre provoque une immense émotion.
9 février 1863 – La « Société genevoise d’utilité publique » décide de mettre en pratique les idées
du Souvenir de Solférino et forme une commission, le « Comité international de secours aux
blessés », embryon du futur CICR. Sous la présidence du Général Dufour, la commission
rassemble le Docteur Louis Appia, Théodore Maunoir, Gustave Moynier et Henry Dunant.
1863-1864 – Dunant sillonne l’Europe pour propager son idée de sociétés volontaires de secours
aux blessés. Du 26 au 29 octobre 1863, une Conférence préparatoire réunit les représentants de14
nations à l’Athénée de Genève. Réunie entre le 8 et le 22 août 1864, une Conférence
diplomatique débouche sur la Convention de Genève, dont les dix articles préfigurent la charte de
la future Croix-Rouge.
1867 – Alors qu’il est invité à la Cour royale de Prusse et que son buste va être couronné de
lauriers à l’Exposition universelle de Paris, Dunant, qui a négligé ses affaires et s’est lancé dans

des spéculations hasardeuses, est acculé à la faillite. Les tribunaux genevois le condamnent pour
avoir « sciemment trompé ses associés ». A la suite de cette faillite retentissante, Gustave
Moynier fait pression sur Dunant pour qu’il démissionne du Comité ; Dunant s’exécute le 25
août ; il a déjà quitté Genève, où il ne reviendra plus.
1867 – Dunant lance une « Bibliothèque internationale universelle » destinée à populariser les
chefs-d’œuvre de toutes les cultures, et tente, par l’intermédiaire d’un « Comité pour la
Palestine » qu’il a fondé, de favoriser le retour des Juifs en Palestine en créant un double Etat,
arabe et juif, placé sous la protection de Napoléon III. Il fonde également une « Société
internationale universelle pour la rénovation de l’Orient ».
1870-1871 – Guerre franco-allemande. Dunant voit dans cette nouvelle guerre l’occasion de
servir à nouveau la cause de l’humanité. Il crée à Paris une organisation parallèle à la Croix-
Rouge, la « Société auxiliaire de Secours aux blessés », puis, sans doute sous l’impression des
massacres qui ont accompagné la chute de la Commune de Paris, lance l’« Alliance universelle
pour l’Ordre et la Civilisation ». Il vit d’expédients, écrit des articles, lance une affaire de
pansements qui tourne court. Obsédé par le remboursement de ses dettes, il rêve d’entreprises
mirifiques qui n’existent que dans son imagination.
En 1872 et 1873, en Angleterre, Dunant s’efforce de sensibiliser l’opinion à la question des
prisonniers de guerre, sur laquelle la Croix-Rouge, présidée par Gustave Moynier, commence
seulement à se pencher, tente de répandre l’idée d’une cour d’arbitrage chargée de résoudre les
conflits internationaux.
Selon la légende, Dunant connaît ensuite des années d’errance et de misère à travers l’Europe. En
fait, probablement depuis 1874, il reçoit de sa famille une petite pension qui lui permet juste de
subsister. Il entretient une relation avec une riche veuve, Léonie Kastner, pour laquelle,
officiellement, il fait le représentant de commerce pour un étrange instrument de musique, le
« Pyrophone, ou flammes chantantes », invention du fils de Mme Kastner. Au cours de ces
années obscures, ses pérégrinations sont difficiles à suivre.
1892 – Dunant se fixe définitivement à Heiden (Appenzell), où on le redécouvre en 1895. Il veut
prouver son rôle dans la création de la Croix-Rouge, à présent mondialement reconnue, alors que
son nom est oublié à Genève. Il entreprend d’écrire son autobiographie, mais, usé par sa vie
errante et en proie au délire de persécution, il ne parvient pas à mettre de l’ordre dans ses idées ;
ses « Mémoires » restent un chaos inachevé.
1895 – L’article paru dans un journal de Saint-Gall provoque des réactions un peu partout dans le
monde. Les idées de Dunant ont changé, il ne veut plus seulement un code de la guerre, mais
lutter contre la guerre elle-même, collabore à des revues pacifistes, écrit L’Avenir sanglant,
condamne le colonialisme et la recherche scientifique vouée à la guerre.
10 décembre 1901 – Il reçoit le Prix Nobel de la Paix, qu’il partage avec le pacifiste français
Frédéric Passy.
8 mai 1908 – Le monde entier célèbre son 80ème anniversaire.

30 octobre 1910 – Il meurt à l’âge de 82 ans. Par testament, grâce à son Prix, il fonde un lit
perpétuel pour un indigent à l’hôpital de Heiden où il a passé ses dernières années. Selon sa
volonté, ses cendres sont dispersées à Zurich.

Henry Dunant – Un Souvenir de Solférino, 1862
« Le soleil du 25 [juin 1859] éclaira l’un des spectacles les plus affreux qui se puissent présenter
à l’imagination. Le champ de bataille est partout couvert de cadavres et de chevaux ; les routes,
les fossés, les ravins, les buissons, les prés sont parsemés de corps morts, et les abords de
Solférino en sont littéralement criblés. Les champs sont ravagés, les blés et les maïs sont couchés,
les haies renversées, les vergers saccagés, de loin en loin on rencontre des mares de sang. Les
villages sont déserts, et portent les traces des ravages de la mousqueterie, des fusées, des bombes,
des grenades et des obus ; les murs sont ébranlés et percés de boulets qui ont ouvert de larges
brèches ; les maisons sont trouées, lézardées, détériorées ; leurs habitants qui ont passé près de
vingt heures cachés et réfugiés dans leurs caves, sans lumière et sans vivres, commencent à en
sortir, leur air de stupeur témoigne du long effroi qu’ils ont éprouvé.
Aux environs de Solférino, mais surtout dans le cimetière de ce village, le sol est jonché de fusils,
de sacs, de gibernes, de gamelles, de shakos, de casques, de képis, de bonnets de police, de
ceinturons, enfin de toutes sortes d’objets d’équipement, et même de débris de vêtements souillés
de sang, ainsi que de monceaux d’armes brisées.
Les malheureux blessés qu’on relève pendant toute la journée sont pâles, livides, anéantis ; les
uns, et plus particulièrement ceux qui ont été profondément mutilés, ont le regard hébété et
paraissent ne pas comprendre ce qu’on leur dit, ils attachent sur vous des yeux hagards, mais
cette prostration apparente ne les empêche pas de sentir leurs souffrances ; les autres sont inquiets
et agités par un ébranlement nerveux et un tremblement convulsif ; ceux-là, avec des plaies
béantes où l’inflammation a déjà commencé à se développer, sont comme fous de douleur, ils
demandent qu’on les achève, et ils se tordent, le visage contracté, dans les dernières étreintes de
l’agonie. (…)
Sur les dalles des hôpitaux ou des églises de Castiglione ont été déposés, côte à côte, des hommes
de toutes nations, Français et Arabes, Allemands et slaves ; provisoirement enfouis au fond des
chapelles, ils n’ont plus la force de remuer, ou ne peuvent bouger de l’espace étroit qu’ils
occupent. Des jurements, des blasphèmes et des cris qu’aucune expression ne peut rendre,
retentissant sous les voûtes des sanctuaires. « Ah ! Monsieur, que je souffre ! me disaient
quelques-uns de ces infortunés, on nous abandonne, on nous laisse mourir misérablement, et
pourtant nous nous sommes bien battus ! » Malgré les fatigues qu’ils ont endurées, malgré les
nuits qu’ils ont passées sans sommeil, le repos s’est éloigné d’eux ; dans leur détresse ils
implorent le secours d’un médecin, ou se roulent de désespoir dans des convulsions qui se
termineront par le tétanos et la mort. (…) La figure noire de mouches qui s’attachent à leurs
plaies, ceux-ci portent de tous côtés des regards éperdus qui n’obtiennent aucune réponse ; la
capote, la chemise, les chairs et le sang ont formé chez ceux-là un horrible et indéfinissable
mélange où les vers se sont mis ; plusieurs frémissent à la pensée d’être rongés par ces vers qu’ils
croient voir sortir de leur corps, et qui proviennent des myriades de mouches dont l’air est infesté.
Ici est un soldat, entièrement défiguré, dont la langue sort démesurément de sa mâchoire déchirée
et brisée ; il s’agite et veut se lever, j’arrose d’eau fraîche ses lèvres desséchées et sa langue
durcie ; saisissant une poignée de charpie, je la trempe dans le seau que l’on porte derrière moi, et
je presse l’eau de cette éponge dans l’ouverture informe qui remplace sa bouche. Là est un autre
malheureux dont une partie de la face a été enlevée par un coup de sabre : le nez, les lèvres, le
menton ont été séparés du reste de la figure ; dans l’impossibilité de parler et à moitié aveuglé il
fait des signes avec la main, et par cette pantomime navrante, accompagnée de sons gutturaux, il
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%