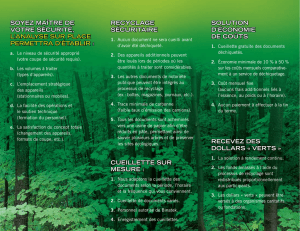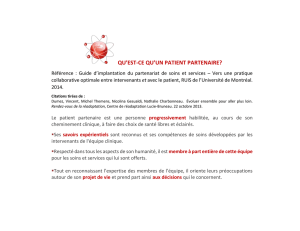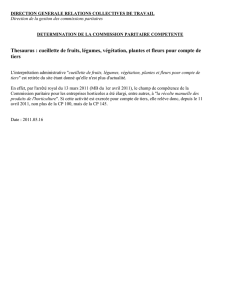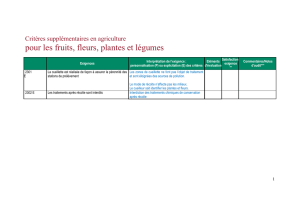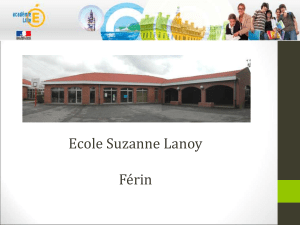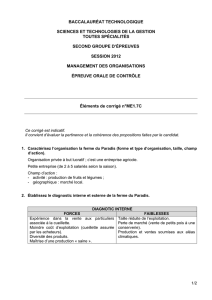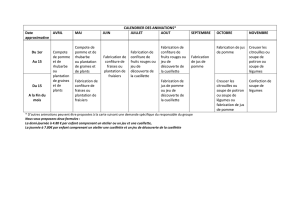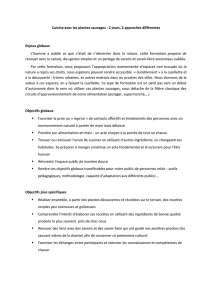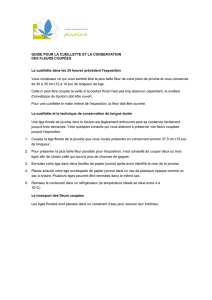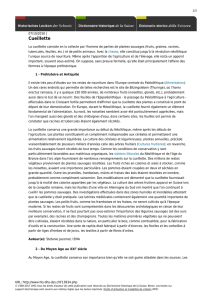Exploitation de la nature et exploitation de l`homme

In Économies et Sociétés,
Série«
Systèmes agroalimentaires
»,
AG, n° 37, 08/2015, p. 1291-1318
Exploitation de
la
nature
et
exploitation de
l'homme
Michel Cépède
L'intérêt porté à l'environnement : aux destructions et pollutions
attribuées à l'activité humaine, à la nécessaire conservation du milieu
naturel pour la survie de l'espèce, à la possibilité
d'un
aménagement
permettant le développement harmonieux de l'humanité, devrait
conduire la science économique à une autocritique fructueuse.
A de rares exceptions près, les théories économiques ne distinguent
pas les diverses formes d'appropriation, les confondant sous
le
vocable
de « production » même lorsque celui de « destruction » serait plus
adéquat.
Ces théories n'auraient-elles pas été pensées pour une humanité
« parasite »
de
son environnement? Cette hypothèse explicative appa-
raîtrait vérifiée
s'il
était montré que les principes les mieux établis de la
science économique ne supposent pas l'existence
d'un
procès quel-
conque de production», au sens strict; autrement dit, ils auraient pu être
découverts dans une « économie minière
»,
par définition « épuisant »
une richesse naturelle non renouvelable, ou, au mieux, dans une « éco-
nomie de cueillette »
(y
compris la chasse et la pêche) voire
«pastorale» qui n'est qu'une cueillette par l'intermédiaire
d'un
animal
domestique, qui peuvent, aussi, être « épuisantes » sans que les critères
classiques de la qualité d'une économie ne les distinguent d'une éco-
nomie « conservatrice >l du potentiel de reproduction de la nature.
Les conservations des populations végétales ou animales, des sols
eux-mêmes, sont, en effet, exclues du domaine de la science écono-
mique : science de « l'appropriation
»,
ou de « l'exploitation » du
«dominé»
(ici la nature) par
le«
dominant» (ici
l'homme«
parasite »
ou plus exactement « prédateur
»)
pour être rejeté dans celui de
« l'éthique économique
».

1292
M.
CÉPÈDE
Celle-ci demeure une éthique de parasite qui, dans l'intérêt de l'ave-
nir de son propre groupe, devrait limiter son exploitation pour
« ne pas tuer la poule aux œufs
d'or
» et s'efforcer de tirer le maxi-
mum
de satisfaction de ce
qu'il
est parvenu à s'approprier.
Pour cette éthique économique
»,
économie a le sens du langage
courant : celui de restriction de la consommation, d'épargne, de « pri-
vation
».
Une telle éthique ne se développe que chez un peuple ayant
conscience de
la
durée, le sens de la pérennité et qui se trouve
confronté avec une situation de pénurie dans un espace limité. Elle naît
donc plus vite chez le sédentaire: « peuple
du
temps » (E.
W.
Zim-
merman), que chez le
nomade:«
peuple de
l'espace
» (E.W.Z., 1933).
Comme, aussi loin que l'histoire remonte dans le passé, il n'est
guère de société qui ne soit en état de pénurie, les doctrines -combi-
naisons de théorie et d'éthique -économiques se réfèrent à une telle
situation: elles exaltent les vertus d'épargne,
d'économie
au sens tri-
vial... même si les préférences profondes des individus qui constituent
le groupe, les font rêver
d'une
période d'abondance,
d'un«
âge
d'or»,
de longtemps disparu, où chacun pouvait vivre « noblement » ou
« esthétiquement » sans se soucier du lendemain.
La
pénurie qui donne
raison à la « fourmi » ne peut empêcher que
la
« cigale » soit plus sym-
pathique et que son mode de vie « bohème » ne soit considéré par
beaucoup comme un idéal malheureusement impossible à atteindre
...
sans prendre des risques inacceptables.
La
pénurie dans une société égalitaire
peut
conduire à limiter les
parties prenantes à la masse disponible. Dans une société qui comporte
dominateurs et dominés, les premiers tendent à
s'assurer
la part
la
plus
large possible en limitant les parties prenantes Platon
n'était
« mal-
thusien » que pour les citoyens consommateurs et en « exploitant »
plus sévèrement
les«
dominés »exigeant
d'eux
qu'ils « produisent »
ce que le dominateur désire « au moindre coût » autrement dit en
« consommant
»le
moins possible.
La
«productivité»
qu'il
s'agit
de
maximiser,
c'est
alors la « productivité »
du
travail humain, non pas
tellement parce que le travail est pénible au travailleur, mais parce qu'il
coûte à l'employeur.
De l'exploitation de
la
nature, une telle société passe à celle de
l'homme
par l'homme. Le produit étant, sur le marché, aliéné en mar-
chandise, la valeur de celle-ci est déterminée
par
la
pénurie qui permet
d'en
réserver l'acquisition par la seule demande solvable (effective).
Celle-ci, cherchant à se satisfaire au moindre coût, la force
de
travail
est, à son tour, aliénée en marchandise
et
la
« plus-value » constitue la

SÉRIE AG
9,
MAI
1971 1293
source essentielle du profit en limitant en même temps le « pouvoir
d'achat
» des travailleurs, évitant que leurs besoins ne se présentent en
demande sur le marché et créant les conditions rendant possible cette
chose apparemment absurde:
la
crise de « surproduction » avec « sous-
emploi » et « sous-consommation ».
La pénurie tend à renforcer
la
position des groupes qui en ont pu,
plus complètement et plus vite, tirer parti: ceux qu'aucune éthique ou
obligation statutaire « aristocratique » ( « Homérique » de
C. C.
Zimmermann) n'empêche de vivre chichement
et
d'exploiter leurs
semblables : ce sont souvent ceux qui ont exercé au service de la classe
« aristocratique
»,
les fonctions d'exploitation qui, dès qu'ils peuvent
« se mettre à leur compte » vont fonder le noyau d'une classe
intermédiaire entre aristocrates et dominés, spécialisée dans « l'éco-
nomie
»,
que par commodité nous appellerons :
la
« bourgeoisie »
(«
Aristophanique
»,de
C.
C. Zimmermann). Celle-ci
n'a
pas pour but
de « produire » des richesses, des produits, des services même, mais de
la « valeur ajoutée » ; vouée à la « chrématistique non naturelle »
(Aristote), au
cycle«
argent-marchandise-argent » (Karl Marx), cette
classe, née de l'administration de la pénurie, constate que
la
pénurie
permet de
<<
produire plus de valeur ajoutée » que l'abondance (effet
King par exemple) et elle tendra à organiser la pénurie dont l'adminis-
tration lui est si profitable : au « malthusianisme démographique »
s'ajoutera le «malthusianisme économique » et
la
« surproduction »
apparaît alors comme une maladie de l'économie plus grave que
la
« disette». Bien plus,
«l'économie
de subsistance » sera considérée
comme une dangereuse prétention des pauvres à satisfaire leurs
besoins sans permettre les profits
qu'une
« économie évoluée » doit
assurer à
la
« bourgeoisie » par le jeu des marchés.
L'économie de subsistance nous ramène à l'agriculture, car
c'est
en
général à propos de celle-ci que l'expression est utilisée. Remarquons
qu'il
n'a
pas été nécessaire de faire état d'agriculture proprement dite
jusqu'ici et qu'une économie de subsistance comme une économie de
marché, peut être établie sur une « production » minière ou de
cueillette ou pastorale sans faire appel à une production agricole.
Exploitation de
la
nature, exploitation de
l'homme
par
l'homme
ont pu
trouver -auraient pu trouver- leur théorie économique sans
la
« révo-
lution verte néolithique ». Notre intention est de montrer que si l'ex-
ploitation de la production agricole par
la
domination des classes diri-
geantes a permis un développement économique, la science
économique
n'a
pas-
sauf dans une certaine mesure avec l'école phy-
siocratique-
eu le souci d'intégrer les procès de production réelle dans

1294 M. CÉPÈDE
son effort d'analyse. Du même coup les contradictions entre « pro-
ductions » de richesses et de valeurs ont pu être pudiquement voilées,
de même que les transferts
de«
produit
net»
aux dépens de l'agricul-
ture, de « plus-value » aux dépens des travailleurs, étaient confondus
avec des échanges réels. Mais comment faire la théorie de l'économie
de subsistance, « l'économique » d'Aristote, sans analyse du procès
de production ? Comment envisager une théorie de l'économie des
besoins, à fortiori du développement de l'économie de l'entière huma-
nité, en se fondant sur l'analyse de la « chrématistique non naturelle »
alors que, n'ayant pas trouvé de clients dans l'Espace, une économie
mondiale ne saurait être qu'une économie de subsistance ? Pour préci-
ser ces propositions que d'aucuns taxeront vraisemblablement de
paradoxales voire de dangereusement hérétiques, nous allons tenter
d'analyser les mécanismes économiques dans certains schémas de
structure.
ÉCONOMIE MINIÈRE
La mine, étant le fruit à cueillir une fois pour toute, ainsi que le
remarquait Turgot dans
son«
mémoire sur les mines et les carrières»,
ne saurait fournir que le « produit brut » au sens physiocratique
puisque chaque appropriation diminue la part restant susceptible d'
ap-
propriation. L'activité humaine est récolte et non production. Elle est
soumise à la loi des rendements moins que proportionnels puisqu'on
peut, selon la supposition ricardienne, penser que l'homme va d'abord
récolter les minerais qui par leur proximité, leur richesse, leur forme
sont susceptibles de fournir au moindre coût-travaille produit recher-
ché. Il existe une rente de situation pour ceux qui ont le monopole
d'exploitation de mines de « rendement » plus élevé que celle qu'il a
fallu ouvrir pour répondre à la demande solvable.
La
hausse des prix
serait continue sous le double effet de la hausse du coût de « produc-
tion » et de l'épuisement de la réserve minière, si la découverte de
nouveaux gisements qui ne saurait non plus être considérée comme
une « production » mais seulement comme la reconnaissance de
l'existence d'une richesse existante antérieurement « produite »
ou
l'invention de techniques, permettant une extraction à moindre coût
et/ou une utilisation de richesses substituables, ne venait perturber le
schéma. Lorsqu'un degré suffisant de pénurie est atteint, il peut être
plus avantageux de récupérer, par exemple, les métaux usagés pour les
réutiliser que d'extraire des mines du minerai nouveau. Il est néces-

SÉRIE AG
9,
MAI
1971 1295
saire de souligner que cette saine économie qui ferait récupérer la
matière usagée pour la réintroduire dans le circuit d'utilisation, serait
limitée par
la
possibilité de gaspiller des richesses naturelles non
encore exploitées. Sans doute
le
besoin essentiel qui est celui de nour-
riture ne pouvant être satisfait que par la récolte de produits végétaux
et animaux et non par l'usage de produits miniers, le présent schéma
peut apparaître irréel. Il suffira de constater que dans les économies de
cueillette pastorale, voire agricole, il est possible de procéder à une
exploitation«
minière»
pour que le schéma s'applique.
En
particulier
aussi longtemps qu'il sera possible de prélever, sans souci
d'en
per-
mettre la reproduction, des produits végétaux et animaux ou d'épuiser
les richesses qui font la fertilité des sols, une économie plus conserva-
trice ne résistera pas à la concurrence de l'exploitation minière et son
développement, comme celui de l'industrie de récupération, sera limité
par l'existence de richesses naturelles susceptibles
d'être
gaspillées. Le
commerce, singulièrement le commerce international, permettra de
mettre sur le marché des produits « miniers
»,
provenant de
l'
exploi-
tation de ressources nouvellement appropriées, en concurrence avec
les produits de récupération ou de récolte limitée au croît que
l'
écono-
mie de cueillette va nous permettre d'envisager.
La
rémunération du
travail humain, tant dans l'industrie extractive que dans
la
transforma-
tion, sera limitée par l'abondance des richesses susceptibles de gas-
pillage. Il
n'est
pas nécessaire
qu'une
exploitation abusive des res-
sources nouvellement découvertes soit effective et apporte un
approvisionnement à bas prix pour que des profits supplémentaires
soient réalisés aux dépens des travailleurs.
La
simple existence de cette
possibilité d'exploitation permet d'exercer sur la rémunération des tra-
vailleurs une pression génératrice de « plus-value
».
L'exploitation
coloniale
n'a
représenté
qu'une
partie de l'exploitation des dominés,
partie qui, si elle a servi de prétexte à l'ensemble, a été, en général,
contrairement à certaines affirmations simplistes, beaucoup moins
importante que celle des travailleurs des pays dits « développés »
qu'elle
a permis d'intensifier.
ÉCONOMIE DE CUEILLETTE
Sous ce vocable nous engloberons toute exploitation
d'une
popula-
tion animale (pêche ou chasse) ou végétale directement (cueillette) ou
par l'intermédiaire
d'un
animal domestique (économie pastorale). Une
telle économie est susceptible de fournir un « produit net » au sens
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%