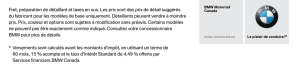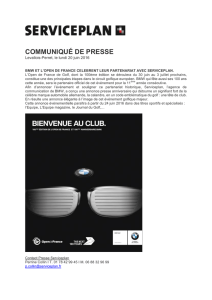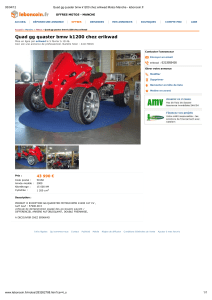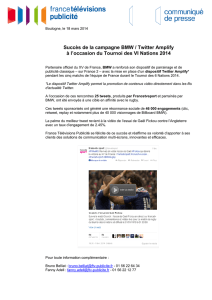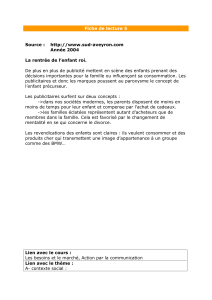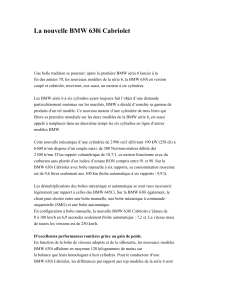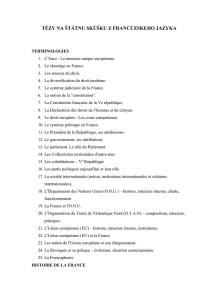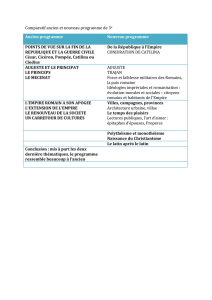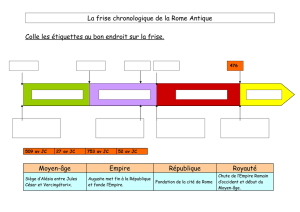Le signe D19, à la recherche des sens d`un déterminatif (II)

NeHeT
Revue numérique d'Égyptologie
(Paris-Sorbonne - Université Libre de Bruxelles)
Volume 4
2016

La revue Nehet est éditée par
Laurent Bavay
Nathalie Favry
Claire Somaglino
Pierre TalleT
Comité scientique
Florence alBerT (Ifao)
Laurent Bavay (UlB)
Sylvain Dhennin (Ifao)
Sylvie DonnaT (Université de Strasbourg)
Nathalie Favry (Université Paris-Sorbonne)
Hanane gaBer (Collège de France)
Wolfram grajeTzki (UCL)
Dimitri laBoUry (ULg – F.R.S.-FNRS)
David loranD (ULB-F.R.S.-FNRS)
Juan-Carlos moreno garcia (CNRS-UMR 8167)
Frédéric PayraUDeaU (Université Paris-Sorbonne)
Tanja Pommerening (Université de Mayence)
Lilian PoSTel (Université Lyon 2)
Chloé ragazzoli (Université Paris-Sorbonne)
Isabelle régen (Université Montpellier 3)
Claire Somaglino (Université Paris-Sorbonne)
Pierre TalleT (Université Paris-Sorbonne)
Herbert verreTh (KULeuven)
Ghislaine WiDmer (Université Lille 3)
ISSN 2427-9080
Contact : [email protected]
Couverture : Ostracon University College 31918 [avec l'aimable autorisation du Petrie Museum of Egyptian
Archaeology, UCL].

SOMMAIRE
Matthieu Begon
Nédia, Dia ou bien plutôt Ida ?
La « campagne asiatique » d’Inti de Deshasha (n de la Ve dynastie)
et le littoral sud de la Palestine durant la seconde moitié du IIIe millénaire
(Bronze Ancien III) 1 – 24
Axelle Brémont
« Aspectivité » ou plutôt « multispective »?
Les leçons du paradoxe de la chèvre 25 – 44
Éléonore Frayssignes
Nouvelles perspectives sur les techniques de tissage à l’Ancien Empire :
une attestation textile de l’utilisation de métiers à chaîne tubulaire
(ouadi el-Jarf, mer Rouge) 45 – 58
Jean-Guillaume olette-Pelletier
Note sur l’emploi d’une rubrique cryptographique dans
un papyrus du Moyen Empire 59 – 64
Chloé ragazzoli
Genres textuels et supports matériels : une inscription de visiteur
comme exercice sur ostracon (Ostracon University College 31918) 65 – 76
Felix relats-montserrat
Le signe D19, à la recherche des sens d’un déterminatif (II) :
les usages d’un signe 77 – 121
Julien siesse
Djedhéteprê Dedmésou et Djednéferrê Dédoumès :
attribution des sources et nouvelles datations 123 – 134

Pierre tallet
Un sceau-cylindre au nom de Sahourê sur le marché de l’art 135 – 138
Thomas Vermeulen
Réexions sur les couches intermédiaires de la société égyptienne 139 – 165
Claire Balandier, La défense de la Syrie-Palestine des
Achéménides aux Lagides. Histoire et archéologie des fortications à l’Ouest
du Jourdain de 532 à 199 avant J.-C. avec appendices sur Jérusalem,
les ouvrages fortiés de Transjordanie et du Nord du Sinaï, Paris, 2014
Compte-rendu de Dominique ValBelle 167 – 169
summaries 171 – 173

77
Le signe D19 , à la recherche des sens d’un
déterminatif (ii) : les usages d’un signe
Félix Relats MontseRRat *
Nehet 4, 2016
Dans un précédent article1, nous avons présenté l’évolution paléographique du signe
D19 . L’objectif était alors de comprendre les rapports entre les signes communément
appelés D19, D20, F63 et F63A. Nous avons pu démontrer qu’il faut les concevoir comme
une seule et même entité – que nous appelons arbitrairement D19. Le référent du signe est
passé du museau d’un canidé à un nez humain et nalement à un museau bovin. Cette
évolution, facilitée par le caractère peu détaillé de la gravure dans la plupart des attestations,
a entraîné la perte de conscience graphique du référent.
Dans le présent article nous voulons conclure cette recherche en étudiant les usages de ce
signe en raison de la variété des emplois qui lui sont attribués2. D’une part, il est considéré
comme un phonogramme pour fnḏ, šr.t et surtout pour tous les substantifs tirés des racines
ḫnt et ḫnr. Cependant, A. Erman3 signalait déjà que ces valeurs ne sont pas originelles à D19
et qu’elles ne sont apparues que progressivement, tout particulièrement pour l’association
D19 = ḫnt qui ne serait attestée qu’à partir du Nouvel Empire. Nous nous proposons, de ce
fait, d’étudier de manière diachronique l’extension des valeurs phonétiques du signe pour en
vérier l’existence ainsi qu’en préciser la datation. D’autre part, D19 est essentiellement utilisé
comme déterminatif couvrant le champ sémantique du nez (fnḏ) et de la respiration (ssn), mais
également ceux de la joie ou de la révolte comme dans sbṯ (« le rire »), rš (« se réjouir ») et bšṯ
(« le rebelle »). À première vue, le lien entre ces différents termes ne paraît pas évident (quel
est le rapport entre la joie et l’opposition ?), de même que le choix d’un signe gurant un nez/
museau pour déterminer ces divers termes (quel est le rapport avec le nez ? Pourquoi ne pas
utiliser une guration de lèvres souriant ?). Ainsi, les emplois de D19 permettent de rééchir
d’une part sur les liens unissant le vocabulaire et, d’autre part, sur le supplément de sens apporté
par l’image du nez.
1 F. Relats MontseRRat, « Le signe D19, à la recherche des sens d’un déterminatif (I) : la forme d’un signe »,
Nehet 1, 2014, p. 130-170. La présente étude est tirée de mon mémoire de master sous la direction de Mme
A. Forgeau, que je remercie de m’avoir encadré pendant ces années et pour les conseils qu’elle m’a prodigués
au cours de la rédaction de cet article. Qu’A. Stauder, Cl. Somaglino et N. Favry reçoivent également mes
remerciements pour leur relecture. Jonathan, merci encore.
2 Si nous reprenons la dénition qu’en donnent J. Winand et M. Malaise : « D[éterminatif] ḫnt “face” et mots
apparentés, de là D[éterminatif] P[honétique], puis P[honème] ḫnt (ḫntj “qui se trouve en face”) – D[éterminatif]
générique pour les mots en rapport avec la respiration (sn “respirer”) ou l’humeur (ršw “se réjouir”, bṯn “être
désobéissant”) – D[éterminatif] et Abr[éviation] fnḏ “nez”, šr.t “nez, narine”. Par une confusion due au hiéra-
tique, peut parfois remplacer U31 et Aa 32. » (M. Malaise & J. Winand, Grammaire raisonnée de l’égyptien
classique, AegLeod 6, 1999, p. 701).
3 A. eRMan, « Ein orthographisches Kriterium », ZÄS 55, 1918, p. 86-88.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
1
/
53
100%