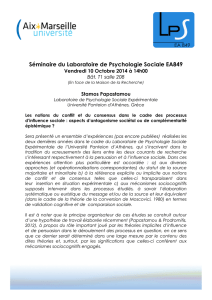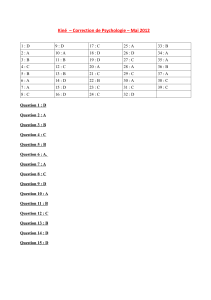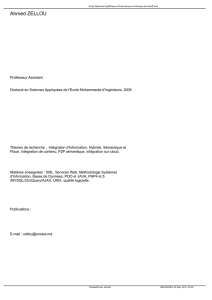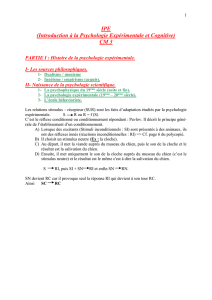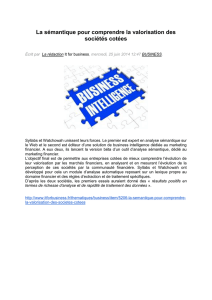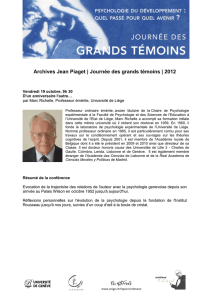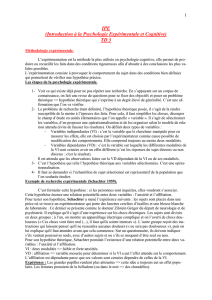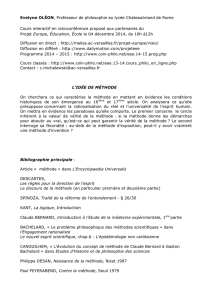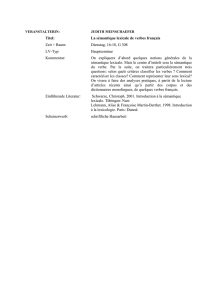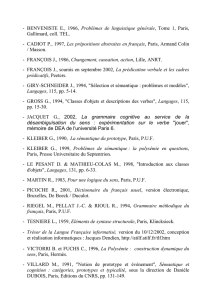I. Définitions et méthodes d`études. A) Définitions. B

I. Définitions et méthodes d'études.
A) Définitions.
La mémoire à long terme (MLT) est une mémoire permanente, le souvenir est maintenu sur une très longue
période, voire une vie entière.
Stockage plus ou moins permanent, il n'y a aucune limitation de stockage, plus on apprend mieux c'est, il n'y a
pas de saturation.
B) Méthodes d'études.
1) Méthode de présentation des données.
a. La méthode d'anticipation.
Les méthodes d'études sont différentes selon les phases, on ne peut étudier la phase intermédiaire puisqu'elle est
inférée.
La méthode d'anticipation fait partie des méthodes utilisées pour présenter les informations à mémoriser.
La méthode d'anticipation est applicable dans le cas où le matériel est ordonné, c'est au sujet d'annoncer
l'élément qui va suivre, il restitue l'élément avant qu'il ne lui ait été présenté. On lit d'abord l'ensemble, puis on
le met sur la voie pour trouver la suite des événements, cette méthode est à distinguer du rappel.
Finalement ce sont des liaisons S-R d'un mot à l'autre, ce sont plutôt les associationnistes qui l'utilise.
b. La méthode des couples associés.
Le sujet va apprendre un lien entre 2 items. Le premier item sert d'indice au second. Exemple de la liste de mots
en anglais. Cette méthode est plutôt utilisée par les associationnistes puisqu'il s'agit de lien S-R, arbitraires,
cependant nous cherchons à donner du sens, à faire des liens même avec un matériel non-significatif,
expérimental. c. La méthode d'étude libre.
Le matériel est mit à disposition, le sujet est libre de procéder comme il l'entend pour apprendre.
2) Méthodes utilisées pour la restitution.
a. Le rappel : libre, ordonné, indicé.
Le rappel c'est la restitution en l'absence du support, on peut faire varier le rappel :
- Le rappel libre : sans contraintes particulières.
- Le rappel ordonné : le sujet doit rappeler les items en suivant
l'ordre de présentation donc il doit avoir apprit l'ordre en plus du
contenu.
- Le rappel indicé : au moment du rappel, un indice est fourni au
sujet concernant l'item à rappeler (la première lettre du mot par
exemple). Les indices de contextes servent aussi pour le rappel
indicé.
Psychologie générale et expérimentale.
La mémoire à long terme. Cours 2 1

b. La reconnaissance.
Le matériel apprit est présenté de nouveau au sujet, mais il est mélangé à un nouveau matériel. Le sujet doit
choisir, reconnaître.
La reconnaissance est plus facile que le rappel.
On peut faire varier la difficulté de reconnaissance : pour rendre plus difficile on peut utiliser la similitude des
choix, plus la similitude est grande, plus la reconnaissance est difficile, par exemple on peut faire varier le
nombre de choix.
c. Le ré-apprentissage, économie, reconstruction.
La quantité d'informations misent en mémoire est indiquée par le pourcentage d'économie au ré-apprentissage.
Le pourcentage d'économie se calcule : nombre d'essais au premier apprentissage – nombre d'essais au 2ème
apprentissage divisé par le nombre d'essais au premier apprentissage.
Ce pourcentage indique la quantité de traces mnésiques.
3) Les différences entre rappel et reconnaissance.
a. La théorie dualiste.
La théorie dualiste présuppose l'existence de processus distincts pour le rappel et pour la reconnaissance. Cette
théorie a été élaborée entre autres par Kintsh.
La difficulté du rappel vient du fait qu'il y a plus d'étapes que dans la reconnaissance.
1. Première étape : il faut chercher mentalement
l'information, il faut l'évoquer.
2. Deuxième étape : il faut discriminer cette information
des autres qui sont fausses.
3. Troisième étape : il faut choisir.
La première étape n'est pas nécessaire dans la reconnaissance puisque le matériel est fourni. L'activité de
recherche n'existe pas, c'est pourquoi la reconnaissance est plus facile.
La reconnaissance est moins gênée que le rappel lorsque l'interférence, qu'elle soit proactive ou rétroactive,
augmente. Si une tâché créée une interférence, c'est plus gênant pour le rappel que pour la reconnaissance.
La recherche mentale du rappel : le sujet se base sur les relations établies entre les éléments appris (exemple des
lapsus). Les effets d'interférence sont plus grands pour le rappel que pour la reconnaissance à cause de la
première étape.
L'organisation du matériel facilite le rappel mais a peu d'influence sur la reconnaissance.
b. La théorie uniciste.
La théorie uniciste présuppose l'existence d'un processus commun au rappel et à la reconnaissance. Il y a aurait
une activité de recherche dans la reconnaissance aussi.
- Premier argument expérimental de Sternberg, énoncé pour la MCT
et reprit par d'autres pour la MLT. Lorsqu'on cherche mentalement,
il faut balayer toute la liste des éléments en mémoire. Le temps de
réaction augmente proportionnellement par rapport à la longueur de
la liste. Phase 1 : lecture d'une liste de chiffres. Phase 2 :
présentation d'un chiffre dont le sujet doit déterminer s'il était dans
la liste ou non. Résultat : le temps de réaction augmente
proportionnellement avec la longueur de la liste. Même pour la
reconnaissance il y a un processus de recherche mentale.
- Deuxième argument expérimental : énoncé par Tulving qui a
beaucoup travaillé sur les effets de contexte dans la mémoire.
Modification du contexte entre l'encodage et la restitution. Phase 1
Psychologie générale et expérimentale.
La mémoire à long terme. Cours 2 2

: apprendre le mot pain associé au mot commerce. Phase 2 :
restitution, le mot pain est associé au mot déjeuné. Si on considère
que la recherche mentale est l'exclusivité du rappel, le contexte ne
peut pas gêner la reconnaissance mais juste le rappel. Pourtant la
modification du contexte modifie aussi la reconnaissance.
c. Troisième voie, théorie actuelle.
On considère qu'il y aurait une recherche conditionnelle dans la reconnaissance, la théorie actuelle, uniciste
variable selon le degré de certitude. - Premier cas : degré de certitude élevé : le sujet va faire un
jugement de familiarité, décide et donne sa réponse.
- Second cas : degré de certitude faible : le sujet va s'aider par une
recherche du contexte. En fonction des informations fournies par le
contexte, il pourra choisir. Le degré de certitude fait varier les
résultats, le nombre d'étapes.
Modèle de recherche conditionnelle.
II. L'encodage, le stockage et la récupération en MLT.
1) Le rôle de la répétition.
Pour encoder et stocker il faut répéter, il y a différentes sortes de répétition :
a. La répétition de maintien.
Peut se produire sans que le sujet comprenne. Rôle de consolidation de la trace. Répétition mécanique qui va
creuser la trace.
b. Répétition d'élaboration de matériel.
Les moyens mnémotechniques : le sujet travaille sur sa théorie (pour l'élaborer à sa manière). Exemple que
j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. Ces moyens mnémotechniques étaient très utilisés pendant
l'antiquité.
Le moyen des loci : Les Asiatiques ont une très grande mémoire : on va associer chacun des éléments à
mémoriser à un emplacement. Rôle actif du sujet.
2) La profondeur du traitement.
La répétition d’élaboration est un élément spécifique de la MLT, elle conditionne la transformation du matériel.
Il y a deux types de codage : - Codage en ce qui concerne la surface : Aspects physiques du
Stimulus (forme, taille des lettres), on s’intéresse à l’apparence,
aspects phonologiques, on peut retenir certaines sonorités sans en
comprendre la signification.
- Codage en ce qui concerne la profondeur : signification, sens
message apporté par le texte. Codage « par compréhension », on
peut restituer le sens en modifiant l’aspect (fruit et pomme par
exemple).
Cette distinction est l’œuvre de Craik et Lockhart. Le traitement en profondeur est le plus efficace.
On demande aux sujets d’apprendre des phrases simples, toutes de même structure soit sujet + verbe +
complément : Jean mange pomme. Il y a deux conditions expérimentales :
- Le sujet élabore la phrase à partir des 3 mots et l’apprend.
Psychologie générale et expérimentale.
La mémoire à long terme. Cours 2 3

- L’expérimentateur propose une phrase toute faite.
Cette expérience essaye de démontrer l’impact majeur de l’élaboration (au cours de la répétition) du matériel.
Résultats : - Condition expérimentale 1 : 60% de rappel correct.
- Condition expérimentale 2 : 30% de rappel correct.
L’élaboration du matériel se fait dans le traitement en profondeur, au niveau du sens. La répétition permet
l’élaboration mais il y a peut être d’autres facteurs qui rentrent en compte.
L’intention d’apprendre : - Apprentissage intentionnel : la motivation est initiatrice, la
répétition produit le même matériel, il faut la volonté de
comprendre pour parvenir à l’élaboration du matériel.
- Apprentissage accidentel ou incident : se produit sans que le sujet
ne l’ai cherché, exemple de la pub, répétition forcenée, pas de
critique puisque pas de volonté de compréhension.
Le traitement en profondeur avec l’intention d’apprendre et la répétition donnent les meilleures conditions de
l’apprentissage.
3) Les différents modes de codage.
a. Codage lexical.
C’est le codage essentiel, il fait partie de la boucle articulatoire.
b. Codage imagé.
Les informations sont codées sous forme d’image mentale. C’est très efficace en tant que moyen
mnémotechnique.
Expérience : on a 5 niveaux de visualisation différents pour apprendre une même action (une femme colle un
timbre par exemple). - Condition expérimentale 1 : phrase
- Condition expérimentale 2 : dessin.
- Condition expérimentale 3 : photo.
- Condition expérimentale 4 : 3 photos successives.
- Condition expérimentale 5 : film.
Les résultats : on obtient les mêmes scores pour les 3 photos et le filme, les mêmes pour le dessin et la photo, la
phrase obtient le moins bon score.
La représentation imagée est supérieure seulement cela ne fonctionne qu’avec des mots concrets et avec des
actions.
Expérience avec des mots concrets et abstraits : la moyenne de mots concrets est supérieure (6, 5) à la moyenne
de mots abstraits (2). Se pose alors le problème de la fréquence d’apparition des mots, cette variable sets
contrôlée et les résultats restent les mêmes.
Expérience avec trois conditions expérimentales :
- 1 : mots.
- 2 : dessins.
- 3 : dessins et mots.
Les résultats : les dessins obtiennent 18 pour 16, 5 pour les mots. Les dessins et les dessins et mots obtiennent le
même score. C’est donc le dessin qui est important, le codage se fait au niveau imagé.
c. Théorie du double codage de Paivio.
Hypothèse : il existe un double codage : le codage imagé + codage phonologique. VD moyenne rappel, VI1 :
temps de présentation, VI2 catégorie du matériel. Il y a 10 conditions expérimentales, donc 10 résultats.
Mémoriser le dessin prend plus de temps que mémoriser le mot. La dénomination est plus longue pour dessin.
Psychologie générale et expérimentale.
La mémoire à long terme. Cours 2 4

Le rappel moyen est plus faible pour les mots que pour les dessins. Cette différence apparaît à 400 milli
secondes, à partir de cette limite les dessins sont mieux mémorisés que les mots.
Si la dénomination demande plus de temps que la lecture, on peut supposer qu’à moins de 400 milli secondes on
n’a pas le temps de dénommer tout simplement. On n’a pas le temps de faire un double encodage. Les dessins
sont mieux mémorisés que les mots à condition de bénéficier du double codage. La preuve qu’il faut quelque
chose en plus.
d. Moyens mnémotechniques de la construction d’images et des loci.
Expérience de Kosslyn : propose aux sujets de mémoriser une carte, une île imaginaire avec une baie et des
lieux déterminés. On demande aux sujets de se représenter un endroit précis et puis de se rendre dans un autre
endroit etc…On mesure le temps de réaction, on fait varier les longueurs. On constate qu’il y a une relation
entre la distance physique et le temps de réaction, la relation est linéaire, l’accroissement se fait
proportionnellement, on conserve les propriétés métriques de la carte.
III. L’organisation de l’information en MLT.
1) Le rôle de la familiarité.
Variable intermédiaire : trouvé par Tolman, une variable qu’on veut indépendante mais sur laquelle il est
impossible d’exercer un contrôle, on prend une VI intermédiaire, dans le cas de la familiarité, le chercheur ne
peut pas la manipuler alors il prend une variable intermédiaire : Fréquence.
Plus les mots sont fréquents dans la langue, plus l’apprentissage est facile.
Observation des enfants sourds et des enfants entendant.
Les enfants sourds n’ont qu’un accès partiel au langage, ils ont moins de mots dans leur répertoire à 5-6 ans
qu’un enfant entendant du même âge.
Chaque mot est utilisé beaucoup plus fréquemment en raison de la faible quantité (pour les enfants sourds), la
fréquence varie sans l’intervention de l’expérimentateur.
Les sourds obtiennent des résultats supérieurs parce que leurs fréquences d’emploi de ces mots la est plus
grande. La VI est invoquée (et non provoquée), le résultat est dit « contre-intuitif ».
Expérience : il n’y a pas que la familiarité, il y a aussi la structure, l’organisation de la phrase.
- Approximation de phrases, séries de mots dépourvues de sens mais
qui respectent la probabilité qu’un mot suive un autre mot :
marcher sur mesure précises.
- Même nombre de mots, même types d’agencement sans qu’il y ait
de probabilité prendre sur pompiers qualificatifs.
Résultats : les approximations sont apprises plus facilement que les séries aléatoires, donc la familiarité
d’agencement est aussi importante.
On rééduque l’aphasie par les associations systématiques de ce type.
2) Le rôle des catégories sémantique.
Mise en évidence par Bousfield : apprendre une liste de 60 mots décomposée en série de 15 mots : 4 catégories
sémantiques : animaux, professions, végétaux ; vêtements. L’ordre des mots dans la liste est aléatoire, le sujet
n’est pas informé des catégories.
Résultats : lors du rappel, on observe un groupement de mots en catégories plus long et plus nombreux que le
hasard n’en aurait produit. La mémoire fonctionne selon un groupement par catégories sémantique.
Ehrlich : travail organisation sémantique : Comment les groupements évoluent dans le temps. On propose aux
sujets des rappels différés (jusqu’à 3 semaines). A la différence de Bousfield, Ehrlich n’organisa pas sa liste, il
tire les mots au hasard. Au premier rappel il observe des groupements phonétiques, grammaticaux (verbes),
alphabétiques et sémantiques. Au fur et à mesure des rappels, les groupements se stabilisent. Les sujets
sélectionnent et gardent les groupements les plus efficaces. La rétention est d’autant meilleure que la
structuration du matériel était complète.
Le travail de structuration du matériel est très efficace, il se poursuit dans le temps, le rappel, la récitation est
très importante.
Psychologie générale et expérimentale.
La mémoire à long terme. Cours 2 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%