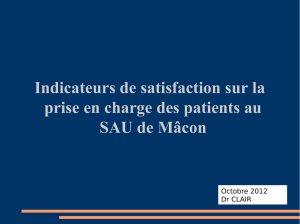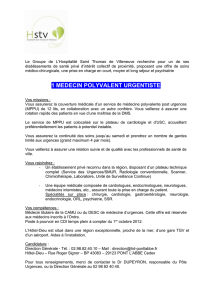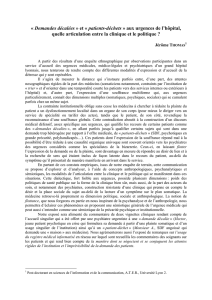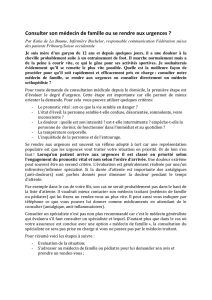Qualité de la prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am
Synthèse
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2013 ; 11 (4) : 351-60
Qualité de la prise en charge aux urgences
des patients âgés chuteurs
Quality of care provided to elderly fallers
in the emergency room
Sandrine Cabillic1
VanMoDang
2,3
CÉcile Ricard4
Franc¸oise Picot4
Franc¸ois-Xavier Ageron4
Pascal Couturier2,3
1Service de gériatrie, Centre hospitalier
de Chambéry, France
2Clinique universitaire de médecine
gériatrique. CHU de Grenoble,
La Tronche, France
3Université Joseph Fourier, Grenoble,
France
<PCouturier@chu-grenoble.fr>
4Service des urgences, Renau, Centre
hospitalier d’Annecy, Pringy, France
Tir ´
es `
a part :
P. Couturier
Résumé. Les chutes récidivantes représentent un problème majeur de santé publique avec
une forte morbi-mortalité et un accroissement de la dépendance. La Haute autorité de
santé (HAS) franc¸aise recommande depuis 2009 la recherche systématique des facteurs
de risque modifiables et la mise en œuvre des moyens de prévention. Objectifs : étudier si la
consultation aux urgences pour chute des patients âgés non hospitalisés est conforme aux
recommandations de l’HAS pour la recherche des facteurs de risque de chute. Méthodes :
analyse rétrospective descriptive des dossiers des urgences de 1 238 patients de plus de 75
ans qui ont consulté pour chute dans 13 centres de la région Nord-Alpine, d’avril à octobre
2010. Résultats : la recherche des facteurs de risque de chute était documentée dans
les proportions suivantes des dossiers : électrocardiogramme 29 %, troubles des fonctions
supérieures 25 %, autonomie 16 %, troubles de la marche 11 %, hypotension orthostatique
5%.Conclusion : les facteurs de risque de chute apparaissent insuffisamment renseignés
lorsqu’un patient âgé consulte aux urgences pour chute, avec des taux d’exhaustivité simi-
laires à ceux des études antérieures. Un protocole standardisé de prise en charge des sujets
âgés chuteurs aux urgences apparaît nécessaire pour améliorer l’identification des facteurs
de risque.
Mots clés : sujet âgé, chutes accidentelles, médecine d’urgence, guide de bonnes pra-
tiques
Abstract. Background: recurrent falls are a major public health problem associated with
high morbidity and mortality as well as increased dependence. Multifactorial intervention
has been shown to reduce recurrence by 20% (Profet study). The French Health Authority
(Haute autorité de santé or HAS) recommends since 2009 a systematic screening for and
assessment of risk factors as well as the implementation of preventive measures. Objec-
tives: to examine whether the management of falls in older patients discharged home from
the emergency department is consistent with the HAS guidelines. Methods: descriptive
retrospective analysis of 1238 medical records of patients over 75 years, who consulted for
falls from April to October 2010 in the emergency department of in 13 centers in the North-
Alps region. The study is part of a program to improve the quality of care led by the French
Network of North-Alps Emergency Departments (Réseau nord alpin des urgences, RENAU).
Results: Screening of risk factors for falls was documented in varying rates: electrocardio-
gram 29%, cognitive impairment 25%, functional assessment 16%, walking difficulties
11%, postural hypotension 5%. A comprehensive geriatric assessment was undertaken
for 3.8% of the patients. Conclusion: risk factors for falls are insufficiently documented in
elderly patients discharged home from the emergency room after a fall-related visit. Com-
pleteness rates are similar to those found in previous studies. A standardized protocol for
older fallers, specifically adapted to the work routine in the emergency department could be
useful. The RENAU has proposed an algorithm to streamline the orientation of older fallers
and promote the use of geriatric network.
Key words: aged, accidental falls, emergency medicine, practice guideline
Les chutes récidivantes appartiennent aux grands
syndromes gériatriques [1]. Elles reflètent la fragilité
de la personne âgée et témoignent de la diminu-
tion des réserves physiologiques du sujet âgé mais aussi
du poids de la polypathologie. La chute est la résultante de
l’association de facteurs de risque prédisposants et préci-
pitants, intrinsèques ou extrinsèques. Plusieurs études ont
montré une relation linéaire entre le risque de tomber et le
nombre de facteurs de risque [1, 2]. La complexité des situa-
tions nécessite donc une évaluation approfondie souvent
pluridisciplinaire [3]. Par ailleurs, les conséquences d’une
chute sont souvent sévères avec des complications trau-
matiques immédiates, mais aussi un risque de syndrome
post-chute pouvant évoluer vers un syndrome de régression
doi:10.1684/pnv.2013.0430
Pour citer cet article : Cabillic S, Dang VM, Ricard C, Picot F, Ageron FX, Couturier P. Qualité de la prise en charge aux urgences des patients âgés
chuteurs. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2013; 11(4) :351-60 doi:10.1684/pnv.2013.0430 351
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am
S. Cabillic, et al.
psychomotrice [4]. Le risque de déclin fonctionnel est non
négligeable et impacte la qualité de vie, compte tenu de la
restriction dans les activités habituelles [5]. Les personnes
âgées présentant des chutes à répétition vont être insti-
tutionnalisées dans 40 % des cas dans les 2 ans [3, 6].
On admet que 25 à 30 % des personnes de plus de 65
ans vivant à domicile vont subir une chute dans l’année
[7]. L’incidence est doublée pour les personnes résidant
en institution. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus,
les chutes représentent 84 % des accidents de la vie cou-
rante et celles motivant un recours aux urgences ont une
incidence annuelle estimée à 4,5 % [8]. Cette fréquence éle-
vée a donc des conséquences médico-économiques. Des
études récentes ont montré que le cout moyen lié à la chute
était de 11 400 dollars au Canada et de 11 000 dollars aux
États-Unis [9, 10]. Face à ce problème majeur de santé
publique, il importe de mettre en place des mesures de
prévention.
Les chutes constituent le premier motif de consulta-
tion aux urgences pour les plus de 75 ans avec de 10 à
22 % des motifs d’admissions [11, 12]. La fréquence de la
récidive, associée au vieillissement de la population devrait
encore accroître l’afflux aux urgences dans les années à
venir. De plus, la consultation pour chute est longue car
elle implique le diagnostic des complications traumatiques
et l’identification des facteurs de risque dans un temps
réduit. Pourtant, peu d’études se sont intéressées à la qua-
lité de la prise en charge et de l’orientation à l’issue de la
consultation aux urgences. À notre connaissance, il n’existe
ainsi pas de protocole validé ou de recommandations spé-
cifiques pour les urgences. Baraff et al. ont étudié en 1997
l’intérêt de la sensibilisation des soignants des urgences à
la problématique de la chute et ses facteurs de risque [13].
Le protocole a permis d’obtenir une meilleure documen-
tation de la chute, une augmentation des diagnostics de
syncope, d’accident vasculaire cérébral et une plus grande
fréquence de supplémentation en vitamine D. Malheureu-
sement, cette étude n’a pas mis en évidence de diminution
du risque de récidive de chute, probablement parce que
le suivi des recommandations n’a pas pu être contrôlé.
En France, des recommandations de bonne pratique sur la
prise en charge des chuteurs récidivants de plus de 65 ans
ont été éditées en 2009 par la Haute autorité de santé (HAS)
[14]. Elles préconisent la recherche de facteurs de risque de
chute grave, des facteurs précipitants et l’instauration de
mesures de prévention. Les recommandations de la HAS
sont destinées à un public large (médecins généralistes,
gériatres, rééducateurs) et ne semblent pas avoir été tes-
tées dans les services d’urgences. Les recommandations
des sociétés de gériatrie américaine et anglaise émises
en 2011, concernent les personnes âgées consultant leur
médecin traitant pour des chutes récidivantes ou admis aux
urgences pour une première chute [15].
L’objectif principal de notre étude a été de réaliser un
audit pour apprécier si la consultation aux urgences des
patients non hospitalisés donnait lieu à une recherche de
facteurs de risque de chute conforme aux recommanda-
tions de la HAS [14], des sociétés de gériatrie américaine
et anglaise (American geriatrics society, British geriatrics
society) [15] et aux indicateurs de bonnes pratiques aux
Etats-Unis (Assessing care of vulnerable elders : Acove
3) [16], avant l’application d’un programme de sensibili-
sation et de formation des équipes. L’objectif secondaire
de l’étude a consisté à analyser les associations entre le
recours à l’évaluation gériatrique et la recherche de facteurs
de risque de chute.
Méthodes
Type d’étude
Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive rétros-
pective multicentrique portant sur les personnes âgées de
plus de 75 ans ayant consulté aux urgences pour une chute
involontaire, d’avril à octobre 2010. Conformément à la litté-
rature, la chute a été définie comme le fait de se retrouver
involontairement au sol ou dans une position inférieure à sa
position de départ [17].
L’étude s’intègre dans la phase initiale d’un pro-
gramme d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
et d’amélioration de la qualité des soins aux personnes
âgées consultant pour chute aux urgences, mis en place
en 2010 par le Réseau nord alpin des urgences (Renau).
Le Renau, dont les missions sont l’homogénéisation des
pratiques et l’organisation des filières de prise en charge,
regroupe les services d’urgences des départements de la
Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère. L’hypothèse était que
la prise en charge des sujets âgés chuteurs aux urgences
pouvait être améliorée en sensibilisant le personnel para-
médical et médical au dépistage des facteurs de risque de
chute, de récidive et de complication ultérieure.
Population d’étude
Toutes les personnes de 75 ans ou plus dont la chute
était le motif principal d’admission (chute, chutes répéti-
tives, bilan de chute, malaise avec chute) aux urgences ont
été incluses, à l’exception de celles ne résidant pas sur le
territoire couvert par le réseau nord-alpin des urgences. Les
13 centres de l’arc alpin ayant participé à l’inclusion sont :
Aix-les-Bains, Annecy, Annemasse-Bonneville, Albertville-
Moutiers, Brianc¸on, Chambéry, Echirolles les cèdres,
352 Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am
Prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble Michal-
lon, Grenoble-clinique mutualistes, CHU Grenoble-hôpital
sud, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon et Voiron. Les
semaines d’inclusion, 7 pour les centres avec un nombre
d’entrées important (plus de 1 000 entrées annuelles aux
urgences de personnes de 75 ans ou plus) et 15 pour
les centres de taille inférieure, ont été tirées au sort sur
l’ensemble de l’année en évitant l’hiver pour ne pas créer
de biais.
Nous avons ensuite choisi de focaliser notre travail sur
les patients qui n’étaient pas hospitalisés. Il nous semblait
en effet fondamental que ce groupe bénéficie des recom-
mandations de bonne pratique au sein même du service
des urgences, afin de garantir une sortie dans des condi-
tions optimales. L’évaluation de l’équilibre et la recherche
d’une hypotension orthostatique ont été analysées dans le
sous-groupe des patients censés pouvoir se mettre debout,
c’est-à-dire n’ayant pas de fracture, entorse ou luxations
aux membres inférieurs ni d’impotence fonctionnelle. Le
recours à l’évaluation gériatrique a été analysé dans les
centres disposant d’une filière d’évaluation fonctionnelle
au moment de l’étude (recours chez au moins 5 % de
l’ensemble des patients).
S’agissant d’une étude observationnelle, les patients
étaient informés par affichage dans chaque service
d’urgences que les données les concernant pouvaient faire
l’objet d’analyses statistiques et qu’ils avaient un droit
d’accès à ces données. Le protocole a été soumis au comité
local d’éthique de l’hôpital d’Annecy. Le fichier de don-
nées était anonymisé et sa constitution a été notifiée à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Données recueillies
Les données ont été recueillies par les techniciennes de
recherche du Renau dans chaque centre, à partir du dossier
médical informatisé. Les données psychosociales enregis-
trées à l’entrée de chaque patient étaient les suivantes :
l’âge, le sexe, la date et l’heure d’accueil aux urgences, le
mode d’entrée (moyens personnels, ambulance, pompiers,
Smur), le lieu de vie, l’isolement et l’autonomie antérieure.
L’isolement était coté «Vit seule »quand la personne vivait
seule à domicile sans passage d’aides ni de famille à proxi-
mité, «Famille présente »quand il y avait des passages de
l’entourage mais pas de passage d’aide professionnelle à
domicile et «Aide à domicile »quand il y avait un passage
d’un professionnel avec ou sans le passage de la famille.
La perte d’autonomie a été retenue quand il était noté que
le patient avait besoin d’aide pour les activités de base de
la vie quotidienne. Les conséquences traumatiques de la
chute ont été répertoriées avec les codes de la classifica-
tion internationale des maladies (CIM 10). L’orientation à
l’issue de la consultation aux urgences a été observée :
retour à domicile (RAD) direct ou via l’unité d’hospitalisation
de courte durée (UHCD), hospitalisation complète directe
ou via l’UHCD. Nous avons aussi noté si le patient a pu être
vu par l’équipe mobile de gériatrie aux urgences ou, dans
les 3 mois, au centre d’évaluation gériatrique (hôpital de jour
ou consultation). Les lettres envoyées au médecin traitant
ont été comptabilisées.
Nous avons retenu les critères de qualité de prise en
charge des chutes du patient âgé communs aux recomman-
dations nationales de la Haute autorité de santé (HAS) en
2009 [14], aux recommandations américaine et anglaise en
2011 [15] et aux indicateurs qualité de l’Acove 3 [16]. Nous
avons recherché si les éléments suivants figuraient dans les
dossiers des urgences :
– antécédent de chute au cours de l’année passée, définis-
sant le caractère répété de la chute actuelle ;
– polymédication (prise de plus de 4 traitements) et
notamment prise de benzodiazépines. Les ordonnances
comportant des psychotropes ou des cardiotropes ont été
comptabilisées ;
– évaluation de la marche et de l’équilibre aux urgences
(en l’absence de complication traumatique provoquant une
impotence fonctionnelle) : considérée comme réalisée
quand il était noté que le sujet avait fait quelques pas dans
le box des urgences ;
– réalisation d’un test d’hypotension orthostatique (en
l’absence de complication traumatique provoquant une
impotence fonctionnelle) ;
– dépistage des troubles des fonctions supérieures, retenu
quand le dossier mentionnait un traitement par anticholi-
nestérasique ou mémantine, la présence d’un syndrome
confusionnel, de troubles du comportement ou d’un syn-
drome démentiel dans les antécédents ;
– la réalisation de l’électrocardiogramme (ECG) a été
rajoutée, alors qu’elle ne figure pas dans toutes les recom-
mandations car il s’agit d’un examen contributif même s’il
n’y a pas de notion de malaise. Une étude a en effet mon-
tré que les sujets gardent le plus souvent une amnésie de
l’épisode de syncope [18] et les syndromes coronariens
peuvent être asymptomatiques [19].
Analyses statistiques
Les données ont été saisies sur tableur Microsoft Excel
au format 1997-2003, puis analysées avec le logiciel de
statistiques R version 3.0.0. Dans l’analyse descriptive, les
variables quantitatives ont été exprimées en moyenne et
en écart type, et les variables qualitatives en pourcentage
d’effectif des catégories.
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013 353
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am
S. Cabillic, et al.
Nous avons comparé la recherche de facteurs de risques
chez les patients ayant eu recours à l’évaluation géria-
trique et les autres. Les comparaisons univariées entre les
groupes ont été réalisées avec des tests d’indépendance
du 2. Pour les analyses multivariées, des régressions logis-
tiques multiples ont permis d’estimer les odds ratio ajustés
et leurs intervalles de confiance ainsi que les valeurs de p.
La valeur même des facteurs de risque n’a pas été étudiée
en tant que prédicteur du recours à l’évaluation gériatrique,
car on pouvait anticiper un nombre élevé de valeurs man-
quantes : dans les études antérieures, plusieurs facteurs de
risque n’étaient pas recherchés chez la plupart des patients
venant aux urgences pour chute [20, 21]. Le nombre de
sujets sans valeurs manquantes peut être trop faible pour
mettre en évidence un effet significatif, et amener à des
conclusions erronées si l’absence de données est différen-
tielle selon la valeur de la donnée non observée.
Résultats
Parmi l’ensemble des patients de plus de 75 ans qui
ont consulté aux urgences pour chute, 1 238 patients sont
rentrés à domicile (51,0 %) et 1 160 patients (47,8 %) ont
été hospitalisés (figure 1). Huit pour cent des patients ont
été hospitalisés via l’UHCD. Parmi les patients hospitali-
sés, 205/1 160 (17,7 %) l’ont été en court séjour gériatrique.
On comptait 14 décès (0,6 %) au sein des urgences. Les
caractéristiques de la population étudiée sont décrites dans
le tableau 1. Le groupe des patients hospitalisés et des
patients rentrant à domicile étaient différents en termes
d’âge, de mode d’arrivée et de circonstance de venue. La
moyenne d’âge des 1 238 patients inclus était de 84,2 ans.
On comptait 70 % de femmes. Le lieu de vie était préféren-
tiellement le domicile (75 %). Concernant les complications
traumatiques, 897 (37 %) diagnostics de fractures ont été
posés pour l’ensemble des patients et 339 (27 %) pour les
patients sortant directement des urgences (tableau 1). Les
fractures des membres supérieurs étaient plus fréquentes
chez ces derniers.
Le taux de conformité des dossiers pour les critères
retenus est présenté dans le tableau 2. Un antécédent
de chute était documenté chez 21 % des patients. Le
dépistage d’un trouble des fonctions supérieures a été ren-
seigné dans 25 % des cas. L’hypotension orthostatique et
les troubles de la marche et de l’équilibre ont été docu-
mentés respectivement pour5%et11%despatients
pouvant se mettre debout. L’ECG a été réalisé chez 29 %
des patients. Un bilan biologique a été effectué pour 27 %
des patients. Les dossiers comportaient une information
Recours à la gériatrie sur les 1 238 RAD :
. EMG aux urgences : 28 (2,3 %)
. CEG : 19 (1,5 %)
Recours à la gériatrie sur les 1 160 hospitalisés :
. Hospitalisation en gériatrie : 205 (17,7 %)
. EMG aux urgences : 89 (7,7 %)
. EMG en hospitalisation : 46 (4,0 %)
. CEG : 14 (1,2 %)
. 14 décès aux urgences
. 12 retours en hospit
alisation
. 2 sorties avant soins
Autre
n = 28 (1,2 %)
RAD direct
n = 1 133 (46,7 %)
Hospitalisation
n = 1 160 (47,8 %)
RAD
n = 1 238 (51,0 %)
Tous patients
n = 2 426
Hospitalisation directe
n = 966 (39,8 %)
UHCD
n = 299 (12 %)
Hospitalisation via UHCD
n = 194 (8,0 %)
RAD via UHCD
n = 105 (4,3 %)
Figure 1. Orientation des patients âgés consultant aux urgences pour chute. UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée ; EMG : équipe
mobile de gériatrie ; CEG : centre d’évaluation gériatrique ; RAD : retour à domicile.
Figure 1. Orientation and referral of older people presenting to the emergency department after a fall.
354 Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am
Prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs
Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des sujets et lésions traumatologiques.
Table 1. Sociodemographic characteristics of subjects and type of injury.
RADn=1238 Hospitalisationn=1160 Chi2 p
Age, moyenne (écart type) 84,2 (6,0) 85,0 (5,4) 19,5 (2) ***
85 ans et +, n (%) 574 (46) 619 (53)
Sexe féminin, n (%) 871 (70) 842 (73) 0,03 (1) NS
Lieu de résidence, n (%)†4,6 (2) *
Domicile 933 (75) 920 (80)
Institution 295 (24) 231 (20)
Autre 8 (1) 4 (0)
Mode de transport, n (%)†277,5 (4) ***
Moyens personnels 453 (38) 120 (11)
Ambulance privée 405 (34) 535 (47)
Pompiers 317 (27) 445 (39)
Smur 4 (0) 24 (2)
Autre 16 (1) 12 (1)
Admission la nuit (20-8h), n (%)†201 (16) 231 (20) 10,2 (1) *
Circonstances de venue, n (%) 150 (4) ***
Chute mécanique 966 (79) 682 (59)
Bilan de chute / chutes à répétition 104 (9) 179 (16)
Malaise 106 (9) 203 (18)
Autre 54 (4) 86 (8)
Lésions traumatologiques
Fracture, n (%) 339 (27) 548 (47) 70,2 (1) ***
Fracture membre inf., n (%) 68 (5) 398 (34) 255,8 (1) ***
Fracture membre sup., n (%) 196 (16) 124 (11) 22,6 (1) ***
Contusion, n (%) 407 (33) 116 (10) 178,8 (1) ***
Plaie, n (%) 321 (26) 86 (7) 117,7 (1) ***
RAD : retour à domicile ; NS : non significatif.
Pour chaque variable, tests d’indépendance entre la répartition des catégories et le fait d’être rentré à domicile.
†Pourcentages et test d’indépendance sont calculés sur les valeurs non manquantes. Nombre de valeurs manquantes (%) : lieu de vie : 7 (0,3 %). Mode de
transport : 67 (2,8 %). Admission la nuit : 3 (0,1 %).
***:p<0,001;*:p<0,05.
sur l’entourage du patient dans 54 % des cas. La notion de
perte d’autonomie a été renseignée pour 16 % des patients.
Tous ces indicateurs étaient plus souvent renseignés dans
les dossiers des patients hospitalisés (données disponibles
sur demande). L’ordonnance était disponible chez 55 %
des patients sortants. Les patients sortant directement des
urgences prenaient en moyenne 5,9 médicaments par jour
dont 0,7 traitement psychotrope. Dix-huit pour cent des
patients sortants étaient sous anticoagulants. Un courrier
a été adressé au médecin traitant pour 33 % des patients
sortants.
Cinq centres sur les treize disposaient d’une filière
d’évaluation fonctionnelle. Sur les 441 patients de ces
centres qui sont rentrés à domicile et pouvaient se mettre
debout, 23 (5,2 %) ont bénéficié d’une évaluation géria-
trique, soit par une équipe mobile de gériatrie aux urgences,
soit par un centre d’évaluation gériatrique dans les trois
mois suivant la chute (tableau 3). En analyse univariée, le
recours à l’évaluation gériatrique pour les patients sortants
était associé de manière significative au sexe féminin, à
la réalisation d’un ECG, à la recherche de troubles des
fonctions supérieures, d’un isolement social, de troubles
de l’équilibre et d’une hypotension orthostatique. En ana-
lyse multivariée, le sexe féminin, la recherche de troubles
des fonctions supérieures et de l’hypotension orthosta-
tique étaient des prédicteurs indépendants du recours à
l’évaluation gériatrique.
Discussion
Chez les patients consultant aux urgences pour chute,
les facteurs de risque de chute sont insuffisamment
documentés au regard des recommandations de l’HAS.
En effet, les notions d’antécédents de chute ou de
perte d’autonomie sont peu fréquemment consignées.
La marche et l’hypotension orthostatique sont rarement
testées. Une attention plus importante est portée au
dépistage des troubles des fonctions supérieures ou à la
réalisation de l’ECG. Cette faible documentation des fac-
teurs prédisposants à la chute laisse supposer qu’ils ne sont
pas recherchés de manière systématique. Plusieurs études
avaient déjà fait ce constat [22]. Pour Kalula et al., les anté-
cédents de chute étaient recherchés dans 20 % des cas,
l’hypotension orthostatique testée pour 2 % des patients
et les troubles de l’équilibre et de la marche recherchés
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013 355
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%