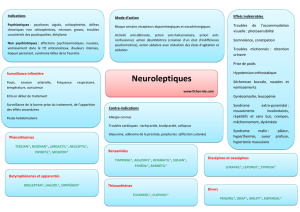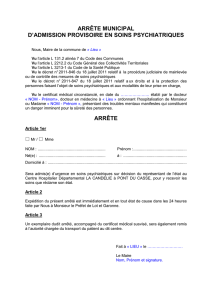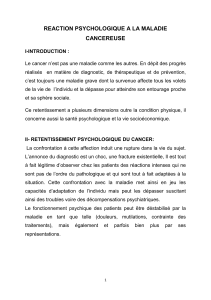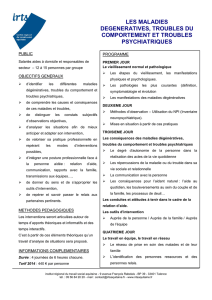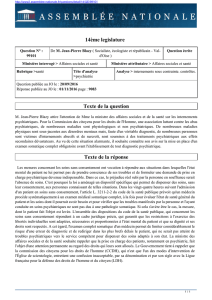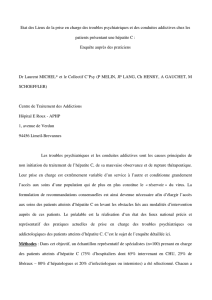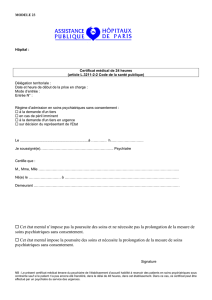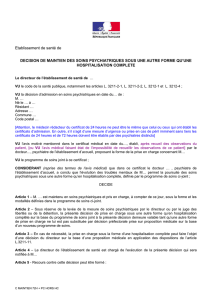Effets secondaires psychiatriques du traitement de l`hépatite

Mini-revue
Effets secondaires
psychiatriques du traitement
de l’hépatite chronique C :
caractérisation et prise en
charge
Laurent Castéra
Service d’Hépato-Gastroentérologie, hôpital Haut Lévêque, Avenue de Magellan,
33604 Pessac
Au cours du traitement de l’hépatite chronique C, les effets secon-
daires psychiatriques de l’interféron sont fréquents (20 à 30 %) et
constituent la première cause d’arrêt prématuré du traitement
antiviral. Il s’agit de troubles de l’humeur (dépression) pouvant
comporter une composante irritable, voire maniaque. Ils survien-
nent le plus souvent entre le premier et le troisième mois de
traitement. Il n’existe pas actuellement d’outil simple fiable pour le
dépistage de ces troubles et l’existence de facteurs prédictifs reste
controversée. Le dépistage précoce de la survenue de troubles de
l’humeur au cours du traitement antiviral et la prise en charge
thérapeutique appropriée, par l’utilisation d’antidépresseurs voire
de neuroleptiques, permet la poursuite du traitement antiviral dans
la majorité des cas et l’obtention de taux de guérison virologique
élevés. La constatation de troubles psychiatriques avant traitement
ne doit pas constituer une contre-indication à la mise en route d’un
traitement antiviral lorsque celui-ci est justifié par la sévérité de la
maladie hépatique.
Mots clés : hépatite C, interféron, dépression, irritabilité
Le traitement de l’hépatite chronique C repose actuellement sur
l’utilisation combinée de l’interféron pégylé et de la ribavirine,
permettant d’obtenir une guérison chez près de 60 % des malades.
En dépit des progrès thérapeutiques accomplis en terme d’efficacité, les
effets secondaires occasionnés par ce traitement sont nombreux. Parmi
ceux-ci, les manifestations psychiatriques, liées à l’utilisation de l’interfé-
ron, constituent la première cause d’arrêt prématurée du traitement
antiviral. En outre, des antécédents psychiatriques ou l’existence d’une
pathologie psychiatrique sont des raisons fréquemment invoquées pour ne
pas initier le traitement antiviral. La méconnaissance ou la sous-estimation
de ces manifestations peuvent donc être préjudiciables à la prise en
charge des malades atteints d’hépatite chronique C.
L’objet de cette mini-revue est de faire le point sur les effets secondaires
psychiatriques du traitement de l’hépatite chronique C et leur prise en
charge en pratique.
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
Tirés à part : L. Castéra
91
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Quels sont les effets secondaires
psychiatriques potentiels
du traitement de l’hépatite C ?
Incidence et délai de survenue
La survenue de manifestations psychiatriques au cours
du traitement de l’hépatite chronique C est rapportée
avec une prévalence dépassant 20 % [1]. L’interféron
peut être responsable d’effets secondaires psychiatri-
ques sévères selon un mécanisme qui reste méconnu.
La ribavirine ne semble pas aggraver les manifesta-
tions psychiatriques de l’interféron, en particulier l’inci-
dence de la dépression [2]. Les manifestations psychia-
triques peuvent survenir dès la première semaine de
traitement, mais sont particulièrement marquées entre
le premier et le troisième mois [3-7]. L’incidence et la
sévérité des symptômes psychiatriques semblent liées à
la dose et à la durée du traitement. L’incidence dépend
plus de la posologie d’interféron que de la dose
cumulée.
Nature et sévérité
Les manifestations psychiatriques occupent un large
spectre [8-11] allant de symptômes mineurs très fré-
quents comme l’asthénie, les troubles de la concentra-
tion, l’absence de motivation, l’irritabilité, l’anxiété, les
troubles du sommeil et la diminution de la libido à des
symptômes plus sévères mais heureusement moins fré-
quents comme la dépression avec idées suicidaires,
des états psychotiques ou maniaques et des suicides
[12]. Ainsi, l’asthénie est rapportée dans près de 70 %
des cas, les troubles du sommeil dans 30 %, l’irritabi-
lité dans 20 à 30 % et l’anxiété dans 10 à 20 % des
cas [13]. Il est important de noter que ces symptômes
peuvent être parfois difficiles en pratique à distinguer
des symptômes neurovégétatifs induits par l’interféron.
Cependant ces derniers sont en général rythmés par
les injections, s’amendent au cours du temps et répon-
dent aux traitements symptomatiques par antipyréti-
ques ou antalgiques [14].
La dépression est la manifestation sévère la plus fré-
quente, rapportée dans la littérature avec une inci-
dence allant de 0 % à 52 % avec l’interféron standard
[15]. Dans les études plus récentes utilisant l’interféron
pégylé, cette prévalence, probablement plus proche
de la réalité, est comprise entre 16 et 31 % [15]. Cette
variabilité importante, doit inciter à la prudence dans
l’interprétation des résultats de ces études. La perti-
nence et la sensibilité des outils utilisés pour le diagnos-
tic de dépression sont des éléments importants à pren-
dre en compte. En effet, la plupart des études ont utilisé
un examen clinique non standardisé ou bien la réponse
à des questionnaires ou à des échelles, outils qui, pour
la dépression, sont de faible valeur descriptive et
diagnostique [16, 17]. Le diagnostic de dépression
requiert des critères précis comme ceux édictés par le
manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux de la société américaine de psychiatrie (DSM-IV :
Diagnostic and statistical manual of mental disorders,
4
th
edition [18]). Ainsi, la présence pendant une durée
minimum de deux semaines d’au moins 5 des 9 symp-
tômes listés dans le tableau 1 est nécessaire ; en outre,
un des symptômes au moins doit être une humeur
dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir. Ces
symptômes doivent induire une souffrance cliniquement
significative ou une altération du fonctionnement
social, professionnel ou dans d’autres domaines impor-
tants. Il est important de souligner aussi que la préva-
lence des symptômes dépressifs avant traitement n’était
pas évaluée dans la plupart de ces études [15].
L’irritabilité est aussi un symptôme fréquent au cours du
traitement antiviral, rapporté avec une prévalence de
24 % à 35 % dans les essais pivots [19, 20], proche
de celle de la dépression dans ces études (respective-
ment 22 % et 31 %). Lorsqu’il existe une humeur irrita-
Tableau 1.Critères pour le diagnostic de dépression selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
de la Société américaine de psychiatrie (DSM–IV)
Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une durée de deux semaines et avoir représenté
un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive (critère n°1), soit une
perte d’intérêt ou de plaisir (critère n°2) :
1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée et presque tous les jours
2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée et presque tous les
jours
3. Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime
4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours
5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours
6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours
7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours
9. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
92
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

ble prédominante, il convient de rechercher soigneuse-
ment des éléments maniaques afin de faire le
diagnostic différentiel avec les états mixtes qui com-
prennent à la fois les critères diagnostiques de dépres-
sion et de manie. Il est possible que la prévalence des
symptômes maniaques ait été sous-estimée ou négligée
jusqu’à présent, la plupart des études s’étant focalisé
sur la symptomatologie dépressive. Ainsi dans notre
expérience [7] chez 98 malades naïfs traités par
interféron pégylé et ribavirine, ayant bénéficié d’une
évaluation psychiatrique systématique pendant toute la
durée du traitement, 38 (39 %) ont présenté un épisode
psychiatrique survenant la plupart du temps (87 % des
cas) au cours des trois premiers mois de traitement. Il
s’agissait de troubles de l’humeur dans tous les
cas correspondant soit à une dépression associée à
des symptômes maniaques dans 17 cas (45 %) ; soit à
une manie/hypomanie irritable dans 21 cas (55 %).
Ces résultats suggèrent que les manifestations psychia-
triques induites par l’interféron obéissent à une classi-
fication plus complexe que celle de la simple dépres-
sion, en raison notamment de la présence simultanée
très fréquemment de symptômes d’irritabilité [21].
Comment reconnaître
une manifestation psychiatrique
préoccupante au cours
du traitement de l’hépatite C ?
En pratique, compte tenu de leur gravité potentielle,
l’identification précoce de la survenue de manifesta-
tions psychiatriques, en particulier de troubles de
l’humeur au cours du traitement antiviral, à l’aide
d’outils pertinents, est cruciale pour une prise en
charge thérapeutique adaptée. Plusieurs questionnai-
res et échelles, présentant l’avantage de pouvoir être
administrés et interprétés rapidement, ont été proposés
[5, 22-26]. Avec ce type d’échelles, le malade est
considéré comme cliniquement déprimé lorsque le
score dépasse un seuil critique. Il est important cepen-
dant en pratique d’établir une distinction entre « symp-
tomatologie dépressive » et « dépression clinique » :
d’une part, la première est beaucoup plus fréquente
que la seconde, d’autre part, un sujet peut présenter
une humeur dépressive (dysphorie) sans être atteint
pour autant de dépression clinique, diagnostic obéis-
sant à des critères précis comme ceux édictés par le
DSM-IV. Il est important de garder à l’esprit que l’inter-
féron, en dehors de toute symptomatologie dépressive,
peut entraîner une perte de poids, des troubles du
sommeil et une asthénie, c’est-à-dire 3 des 5 symptô-
mes requis pour poser le diagnostic d’épisode dépres-
sif majeur. Le diagnostic reposant alors quasiment sur
les deux items concernant l’humeur (humeur dépressive
ou perte de plaisir), il est nécessaire d’être particuliè-
rement vigilant sur la notion de durée et de perma-
nence des symptômes (qui doit être au minimum de
2 semaines). L’humeur dépressive, généralement asso-
ciée au syndrome grippal survenant au cours des 48
premières heures suivant l’injection d’interféron, n’est
donc pas suffisante pour pouvoir poser le diagnostic
d’épisode dépressif.
Les entretiens semi-structurés conduits par un psychiatre
tels que le SCID (The Structured Clinical Interview for
DSM-III R) [27] ou plus récemment le MINI (Mini-
International Neuropsychiatric Interview for DSM-IV)
[28] constituent en pratique les meilleurs outils diagnos-
tiques. Il s’agit d’entretiens non directifs mais guidés
par un outil d’évaluation psychiatrique tel que le
DSM-IV par exemple. Leur sensibilité et leur spécificité
sont généralement très bonnes en ce qui concerne les
diagnostics psychiatriques usuels. Cependant, ils sont
plus longs et plus difficiles à utiliser que les échelles,
nécessitant une formation particulière ou le recours à
des spécialistes.
Peut-on anticiper la survenue
de manifestations psychiatriques
au cours du traitement antiviral ?
La fréquence des comorbidités psychiatriques justifie
leur dépistage avant d’entreprendre un traitement anti-
viral. En pratique, la mise en route de celui-ci n’est
jamais urgente, et un interrogatoire minimum, pouvant
être effectué par tout médecin, devrait comprendre la
recherche d’antécédents psychiatriques personnels et
familiaux, en particulier de dépression ou de tentative
de suicide, de conduites addictives anciennes ou
récentes.
Peu d’éléments permettent néanmoins d’identifier les
sujets à risque de développer une complication psy-
chiatrique. Les données de la littérature sont limitées et
souvent contradictoires. Certaines études [4, 6, 29]
n’ont pas trouvé de facteurs de risque particuliers,
d’autres [5, 21, 30, 31], au contraire, ont suggéré que
les antécédents psychiatriques ou les antécédents de
toxicomanie constituaient des facteurs de risque pour
la survenue de dépression. Cependant, en pratique,
l’existence de facteurs de risque ne doit pas conduire à
contre-indiquer le traitement chez ces patients.
Conduite à tenir en pratique
lors de l’instauration
du traitement antiviral
Des recommandations pratiques sont proposées dans
le tableau 2. Trois types de situations peuvent être
individualisés.
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 93
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Patients sans manifestation
ni antécédent psychiatrique
Compte tenu de la fréquence des manifestations psy-
chiatriques et de la difficulté de prévoir leur survenue, il
est important au moment de l’initiation du traitement
d’informer le patient et son entourage sur la possibilité
de leur survenue et d’attirer leur attention sur certains
symptômes d’alarme (impulsivité, irritabilité ou anxiété
importantes, agressivité au travail ou envers les pro-
ches, crises de larmes, humeur labile, idées noires
voire suicidaires). Une collaboration étroite entre le
médecin généraliste et le spécialiste est nécessaire car
c’est bien souvent le médecin traitant qui est en pre-
mière ligne pour dépister la survenue de ces troubles.
Patients sans maladie psychiatrique
mais ayant des antécédents psychiatriques
L’existence d’antécédents psychiatriques devrait inciter
à la prudence avant l’instauration du traitement antivi-
ral. Il faut bien mettre en balance le bénéfice escompté
en termes de chances de guérison et d’impact sur la
maladie hépatique par rapport aux risques de surve-
nue de manifestations psychiatriques au cours du trai-
tement. Un avis spécialisé nous semble souhaitable,
d’une part, pour obtenir l’aval du psychiatre, d’autre
part, pour organiser la mise en place éventuelle d’un
suivi au cours du traitement. L’intérêt d’un traitement
antidépresseur préventif pourrait aussi être discuté.
Celui-ci a été suggéré suite aux résultats spectaculaires
d’une étude conduite chez des patients atteints de
mélanome métastatique [32]. Dans cette étude contrô-
lée, les malades recevaient de la paroxétine à la dose
de 10 mg/j pendant les 2 semaines précédant le
début du traitement par interféron, puis à la dose de 20
à 40 mg/j pendant toute la durée du traitement. Com-
parés aux malades recevant le placebo, les malades
recevant la paroxétine avaient significativement moins
d’épisodes dépressifs majeurs et une meilleure obser-
vance du traitement par interféron. En raison des très
fortes doses d’interféron utilisées (20 MU/m
2
de sur-
face corporelle 5 jours par semaines pendant les 4
premières semaines, puis 10 MU/m
2
de surface cor-
porelle 3 fois par semaine) et des taux élevés de
dépression dans le groupe placebo (45 %), attribua-
bles en partie à la gravité de la maladie traitée, ces
résultats encourageants ne sont probablement pas
extrapolables aux malades atteints d’hépatite chroni-
que C. Bien qu’attractive, la stratégie d’un traitement
préventif systématique paraît difficilement recomman-
Tableau 2.Propositions pour le dépistage et la prise en charge des symptômes psychiatriques avant et au cours du traitement
par interféron (IFN) (d’après [10]).
1. Compte tenu du risque élevé de survenue de troubles de l’humeur sous IFN :
- informer le patient et son entourage des risques durant le traitement,
- apprendre au patient à reconnaître les symptômes qui doivent l’alarmer.
2. Un avis psychiatrique est nécessaire avant d’initier un traitement par IFN en cas :
- d’antécédents de dépression ou de dépression active,
- d’antécédents familiaux de dépression ou de suicide,
- d’antécédents psychiatriques, et notamment de troubles maniaco-dépressifs.
3. Lorsqu’il existe une dépression caractérisée au moment d’entreprendre le traitement par IFN :
- il faut d’abord traiter la dépression ; une fois celle-ci contrôlée, l’IFN peut être entrepris,
- une fois le traitement entrepris, une surveillance étroite à la recherche d’une rechute est impérative.
4. Chez les patients ayant des antécédents de toxicomanie ou substitués :
- une surveillance étroite à la recherche d’une rechute ou de troubles de l’humeur est nécessaire durant le traitement.
5. La surveillance au cours du traitement par IFN devrait comporter :
- l’évaluation à chaque consultation de troubles de l’humeur ou d’idées suicidaires,
- une attention particulièrement focalisée sur certains symptômes : irritabilité importante, impulsivité, agressivité, au travail, envers les
proches et la famille, humeur triste, anhédonie, culpabilité, désespoir, repli, pensées ruminatives,
- la demande d’un avis spécialisé en cas de doute.
6. En cas de survenue de troubles de l’humeur au cours du traitement :
- l’IFN peut être poursuivi si ceux-ci ne sont pas sévères,
- ne pas hésiter à utiliser des antidépresseurs (les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine constituent la classe préférentielle),
- en l’absence de réponse rapide aux antidépresseurs, diminuer les doses d’IFN, voire interrompre le traitement de façon transitoire, ou
utiliser des antipsychotiques (amisulpride) à faible dose,
- en cas de dépression atypique (notamment avec une irritabilité), rechercher de manière active des symptômes maniaques et ne pas
hésiter à utiliser des antipsychotiques (amisulpride) à faible dose,
- en cas de dépression ou de manie sévère ou de tentative de suicide, l’IFN doit être interrompu et le patient confié à un psychiatre.
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006
94
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

dable en pratique actuellement. Une étude multicentri-
que française devrait démarrer prochainement pour
tenter de répondre à cette question. Dans l’attente de
ses résultats, cette stratégie semble mériter d’être dis-
cutée au cas par cas dans le cadre d’une approche
multidisciplinaire.
Patients ayant une maladie psychiatrique
L’existence de troubles psychiatriques préexistants est
une raison fréquemment invoquée pour ne pas initier le
traitement antiviral et la conférence de consensus fran-
çaise qui s’est tenue en 2002 [33] est restée très
prudente à cet égard. Plusieurs études [34-36] ont
pourtant rapporté la possibilité de traiter par interféron
des malades atteints de troubles psychiatriques, sans
risque accru de développer des complications neurop-
sychiatriques ou d’interrompre le traitement. Ainsi
Schaefer et al. [35] ont comparé l’observance et les
effets secondaires psychiatriques d’un traitement par
interféron et ribavirine chez des malades ayant des
contre-indications psychiatriques classiques à l’interfé-
ron (maladies psychiatriques sévères : dépression,
anxiété majeure, schizophrénie, toxicomanie active ou
récente) par rapport à des patients contrôles (aucun
trouble psychiatrique actuel ou passé). Les résultats en
termes de réponse virologique et d’incidence de
dépression ne différaient pas entre les groupes. Cepen-
dant, dans le groupe des malades psychiatriques,
l’utilisation d’antidépresseurs était significativement
plus fréquente. Aucun malade n’a été obligé d’inter-
rompre le traitement en raison d’une aggravation de
son état psychiatrique. En revanche, dans le groupe
des malades ayant des antécédents de toxicomanie,
les taux d’arrêt de traitement étaient significativement
plus élevés (43 % versus 13 à 18 % dans les autres
groupes). Cependant, dans une étude rétrospective
américaine [30], les malades ayant une affection psy-
chiatrique préalable au traitement avaient significative-
ment plus d’effets secondaires que les autres (68 %
versus 29 %, p = 0,02). Des effets secondaires psy-
chiatriques majeurs étaient observés chez 24 % des
malades, avec une fréquence accrue, bien que non
significative, dans le groupe de malades ayant une
affection psychiatrique préalable. L’ensemble de ces
données suggère qu’un traitement antiviral est envisa-
geable chez les malades ayant des antécédents psy-
chiatriques ou une maladie psychiatrique évolutive. Le
traitement antiviral devrait cependant être réservé en
priorité aux malades dont la sévérité de la maladie
hépatique le justifie. Il est bien sûr nécessaire dans ces
cas, de s’assurer au préalable de la stabilité de la
maladie psychiatrique, d’informer le malade et son
entourage des risques encourus et d’effectuer une sur-
veillance psychiatrique régulière pendant toute la
durée du traitement antiviral dans le cadre d’une col-
laboration multidisciplinaire étroite entre hépatologue,
psychiatre et médecin généraliste.
Quelle surveillance psychiatrique
au cours du traitement antiviral ?
Nécessité d’une prise en charge
pluridisciplinaire
Le traitement de l’hépatite chronique C est un traitement
long et pénible mais son initiation est rarement urgente.
Sa mise en route nécessite donc au préalable une
bonne coordination entre les différents acteurs impli-
qués : hépatologue ou interniste, addictologue et
médecin généraliste. Le recours à un psychiatre doit
être discuté lorsqu’il existe des symptômes préoccu-
pants justifiant un traitement spécifique, à condition
que le patient en accepte le principe et que le rendez-
vous proposé ne soit pas trop lointain.
Rythme et nature
La vigilance doit être maximale durant les trois pre-
miers mois de traitement. Une consultation systémati-
que avec le spécialiste 1 mois après le début du
traitement antiviral semble souhaitable car elle permet
de faire le point avec le patient (et son conjoint ou son
entourage, si possible) sur l’existence de symptômes
d’alerte (irritabilité importante, insomnies, idées noi-
res) et le cas échéant d’adapter les doses du traitement
antiviral en fonction de la tolérance clinique mais aussi
biologique (neutropénie ou anémie). Une nouvelle éva-
luation au troisième mois de traitement nous semble
indispensable. La survenue de troubles, passée cette
période, est encore possible mais beaucoup moins
probable (moins de 15 % dans notre expérience). En
outre, la connaissance de la réponse virologique pré-
coce est un élément clé de la motivation du patient pour
la poursuite du traitement antiviral. L’absence de
réponse virologique précoce peut conduire dans cer-
tains cas à l’arrêt du traitement antiviral chez un patient
ayant été préalablement préparé à cette éventualité
lors de l’initiation. Dans l’intervalle, un suivi mensuel
par le médecin généraliste est souhaitable. Celui-ci doit
bien sûr être informé des symptômes d’alerte (irritabi-
lité importante, insomnies, idées noires) qui peuvent
conduire à prendre un avis spécialisé.
Situations psychiatriques
nécessitant une modification
ou un arrêt du traitement antiviral
En cas de survenue de troubles de l’humeur, le traite-
ment antiviral, en particulier l’interféron, peut être
poursuivi en l’absence de signes de sévérité
(tableau 2). Une diminution des doses peut être propo-
Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 95
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%