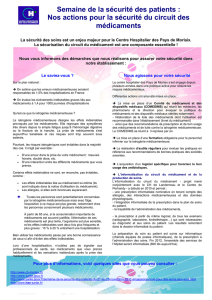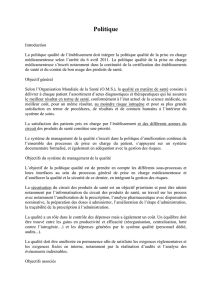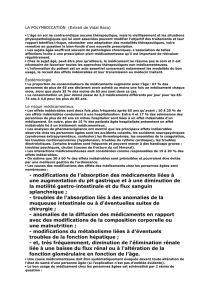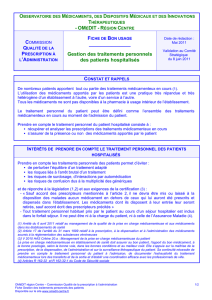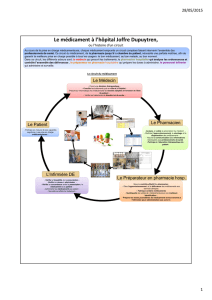Améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions de médicaments

Note méthodologique
et de synthèse documentaire
Comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions
de médicaments chez la personne âgée ?
Septembre 2014

© Haute Autorité de Santé Septembre 2014
Cette note méthodologique et de synthèse documentaire
est téléchargeable sur :
www.has-sante.fr
Haute Autorité de Santé
Service communication – information
2, avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 – Fax : +33 (0)1 55 93 74 00

Septembre 2014 I 3
Sommaire
Introduction : Que sont les fiches parcours Points clés et solutions ? ...................................................... 4
1. Méthode d’élaboration........................................................................................................................ 4
1.1. Sollicitation des experts ........................................................................................................................................ 4
1.2. Compte-rendu de la réunion des parties prenantes du 04/02/2014 ..................................................................... 5
2. Enjeux ................................................................................................................................................ 7
2.1. Évolution démographique ..................................................................................................................................... 7
2.2. Qualité de la prescription des médicaments ......................................................................................................... 9
2.3. Impact sur le système de soins .......................................................................................................................... 14
2.4. Facteurs, pratiques et situations à risque ........................................................................................................... 14
3. Évaluation des interventions visant à réduire les problèmes associés aux médicaments ................ 16
3.1. Objectifs et bénéfices attendus .......................................................................................................................... 16
3.2. Amélioration de la qualité et de la sécurité des prescriptions de médicaments .................................................. 17
4. Points à retenir ................................................................................................................................. 22
Annexe 1. Stratégie de recherche bibliographique et critères de sélection documentaire ..................... 23
Recherche bibliographique ........................................................................................................................................... 23
Annexe 2. Participants ........................................................................................................................... 26
Représentants des parties prenantes ........................................................................................................................... 26
Groupe de travail .......................................................................................................................................................... 26
Pour la HAS .................................................................................................................................................................. 27
Groupe de lecture ......................................................................................................................................................... 27
Annexe 3. Glossaire .............................................................................................................................. 28
Annexe 4. Études françaises et étrangères sur la sécurité des prescriptions de médicaments ............. 32
Annexe 5. Caractéristiques des revues et méta-analyses retenues ....................................................... 39
Bibliographie .......................................................................................................................................... 49

Septembre 2014 I 4
Introduction : Que sont les fiches parcours Points clés et solutions ?
Dans le cadre de ses missions d’information des professionnels de santé et du public, la Haute Autorité
de Santé poursuit la démarche d’élaboration d’outils d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins en lien avec les organisations professionnelles avec la diffusion des fiches Points clés et solutions.
Les fiches Points clés et solutions sont des documents courts dont l’objectif est de proposer une synthèse
de la littérature pour une meilleure qualité des soins, sur une question d’intérêt général susceptible de
modifier les organisations professionnelle.
Aux fiches Points clés et solutions sont associées une note de problématique et une synthèse méthodo-
logique et bibliographique. L’impact en santé publique, les enjeux professionnels et les solutions y sont
analysés en se référant aux données les plus récentes de la littérature.
La synthèse bibliographique porte sur la prévention et la gestion des problèmes associés aux médica-
ments (PAM). L’analyse décrit la population exposée aux problèmes de médicaments, les mécanismes
professionnels et organisationnels en cause et les conséquences sur le système de soins (sollicitation
des structures hospitalières) et sur l’état de santé du patient (événement indésirable lié aux médicaments
[EIM] et perte de chances par sous-traitement).
Elle rappelle les notions de bonnes pratiques de prescription et les caractéristiques des prescriptions (au
sens prises en charge) inappropriées.
L’abondance de la littérature sur le médicament permet un point actualisé sur les interventions et les
programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prescriptions de médicaments chez la
personne âgée et l’apport de l’informatique médicale.
1. Méthode d’élaboration
1.1. Sollicitation des experts
Les sociétés savantes et associations professionnelles suivantes sont sollicitées pour l’élaboration de la
fiche :
le Collège national professionnel de gériatrie ;
la Société française de gériatrie et de gérontologie ;
la Société française de pharmacie clinique ;
le Collège de la médecine générale ;
l’Union nationale des professions de santé ;
la fédération française des maisons et pôles de santé ;
l’union nationale des réseaux de santé ;
les représentantes du pré collège des infirmiers ;
les représentants du pré collège des pharmaciens ;
le Collectif inter-associatif sur la santé ;
des représentants de l’hospitalisation à domicile ;
l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne ;
l’agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais.

Septembre 2014 I 5
1.2. Compte-rendu de la réunion des parties prenantes du 04/02/2014
La réunion avait comme objectif de produire une analyse pluriprofessionnelle évaluant l’intérêt, les objec-
tifs et les messages d’une fiche parcours point clés et Solutions sur la réduction des problèmes associés
aux médicaments (PAM) et leurs conséquences pour la santé du patient, les pratiques professionnelles
et le système de soins. Les parties prenantes s’accordent sur les points suivants.
Caractéristiques des problèmes associés aux médicaments
Iatrogénie médicamenteuse, non-adhésion et sous-traitement sont des problèmes de pratique cou-
rante fréquents chez la personne âgée, favorisés par la polypathologie et la polymédication.
Trois mécanismes principaux sont à l’origine des PAM : le manque de coordination entre prescrip-
teurs/secteurs, le manque d’information et de formation des patients (éducation) et les prescriptions
sous-optimales. Ces problèmes sont présents dans tous les secteurs du soin-domicile, EHPAD ou
hôpital (sorties).
Les PAM pèsent sur le système de santé ; la iatrogénie médicamenteuse à elle seule serait cause
directe ou associée de 20 % des visites aux urgences, 5 à 10 % des hospitalisations, 60 à 80 % des
réadmissions après un séjour hospitalier. Le défaut de surveillance clinique et biologique des traite-
ments est une des causes régulièrement citées dans l’analyse des hospitalisations « médicamen-
teuses évitables.
L’environnement médical favorise la survenue des PAM : absence de dossier médical partagé, ab-
sence d’historique des médicaments unique, répertoires des spécialités pharmaceutiques différents
entre les secteurs sanitaires, coopération pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle insuffisante, infor-
mation et éducation du patient insuffisante dont la qualité est rarement évaluée.
Interventions efficaces
En France comme dans d’autres pays, la majorité des PAMS graves (vus aux urgences ou respon-
sables d’hospitalisations) aurait pu être évitée par une prise en charge appropriée. À l’origine PAM
graves, quatre domaines de non-qualité : (i) la qualité de la prescription/ décision/ordonnance - ; (ii)
les modalités de surveillance clinique et biologique ; (ii) l’information du patient/la formation du patient
à la gestion de ses médicaments et (iv) la continuité et la cohérence des soins entre les différents ac-
teurs et secteurs.
La place des médicaments dans les thérapeutiques actuelles est majeure et inégalée dans l’histoire
de la médecine. La prescription et la surveillance d’un traitement médicamenteux peuvent être un
processus complexe notamment chez la personne âgée polypathologique. L’amélioration de ce pro-
cessus passe par une évaluation de toutes les étapes (choix du traitement, surveillance des traite-
ments, évaluation des capacités du patient à gérer et interfaces prescripteurs/patient ; médecin trai-
tant/spécialiste ; soins ambulatoire/soins hospitaliers du processus et ne se limite pas à l’analyse
« décontextualisée » d’une ordonnance. Les actions ponctuelles ciblant une étape ne sont pas effi-
caces (pas d’effet clinique, peu d’effet sur le recours aux soins).
Les questions suivantes serviront de guide pour la rédaction de la fiche :
Quels sont les enjeux et l’impact des PAM/EIM
Comment repérer les personnes à risque de problèmes avec les médicaments (PAM) ?
Comment les prévenir et les prendre en charge ?
Quelles interventions peuvent être utiles pour réduire les risques d’erreur médicamenteuse au
moment des transitions, le risque iatrogénique en soins ambulatoires ?
De quels outils dispose-t-on pour améliorer efficacement la qualité et la sécurité des prescriptions ?
Dans quelles conditions et avec quels intervenants ces interventions sont-elles efficaces ? Des ap-
puis sont-ils nécessaires à l’équipe de santé primaire pour réduire les PAM (iatrogénie médicamen-
teuse, sous-prescription, adhésion ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%