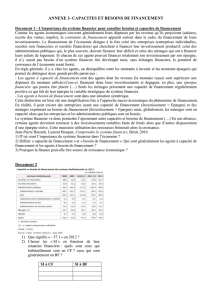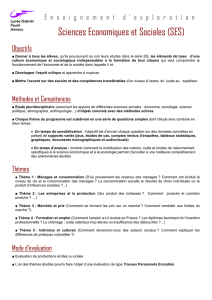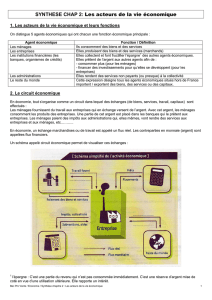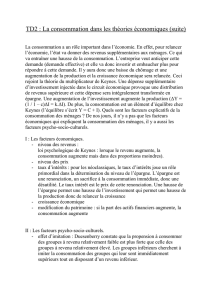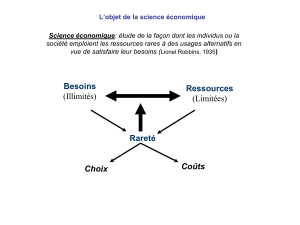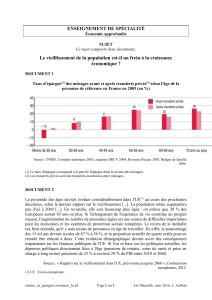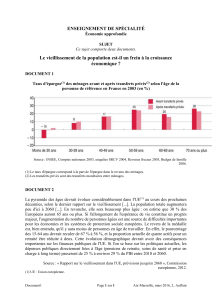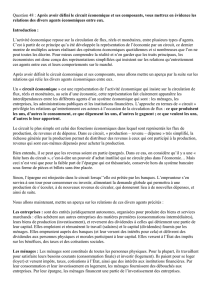Pouvoir d`achat et consommation - Le prix de la confiance

La question du pouvoir d’achat monopolise le débat
économique. Il est vrai que, depuis de nombreuses années,
la demande des consommateurs fait marcher la croissance.
La hausse des prix va-t-elle la ralentir ?
C’est une question de con ance.
Les Français estiment que leur
pouvoir d’achat n’augmente
pas. Pourtant, l’Insee a mesuré
qu’entre 1996 et 2006, il avait pro-
gressé de 1,9 % par an, malgré une
croissance modérée et en raIson no-
tamment d’une in ation très faible. Il
existerait donc un décalage entre la
perception et la réalité. Qui a tort et
qui a raIson ?
Ce qui est vrai, c’est que nos modes
de consommation évoluent et mo-
di ent nos repères sur les prix. Ces
repères ont été bouleversés par le
passage à l’euro. Ceci d’autant plus
que certains acteurs de l’économie,
notamment les secteurs des services,
en ont pro té pour ajuster leurs prix
à la hausse.
Mais la sensation de baisse du pou-
voir d’achat est d’abord liée au poids
croissant des dépenses “contrain-
tes” ou “contractuelles” (logement,
chauffage, électricité, assurances...).
Les dépenses de logement, avec le
transport et l’alimentation, repré-
sentent aujourd’hui plus de la moitié
du budget des ménages. Ces trois
postes essentiels dans le panier des
ménages subissent de plein fouet la
hausse du prix des matières premiè-
res (énergie, produits agricoles). Va-t-
elle assécher la consommation ?
Le retour de l’infl ation
Depuis le début des années 2000, les
ménages ont maintenu leur rythme
de consommation, malgré les aléas
sur leur pouvoir d’achat. Pour cela,
ils ont pioché dans leurs réserves
d’épargne. Le dynamisme de la
consommation s’est surtout porté
sur les achats de biens et services
des technologies de l’information et
de la communication (un secteur qui
a connu une croissance à deux chif-
fres) et les dépenses liées aux loisirs
et à la culture.
L’évolution de la conjoncture mon-
diale (hausse des prix des matières
premières, crise immobilière aux
USA,…) pourrait modi er la donne en
affectant la con ance des consom-
mateurs. En 2007 déjà, ceux-ci ont
eu à supporter la hausse des prix ali-
mentaires (moins élevée que ce que
les médias ont pu rapporter) et la
hausse de l’énergie (plus élevée que
prévue). Parallèlement, les dépen-
ses liées au logement et à l’équipe-
ment continuent de progresser et
de grignoter le budget des ménages.
D’autant que le taux d’épargne en
France se maintient à un niveau élevé
(16 % des revenus). Il n’est donc pas
étonnant que la question du pouvoir
d’achat - donc de la capacité à main-
tenir, voire accentuer son niveau de
consommation - soit devenue cen-
trale chez nous.
De nouvelles envies
Car les Français conservent l’envie de
consommer. Du reste, des dépenses
nouvelles apparaissent. Si elles ponc-
tionnent les budgets, elles facilitent
le quotidien, le rendant plus facile et
plus confortable. Le pouvoir d’achat
ne mesure pas ces éléments qui font
la qualité et le niveau de vie. Et pour-
tant, ce niveau de vie s’améliore.
Les services apportés par les tech-
nologies de l’information et de la
Gestion
OÙ VA NOTRE ARGENT ?
Répartition de la consommation des ménages en 2006
Le poste “logement équipement de la maIson” représente près d’un tiers du bud-
get des ménages français. Or, les loyers augmentent à un rythme de 3,6 % par an.
Viennent ensuite les dépenses de transports-communication (17,5 %) et d’alimenta-
tion (16,3 %). Trois postes qui subissent, ou vont subir, l’impact de la hausse du prix
des matières premières.
Alimentation
Boissons
Habillement
Logement
équipement
Santé
17,5 %
16 %
11 % 16,3 %
31,1 %
3,4 %
4,7 %
Autres biens
et services
Loisirs-culture
-hôtel-restos
Transport
communication
•
•
•
•
•
•
•
Pouvoir d’achat et
consommation :
le prix
de la confi ance
Jacques MATHÉ, économiste
Économie
Brèves
Juridique
Fiscalité
ASSURANCE-VIE :
information
des bénéfi ciaires
A n d’éviter la déshérence des contrats
d’assurance-vie, une loi du 11 décem-
bre 2007 prévoit que l’acceptation du
béné ciaire sera faite désormais par un
avenant signé par l’assureur, l’acceptant
et le souscripteur ou encore par acte
notarié. Cette mesure lève le paradoxe
qui existait avant l’adoption de cette
loi. Le souscripteur de l’assurance-vie
évitait de prévenir le bénéficiaire car
l’acceptation par le bénéficiaire sans
autorisation du souscripteur entraînait
un blocage des sommes. Le souscrip-
teur dans le besoin ne pouvait plus
récupérer les sommes ainsi placées. Or,
le défaut d’information ne permettait
pas aux béné ciaires, au jour du décès
du souscripteur, de récupérer les som-
mes ainsi placées à leur pro t.
SURSIS DE PAIEMENT DES
IMPÔTS : pas de garantie
Le contribuable qui conteste le bien-
fondé ou le montant d’une imposition
peut demander un sursis de paiement
à condition, souvent, de constituer des
garanties (caution bancaire par exem-
ple). Le contribuable est maintenant
dispensé de fournir de telles garanties
quand l’assiette de l’impôt contesté est
inférieure à 4 500 € (au lieu de 3 000
euros en 2007).
SANCTIONS
non déductibles
À compter des exercices clos à partir du
31 décembre 2007, la non déductibilité
des sanctions pécuniaires du résultat
imposable des entreprises, est éten-
due à toutes les sanctions et pénalités
pour non respect d’obligations légales,
quelle qu’en soit l’origine. C’est le cas
notamment des majorations en cas de
paiement en retard des cotisations de
sécurité sociale.
SANCTION
des retards de paiement
Les clients négligents risquent
désormais une amende en cas de
non-respect du délai de paiement
convenu avec un fournisseur.
Cette amende peut atteindre :
• 15 000 € si les poursuites sont diri-
gées à l’encontre d’une personne
physique (dirigeant ou salarié) ;
• 75 000 € si elles sont dirigées à
l’encontre d’une société (ou de
toute autre personne morale).
L’alimentation va-t-elle faire les frais du
retour de l’in ation et de la montée en
puissance des nouvelles technologies dans
les dépenses des ménages ?
Juridique Juridique
10 Gérer pour gagner EN AGRICULTURE – N° 10

communication (téléphonie portable,
internet…) y contribuent.
Les dépenses qui relèvent du plaisir,
des loisirs, de la culture, connaissent
un fort développement. Les dépen-
ses de télécommunications ont aug-
menté de 10 % en un an, les achats
de TV, son, vidéo de 27 %, les dépen-
ses de transport aérien d’un
tiers en trois ans.
Parallèlement, on assiste à
l’émergence rapide d’une
offre de plus en plus allé-
chante de services à la per-
sonne (entretien de la maIson,
dépannage à domicile, service
aux personnes âgées...). Ces
nouveaux secteurs d’activités
adoptent la même stratégie
de facturation, sous forme
d’abonnement, que les
opérateurs de la communi-
cation. De quoi accentuer
encore le poids des dépen-
ses contraintes dans les bud-
gets des ménages.
Les ménages, devant une offre de
consommation de biens et services
aussi étoffée qu’alléchante, vont sans
doute chercher à faire des économies
sur d’autres postes. L’alimentaire pour-
rait en faire les frais.
L’alimentaire :
bouc émissaire ?
La complexité des modes de factu-
ration dans le domaine des services
brouille les repères sur les prix. Par
contre, sur les produits alimentaires,
peu ou pas transformés, les consom-
mateurs mémorisent plus facilement
les prix et surtout leurs variations. De
sorte que le rayon des fruits et légu-
mes, la boulangerie, le rayon des vian-
des et des poissons servent de bouc
émissaire au dérapage des prix.
Il faut dire que les prix des produits
frais sont sensibles à la saIsonnalité,
aux conditions climatiques ou sanitai-
res et donc, à la régularité de l’offre.
Il semble que cette variabilité soit de
moins en moins comprise par des
consommateurs qui ignorent la réa-
lité les contraintes de production des
denrées alimentaires.
En fait, les études du CREDOC(1) mon-
trent que la baisse de consommation
dans les produits frais est avant tout
liée à un effet générationnel plutôt qu’à
un effet prix. La deuxième raIson tient à
la mauvaise conservation des produits,
en déphasage avec les habitudes de
consommation actuelles où l’on veut
utiliser un produit frais avec la praticité
d’un produit longue conservation. D’où
le succès des aliments élaborés.
Plaisir et loisirs
Malgré la stagnation actuelle du pou-
voir d’achat, les ménages vont sans
doute privilégier davantage encore les
produits synonymes de plaisir, service,
confort, au détriment des produits plus
basiques. Au besoin, ils feront même
jouer la concurrence pour certains pro-
duits, avec des achats premier prix dans
les circuits traditionnels ou des achats
discount sur internet.
Autrement dit, il n’y a pas forcément
un lien direct entre pouvoir d’achat et
consommation. La diminution de l’un
n’entraîne pas une diminution automa-
tique des achats pour l’ensemble des
biens et services. Le regard que chacun
porte sur son pouvoir d’achat est certes
personnel, mais fortement in uencé
par le contexte économique et social
et le niveau de con ance qu’il inspire.
Ce regard influence les ménages et
leurs comportements d’achat, lesquels
changent. Tout le système productif,
les chefs d’entreprise de l’artisanat, du
commerce, des services et de l’agricul-
ture, doivent intégrer de tels change-
ments dans leur stratégie. La promesse
de nouvelles opportunités d’affaires.
(1)CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude
et l’Observation des Conditions de vie.
Économie
ALIMENTAIRE
Un prix peut en
cacher un autre
Nos comportements alimentaires
ont modifié notre pouvoir d’achat.
La généralisation du “produit-service”
est la raison principale de l’augmenta-
tion du prix des produits alimentaires.
Le transfert de légumes préparés à la
maison (entre 1 et 2 € par kilo) vers
des solutions cuisinées en légumes
surgelés peut engendrer des prix au
kilo multipliés par 3 au minimum et
jusqu’à 7 ou 8 fois. En contrepartie,
le consommateur appréciera la faci-
lité d’utilisation de ces aliments prêts
à cuire ou à consommer. On retrouve
ces mêmes effets dans le bricolage où
les produits “tout-en-un” ou “prêts-à-
poser” sont souvent plus onéreux que
les produits basiques à assembler, mais
qui apportent moins de services (plus
complexes, à poser).
LES FRANÇAIS
plus fourmis que cigales
Malgré un taux d’épargne toujours soutenu, la dépense de consommation des
ménages croît à un rythme régulier depuis 2001. Elle contribue pour une bonne
part à la croissance de l’économie française. Celle-ci pourrait être fragilisée en
2008, si les ménages français limitaient leurs dépenses, sauf à américaniser leur
comportement en diminuant leur épargne. Mais la fourmi française n’est pas la
cigale américaine.
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
17
16
15
14
13
12
11
10
9
taux d'épargne en %
pouvoir d'achat du
revenu disponible brut
dépense en volume
taux d'épargne
Source : comptes nationaux Insee.
Et dire
que j’ai mis tout
mon pouvoir d’achat
dans mon niveau de vie !
Et dire que
j’ai mis tout
mon pouvoir d’achat
sur un livret !
N° 10 – Gérer pour gagner EN AGRICULTURE 11
1
/
2
100%