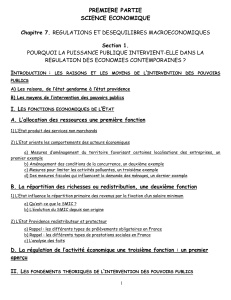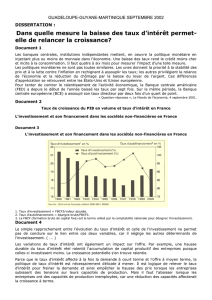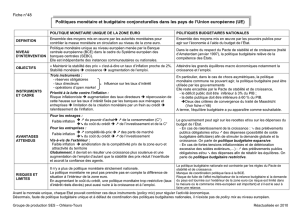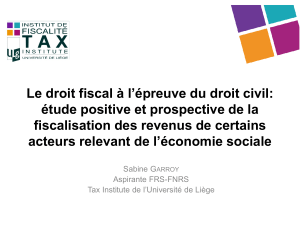Les politiques budgétaires dans une union monétaire hétérogène

Université Lille 1
Les politiques budgétaires
dans une union monétaire hétérogène :
le cas de la zone euro
Florence Huart
Maître de conférences en Sciences Economiques
Document de synthèse en vue de
L’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
Soutenance publique
Le 9 avril 2013
Jury :
Professeur Jean-Baptiste Desquilbet, Université Lille 1 (garant)
Professeur Michel Dévoluy, Université de Strasbourg (rapporteur)
Professeur Hubert Jayet, Université Lille 1
Professeur Marc-Alexandre Sénégas, Université Montesquieu-Bordeaux IV (rapporteur)
Professeur Patrick Villieu, Université d’Orléans (rapporteur)

2
Remerciements
J’adresse mes remerciements aux membres du jury. Je leur suis très reconnaissante d’avoir
accepté de participer à cette Habilitation à Diriger des Recherches.
Je remercie Jean-Baptiste Desquilbet, mon garant, pour la confiance qu’il me témoigne,
pour sa disponibilité et pour ses grandes qualités de direction.
Je remercie Michel Dévoluy, Marc-Alexandre Sénégas et Patrick Villieu, mes rapporteurs,
que je tiens en grande estime pour leurs contributions dans mes domaines de prédilection, la
macroéconomie et l’économie européenne.
Je remercie Hubert Jayet, mon directeur de laboratoire, de sa bienveillance et de la
considération qu’il me témoigne par sa présence dans ce jury.
Je remercie mes co-auteurs, Philippe Rollet, Bas van Aarle, Harry Garretsen, Etienne
Farvaque, Clément Vaneecloo, Olugbenga Onafowara, Oluwole Owoye, Gaël Lagadec. Merci
pour l’inspiration et pour ces échanges intellectuels enrichissants !
Je remercie Marianne Verdier, professeur à l’Université Lille 1, qui a eu la bonté de
commenter une première version de ce document. Ses remarques – et celles de Jean-Baptiste
– m’ont aidée à rendre ma synthèse beaucoup moins imparfaite !
Je remercie Faridah Djellal, professeur à l’Université Lille 1 et doyen de la Faculté des
Sciences Economiques et Sociales, pour ses encouragements et sa franchise.
Je veux aussi témoigner de ma gratitude envers Philippe Rollet, président de l’Université
Lille 1. Je n’aurais pas fait ce parcours sans ses conseils.
Enfin, je remercie mes proches spécialement d’être une source d’énergie, de bonne humeur
et de réflexion !

3
Table des matières
Introduction générale ............................................................................................................. 4
Première partie : Fondements des règles budgétaires dans une union monétaire ........... 9
1.Pourquoi existe-t-il des règles budgétaires, qui limitent l’ampleur des déficits et
dettes publics dans la zone euro ? ......................................................................................... 9
2.Quels sont les types de règles budgétaires, qui sont compatibles avec la discipline et
la flexibilité ? ......................................................................................................................... 13
Deuxième partie : Règles budgétaires et stabilisateurs automatiques dans une union
monétaire ............................................................................................................................... 22
1.Application empirique d’une règle d’équilibre budgétaire étant donné la taille des
stabilisateurs automatiques ................................................................................................. 22
2.Enseignements de modèles théoriques sur le rôle des stabilisateurs automatiques
dans une union monétaire avec une règle de solde budgétaire structurel équilibré ...... 25
Troisième partie : Règles budgétaires et politiques budgétaires discrétionnaires dans la
zone euro ............................................................................................................................... 32
1.La méthodologie ............................................................................................................ 32
2.Les résultats ................................................................................................................... 33
Conclusion générale ............................................................................................................. 37
Bibliographie ......................................................................................................................... 40
Liste des publications ........................................................................................................... 43
Documents ............................................................................................................................. 46

4
Introduction générale
Mes travaux de recherche se situent dans le champ de la macroéconomie internationale. Ils
portent sur le rôle des politiques macroéconomiques – monétaire et budgétaire – dans
l’ajustement à des chocs économiques dans des pays, qui font partie d’une union monétaire.
L’analyse s’applique à l’expérience des pays de la zone euro. La spécificité de mes travaux
est de prendre en considération l’hétérogénéité de ces pays. En effet, il y a des différences
nationales en ce qui concerne les comportements, les structures, et les préférences
économiques.1 J’étudie les conséquences de cette hétérogénéité sur le fonctionnement de
l’union monétaire (interaction entre la politique monétaire unique et les politiques budgétaires
nationales) et sur les performances économiques des pays (risque d’évolutions divergentes).
Ce qui m’intéresse particulièrement est l’étude des politiques budgétaires et des ajustements
en économie ouverte.
Le thème principal de mes travaux est lié à la problématique de la littérature des zones
monétaires optimales : comment des pays, qui participent à une union monétaire, peuvent-ils
amortir les effets de chocs spécifiques, sans recourir à l’instrument du taux de change ou à
une politique monétaire autonome ? Une partie de la littérature traite des mécanismes
d’ajustement disponibles, tels que la flexibilité des prix et des salaires ou, à défaut, la mobilité
du travail (Mundell, 1961), l’intégration financière (Ingram, 1969), l’intégration budgétaire
(Kenen, 1969) ou les politiques budgétaires nationales (Bovenberg, Kremer et Masson, 1991).
C’est ce dernier aspect que j’étudie.
Sur le plan de la méthodologie, j’ai analysé les politiques macroéconomiques dans une
union monétaire, en développant des modèles, qui s’inscrivent dans deux champs théoriques
différents de la macroéconomie : la nouvelle économie classique et la nouvelle économie
keynésienne. Le point commun entre les deux champs est l’hypothèse d’anticipations
rationnelles des agents économiques. La différence essentielle est l’ajustement des prix et des
salaires, et par conséquent, les effets des politiques économiques lorsqu’elles sont anticipées
par les agents économiques (Fischer, 1977).
J’ai d’abord utilisé la littérature sur l’incohérence temporelle de la politique monétaire
optimale de la nouvelle économie classique (Kydland et Prescott, 1977 ; Barro et Gordon,
1983) pour étudier les conséquences d’un défaut de coordination des politiques
macroéconomiques dans une union monétaire dans laquelle les pays ne partagent pas les
mêmes préférences économiques. Avec un collègue néerlandais, Bas van Aarle (actuellement
enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Louvain en Belgique), nous avons étendu
le modèle en économie fermée d’Alesina et Tabellini (1987) au cas d’une union monétaire à
deux pays. Ce modèle repose sur l’étude d’équilibres en théorie des jeux dans une approche
statique comparative. Son principal attrait est d’introduire la politique budgétaire dans
l’analyse. En outre, il aboutit à un résultat intéressant : une politique monétaire crédible
n’apporte pas nécessairement des gains en termes de stabilité des prix, si les objectifs de la
banque centrale et du gouvernement sont différents et si les politiques monétaire et budgétaire
1 Les disparités se rapportent, entre autres, au fonctionnement des marchés (le cadre réglementaire et l’adaptation
à la concurrence, la détermination des prix et des salaires), aux comportements économiques (travail,
consommation, investissement, épargne, endettement), aux structures de production et aux caractéristiques de la
spécialisation internationale, aux canaux de transmission de la politique monétaire, et aux préférences de
politique économique (reflétées notamment dans les choix gouvernementaux en matière de fiscalité et de
dépenses publiques, de priorité à la stabilité des prix ou au soutien de l’emploi).

5
ne sont pas coordonnées. Van Hoose (1992) a adapté ce modèle au cas d’une zone de taux de
change fixes à deux pays. L’originalité de notre approche a été d’appliquer le modèle au cas
d’une union monétaire, de lever l’hypothèse de pays identiques, et d’analyser les implications
de la mise en place d’une autorité budgétaire fédérale. Nous avons retrouvé le résultat
d’Alesina et Tabellini (1987), mais dans notre modèle, il dépend des différences de
préférences nationales (cf. première partie de ce document de synthèse). De plus, nous avons
pu montrer la difficulté de mettre en place un impôt fédéral étant donné les différences
nationales dans les niveaux désirés de dépenses publiques. Ce travail a fait l’objet d’une
publication dans la revue américaine Journal of Economics and Business (1999) [document n°
1].
Une façon de coordonner les politiques macroéconomiques est de les soumettre à des
règles. J’ai alors étudié les implications des règles de politique économique en termes
d’ajustement aux chocs. Avec Bas van Aarle et un collègue néerlandais, Harry Garretsen
(aujourd’hui professeur à l’Université de Groningen aux Pays-Bas), nous avons construit un
modèle, qui fait partie d’une littérature relativement récente : il s’agit des modèles nouveaux-
keynésiens dynamiques stochastiques (Clarida, Gali et Gertler, 1999). Ces modèles
enrichissent l’explication des mécanismes économiques, parce qu’ils prennent en
considération les choix inter-temporels des agents économiques, ils intègrent les fondements
microéconomiques des rigidités nominales, ils rendent la politique économique endogène et
ils permettent d’analyser les effets au cours du temps de différents types de chocs. Le modèle
de base est un modèle en économie fermée, qui repose sur trois équations : une nouvelle
courbe IS intertemporelle pour décrire la demande globale de biens, une nouvelle courbe de
Phillips keynésienne pour l’offre globale de biens, et une règle de Taylor (1993) pour la
politique monétaire. Dans ce modèle, les comportements d’anticipations des agents
économiques sont complètement tournés vers l’avenir. Le problème est qu’avec cette
hypothèse, le modèle ne permet pas de reproduire la persistance que l’on observe dans les
séries de PIB et d’inflation. C’est pourquoi, des modèles hybrides ont été développés (dans le
cadre d’une économie fermée) : ils combinent des comportements tournés vers l’avenir et des
comportements tournés vers le passé (Leeper et Zha, 2001 ; Leith et Malley, 2002).
La spécificité de notre approche tient à plusieurs éléments. Nous proposons un modèle
hybride en économie ouverte, dans lequel deux pays font partie d’une union monétaire, qui est
soit fermée vis-à-vis du reste du monde (version du modèle à deux pays), soit ouverte (version
à trois pays). C’est aussi un modèle où les pays ne sont pas identiques (les paramètres des
fonctions de comportement peuvent différer). Enfin, c’est un modèle dans lequel nous
introduisons les politiques budgétaires des pays, que nous spécifions sous la forme d’une
règle de conduite. En calibrant et simulant le modèle, nous avons pu étudier dans quelle
mesure la politique monétaire unique et les politiques budgétaires nationales permettent
d’amortir l’impact des chocs et déterminer comment elles réduisent ou aggravent les
divergences économiques entre pays de l’union monétaire (cf. deuxième partie). Notre modèle
à deux pays a donné lieu à deux publications : un article dans German Economic Review
(2004) et un article dans Economie et Prévision (2006) dans lequel nous insistons plus sur les
politiques budgétaires [document n° 3]. Quant à notre modèle à trois pays, il a fait l’objet
d’une publication dans la revue Applied Economics Quarterly (2004) [document n° 4].
La fonction de stabilisation de la politique budgétaire découle de mesures discrétionnaires
prises par le gouvernement ou des stabilisateurs automatiques budgétaires. En ce qui concerne
les stabilisateurs automatiques, il y a deux effets, qui sont étudiés dans la littérature (van den
Noord, 2000). Le premier effet est l’impact de la conjoncture sur le solde budgétaire des
administrations publiques. Par exemple, un choc de demande défavorable se traduit par une
baisse de la croissance du PIB, laquelle cause une baisse des recettes fiscales et une hausse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
1
/
141
100%