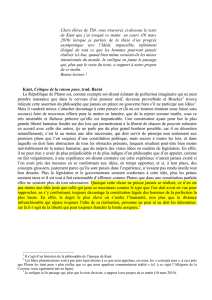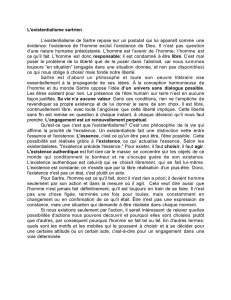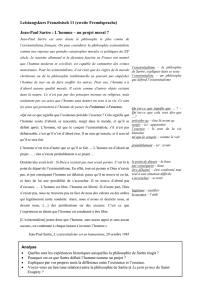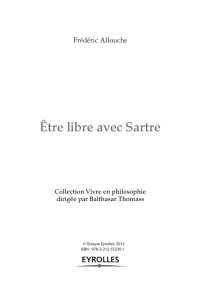Untitled - Luisenschule Kassel


Charles Pépin
Les Philosophes sur le divan
Flammarion

Charles Pépin
Les Philosophes sur le divan
Flammarion
© Flammarion, 2008
Dépôt légal : octobre 2008
ISBN numérique : 9782081238435
N° d'édition numérique : N.01ELKN000126.N001
Le livre a été imprimé sous les références :
ISBN : 978-2-0812-0556-7
N° d'édition : L.01ELKN000140.N001
Ouvrage composé et converti par PCA (44400 Rezé)

Présentation de l'éditeur :
Quand Platon, Kant et Sartre, immortels, s'allongent sur le divan de Freud, les questions les plus essentielles de la philosophie surgissent sous un jour inédit. En
choisissant d'incarner les philosophes, Charles Pépin nous entraîne dans un passionnant voyage, ludique et romanesque, au cœur de l'histoire de la pensée
occidentale. Où les idées des philosophes sont abordées à partir de leur vécu et de leurs émotions. Où les systèmes philosophiques apparaissent comme
indissociables des obsessions de leurs auteurs : l'idéalisme pour Platon, le devoir pour Kant, le regard des autres chez Sartre. Des questionnements qui
ressemblent aux nôtres, tant ils dessinent en creux le portrait de l'homme occidental.
Studio de
création
Flammarion
Conception
graphique :
Atelier
Didier
Thimonier
©
Flammarion

Pour Victoria, Marcel et Georgia
Pour Clarisse, et grâce à elle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%