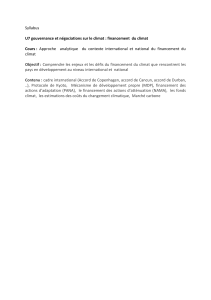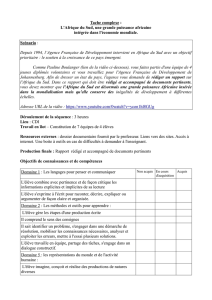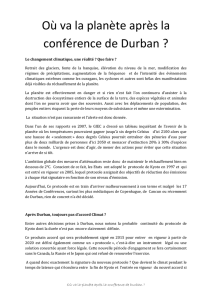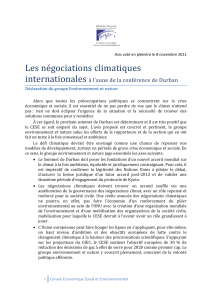Position de thèse sous format Pdf - Université Paris

Rapporteurs:
UNIVERSITE PARIS IV-SORBONNE
Ecole doctorale IV - Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés.
Thèse,
pour l’obtention du diplôme de Docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne,
Discipline: Etudes Anglophones.
présentée et soutenue publiquement
Guillaume Plougoulm
Citoyenneté et espace :
développement, urbanisme, et culture
politique dans la métropole de Durban
(1996-2006).
JURY:
le 12 juin 2008 par
Christian Huetz de Lamps : Professeur, Géographie, Université Paris-IV Sorbonne.
Directeur de thèse: Professeur Jean-Claude Redonnet.
Thierry Leterre : Professeur, Sciences Politiques, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Jean-Paul Revauger : Professeur, Etudes Anglophones, Université Bordeaux-III Michel de Montaigne.
1

2
Une réussite démocratique fragile :
Avec la tenue d’élections démocratiques inédites en 1994, le long combat anti-
apartheid accouchait d’un dénouement pacifique aussi surprenant qu’espéré. Une
décennie a passée, et cette libération vaut toujours une moralité d’estime à l’Afrique du
Sud. Il faut dire que, depuis, d’incontestables réussites ont visiblement affranchit la
nation des heures les plus sombres de son histoire. La révolution institutionnelle a été
brillamment menée. De fait, la démocratie sud-africaine apparaît tout à fait
performante sur ce plan. Elle dispose notamment d’une Constitution qu’on cite
fréquemment comme l’une des plus avancées au monde. D’inspiration
marshallienne
,
cette dernière garantit aux citoyens un large éventail de droits (politiques, civiques,
sociaux). Au-delà de ce bilan formel globalement positif, c’est aussi la manière qui
suscite l’enthousiasme. La nécessité d’éviter un éclatement imminent ayant dicté la
volonté d’impliquer la population dans son ensemble, c’est d’un véritable « atelier
démocratique » qu’a émergé la « nouvelle » Afrique du Sud. Les fruits de cette
approche novatrice s’exportent d’ailleurs largement. Les réformateurs peuvent en
effet s’enorgueillir du fait que nombre des stratégies utilisées pour susciter le débat de
la transition post-apartheid fassent désormais autorité de par le monde. Qu’on ne s’y
méprenne pas néanmoins. L’ampleur du défi proposé à la jeune démocratie disqualifie
l’optimisme à ce stade. Les attentes sont fortes et les chantiers nombreux.
La lutte qui a traversé le vingtième siècle sud-africain stigmatisait un système
oligarchique qui dénigrait le droit à la représentation politique de 80% de la population.
L’obtention du droit de vote représentait alors le préalable fondamental sans lequel les
aspirations de la majorité ne pouvaient être satisfaites. Il est logique, dès lors, que cet
aspect civique ait longtemps préempté tout autre demande. La conquête du suffrage
universel, en revanche, permit de libérer une deuxième génération de revendications –
d’ordres socioéconomiques notamment. De fait, les attentes de progression sociale de
la population étaient déjà grandes à la libération et sans doute sont-elles allées encore
croissantes depuis. Il faut dire à ce sujet que la transformation, bien que remarquable
sous de nombreux rapports, s’est cantonnée en grande partie au registre d’une
« révolution formelle ». Malgré des efforts indéniables, le pays a jusqu’ici peiné à
donner corps à sa vision en général, et à son volet social en particulier. Dans ce
contexte post-apartheid qui a vu les inégalités socioéconomiques croître au niveau
national, il paraît ainsi raisonnable de postuler la montée d’une certaine frustration
dans les couches populaires.
Dans quelle mesure une telle impatience démocratique saperait-elle les
fondements de la « nation arc-en-ciel » ? L’exemple du voisin zimbabwéen est là pour
rappeler, s’il le fallait, la fragilité d’une construction démocratique. Surtout, certains
éléments poussent à réinterpréter l’enthousiasme initialement manifesté par les sud-
africains à l’égard du projet démocratique. En 2006, le limogeage d’un haut dirigeant
soupçonné de corruption a certes offert des gages de la capacité des institutions à
pérenniser la « bonne gouvernance » nécessaire à l’exercice démocratique… gages
immédiatement invalidés puisque ledit dirigeant a depuis réintégré les plus hautes
sphères du pouvoir politique et semble promis à un bel avenir. Moins que ce retour en
grâce, c’est surtout le mécontentement populaire qu’avait suscité le limogeage qui
peut inquiéter au plus haut point. Cette réaction suggère en effet que l’attachement
des sud-africains à leur démocratie s’est peut être moins structuré autour des
principes que de ses incarnations – ce qui laisserait présager d’une marge de
manœuvre considérable pour les dirigeants. Cette situation n’est évidemment pas
souhaitable dans un cadre démocratique. Elle l’est d’autant moins en réalité que, si l’on

3
en juge par certaines prises de position intempestives,1 certaines de ces incarnations
pourraient bien se faire l’instrument d’une régression populiste si on les laissait faire.
À ce prisme, la lutte civique n’aura que peu perdu de sa pertinence dans l’après-
apartheid. Le front s’est déplacé. Le développement constitue ainsi le véritable moteur
de la construction démocratique post-apartheid. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer
le sort de la majorité. Il s’agit également, ce faisant, de lui donner quelques éléments
qui valideraient son adhésion à la nation arc-en-ciel et à tout ce que cela représente.
En somme, c’est la crédibilité de l’action politique en tant qu’émanation du nouveau
système national qui est en jeu dans ce défi socioéconomique. Or, la concrétisation des
promesses de la révolution est une tâche de longue haleine. Nul n’entend ici nier la
difficulté de cette aventure socioéconomique. Il sera intéressant, en revanche, de
tenter de jauger l’efficacité de cette forme de consolidation démocratique à ce stade.
La ville de Durban, à bien des égards, offre un terrain d’étude privilégié pour
appréhender ainsi le rapport qu’entretiennent les Sud-Africains avec la « nouvelle »
Afrique du Sud telle que définie dans le projet post-apartheid.
Un terrain propice à l’analyse :
Sur un plan symbolique, tout d’abord, il était important d’ancrer une étude citoyenne
dans un milieu urbain. Historiquement en effet, l’appartenance au groupe s’est souvent
jouée dans la ville. Il est significatif de noter à cet égard que l’étymologie lie intimement
la citoyenneté à la cité. Qui s’en étonnerait ? Après tout, il ne faut voir là que
l’expression d’une vérité chronologique. S. Kalberg souligne dans ce registre que : « la
première citoyenneté viable apparaît dans les cités médiévales autonomes… ».2
Historiquement avérée, cette parenté entre ville et appartenance est d’autant plus
significative dans le cas qui nous occupe. Pendant l’apartheid effectivement, les non-
blancs n’étaient pas seulement privés de citoyenneté. Ils étaient surtout exclus de la
ville. On peut dès lors penser que sous l’incidence de ce précédent douloureux, les
représentations de la ville et de la citoyenneté s’entrelacent peut être plus étroitement
encore dans l’Afrique du Sud contemporaine qu’ailleurs… notre intérêt pour la
gestation d’un sentiment d’appartenance à l’endroit d’une ancienne « citadelle
blanche »3 n’en sera que plus légitime. Si l’on quitte maintenant la dimension
symbolique de la ville en général pour aborder plus spécifiquement notre cas
d’espèce, deux arguments seront susceptibles de renforcer ou, du moins, de mettre
en perspective la pertinence d’une analyse sur la citoyenneté à Durban.
Le premier élément découle de la composition raciale de la cité. La métropole
durbanaise se démarque du schéma traditionnel de la ville sud-africaine en la matière.
La plupart des cités mettent en présence une majorité noire et une minorité blanche.
S’ajoute plus rarement une population métisse. En cela, la démographie durbanaise est
inédite. Les origines africaine (68.3%), indo-asiatique (19.9%), européenne (8.98%) et
métisse (2.89%) de sa population confèrent une originalité indéniable à la métropole.4
Elles font surtout de Durban la ville qui couvre le plus complètement la largeur du
spectre démographique de la nation arc-en-ciel et, à ce titre, un espace
particulièrement intéressant pour une analyse localisée des prolongements du projet
post-apartheid.
Le second élément procède de la représentativité socioéconomique de Durban. À
nouveau, ici, on peut dire que le microcosme durbanais synthétise les dynamiques qui
animent le groupe à l’échelle nationale. Ce mimétisme prend souvent la forme de défis.
Durban, principale agglomération du KwaZulu-Natal, constitue notamment une
destination privilégiée des phénomènes migratoires qui nourrissent l’urbanisation

4
rapide du groupe sud-africain. La cité comptait 1.058.000 migrants en 1996, soit
42% de sa population totale.5 Cela suppose une expansion démographique vigoureuse
qu’il faut gérer. Une croissance démographique non jugulée n’aiderait que peu à la
résolution des difficultés socioéconomiques qui affectent typiquement les villes sud-
africaines.6 En l’occurrence, la liste des problèmes auquel est confronté le groupe
durbanais est longue : emploi, santé, sécurité, logement, etc.
Ainsi, on peut d’ores et déjà constater qu’un certain nombre de caractéristiques
intrinsèques font de Durban un terrain propice à l’illustration de la relation des sud-
africains au groupe post-apartheid. À ces causes endogènes s’ajoutent d’autres
éléments, exogènes, liés aux recherches dont Durban a pu faire l’objet jusqu’ici.
Certains aspects de la progression démocratique de Durban sont largement étudiés.
Les domaines de la déségrégation, de la pauvreté, du logement et de l’informalité, pour
ne citer que ceux-la, sont par exemple très documentés. La majorité des travaux
scientifiques relatifs à la métropole omet en revanche de traiter de l’impact de cette
progression démocratique sur le sentiment d’appartenance des individus qu’elle
touche. La tendance et lourde. Elle s’observe d’ailleurs aussi dans le corpus traitant de
l’Afrique du Sud en général. Au total, si ce que l’arc-en-ciel produit pour ses membres
est relativement bien connu aujourd’hui, il semble en revanche que nous en sachions
très peu sur ce que cette production peut susciter en retour d’attachement. Il y a là un
espace que notre recherche se propose d’investir par un diptyque dont nous détaillons
la structure dans ce qui suit.
Une tentative de théorisation de l’appartenance arc-en-ciel.
Outillage conceptuel.
Dans la thèse, nous nous attachons d’abord à traduire la problématique que l’on vient
de poser en concepts opératoires. Cela passe par un préalable théorique qu’on
développe dans un premier volume du travail. Il s’agit à ce stade d’appréhender la
complexité du rapport individu/groupe arc-en-ciel sous un angle causal. Toute la
difficulté réside dans la nécessaire particularisation de la citoyenneté : un véhicule de
l’appartenance portée par définition vers l’universalisme. Notre effort, en l’occurrence,
s’appuie sur un modèle énonciatif. On dégage par ce biais un appareil linguistique
formel qui trame la discussion. Quatre séquences résultent de cette tentative de
théorisation de la situation d’énonciation citoyenne sud-africaine. La première
séquence concerne la langue comme système et ce que ceci nous peut apprendre de
la représentation du groupe. La seconde séquence s’occupe des relations causales
susceptibles de s’organiser autour de l’appropriation de ce système. La troisième
séquence vise les éléments contextuels qui informent la temporalité de l’appartenance
(c'est-à-dire le monde concret dans lequel se joue cette appartenance). Enfin, la
quatrième séquence analysera l’interlocuteur que ceci fait apparaître : les acteurs
susceptible de faire évoluer cette temporalité en fait.
Le groupe comme système : genèse d’une autoreprésentation.
Il convient de souligner en premier lieu le caractère intrinsèquement politique de
l’apartheid. En réalité, la ségrégation était avant tout un projet de gouvernement mis
au service d’une conception fondamentalement déterministe de la nation. Les
idéologues à l’origine du nationalisme afrikaner voyaient en effet dans le groupe

5
national l’expression d’une continuité historique – seule garante de l’épanouissement
de l’individu. Leur projet, dès lors, avait une valeur quasi-métaphysique. Il s’agissait de
promouvoir une logique de filiation censée sauvegarder le groupe – et, on l’aura
compris, avec lui l’individu – de toute dénaturation.
La ségrégation, dans ces conditions, avait une vocation humaniste. Le nationalisme
afrikaner trouvait là le moyen de réaliser son destin supposé : la réalisation du potentiel
de son groupe… mais aussi de celui des autres. Il va sans dire que la nation afrikaner
restait prioritaire néanmoins. La conséquence première de cette évidence est que ce
que l’idéologie présentait comme une campagne d’émancipation relevait en pratique
d’une entreprise ethnocidaire. Les victimes ne pouvaient que résister à l’oppression. Le
conflit, on le sait, dura presque quarante ans. Il faudrait ce que beaucoup continuent à
considérer comme un miracle pour que l’Afrique du Sud puisse finalement en sortir. En
fait de miracle, la transition post-apartheid s’est surtout largement structurée autour
de l’idéal démocratique – opérant une redéfinition radicale du groupe sud-africain.
Or il était impossible de simplement réorienter le système filiatif. La transition sud-
africaine est allée au-delà en déplaçant le centre de gravité du groupe. Le philosophe
politique remarquerait ainsi que, sous l’incidence de cet effort, le rapport entre l’État et
la nation s’est inversé en Afrique du Sud. Précédemment, on était dans ce qu’il
convient d’appeler une typologie romantique où la nation était antérieure à l’État. Toute
l’action publique était mobilisée au bénéfice d’un groupe censé posséder une réalité
propre et qui pouvait tout à fait, à ce titre, survivre à l’État. La libération a rendu ce
romantisme obsolète. Elle a, au contraire, nourri la redéfinition du groupe sud-africain
de références civiques. Ainsi, depuis la révolution constitutionnelle, l’État précède la
nation en Afrique du Sud. C’est dire que le groupe n’existe plus en dehors du politique
qui l’organise. On a quitté la ligne communautaire pour embrasser une ligne sociétale.
En conséquence, la nation arc-en-ciel est un objet éminemment politique qui doit
trouver sa légitimité dans un engagement des individus pour le projet démocratique
qu’il matérialise.
Ce glissement dans la définition du groupe bouleverse totalement les modalités
d’appartenance. On naissait Sud-Africain (ou Zoulou, Sotho, Xhosa, etc.) du temps de
l’apartheid. Depuis la démocratisation il faut théoriquement s’engager à être sud-
africain. Chacun pourra observer que ceci recèle de difficultés supplémentaires. Il est
aisé d’appartenir quand on ne vous demande pour cela qu’une couleur de peau, ou
qu’une compétence linguistique… c’est chose moins aisée (certains diraient moins
« naturelle ») lorsque cela impose de reprendre à son compte le seul véhicule unitaire
qu’aient trouvé les démocrates sud-africains : le respect des particularismes et de la
différence. La prochaine séquence explore justement plus particulièrement ce que la
description de cette « nation de citoyens »7 à la mode sud-africaine qui nous aura
occupé jusqu’à présent ne pouvait qu’effleurer : les relations causales qui s’articulent
autour de l’appartenance arc-en-ciel que ceci suppose.
La mécanique appropriative : l’appartenance arc-en-ciel et ses relations causales.
Dès lors que la relation au groupe doit transiter par l’État, le discours scientifique
s’enferre souvent dans une dichotomie droits/devoirs qui convient mal à la complexité
du cas sud-africain. Actant de cette limitation, l’approche utilisée dans la thèse
s’efforce de déborder l’étroitesse de ce qu’il convient de considérer comme une
logique marshalliene en optant pour un examen qu’on pourrait qualifier de
« culturaliste ». Plutôt que sur la typologie binaire du contrat (adhésion/non adhésion),
on raisonne alors sur une palette d’objets relatifs au groupe – des micro-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%