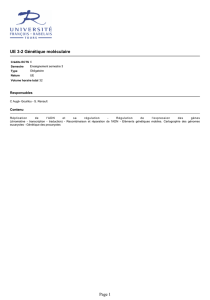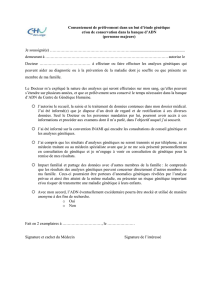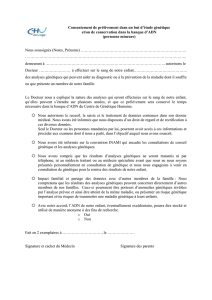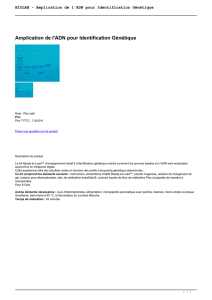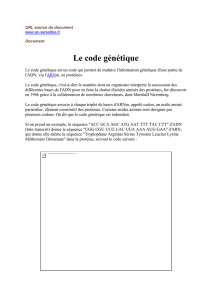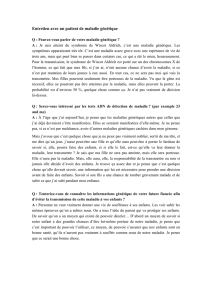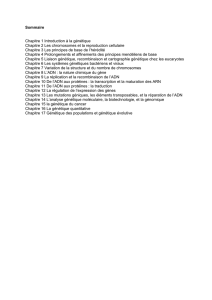Génétique et recherche biomédicale : les difficultés d interprétation

102
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n
os
4-5 - juillet-octobre 2002
ÉDITORIAL
l n’existe pas (ou presque pas !) aujourd’hui d’essai clinique qui
ne comprenne un prélèvement de sang destiné à une extraction
d’ADN en vue d’une recherche génétique. Cette recherche peut
être rapidement effectuée si l’on dispose d’informations sur des muta-
tions du code génétique qui sont déjà connues, ou si des gènes candi-
dats ont été déjà décrits ou envisagés. C’est ainsi que les études de
métabolisme ou d’interactions métaboliques des nouveaux médica-
ments chez l’homme sont communément réalisées en effectuant un
génotypage du CYP 450 qui correspond à la voie métabolique prin-
cipale du ou des médicament(s), afin de voir si des mutations sur un
ou plusieurs nucléotides entraînent une variation du phénotype de
métabolisation. Il existe également des pathologies qui nécessitent le
génotypage de tel ou tel gène candidat dans une population de patients,
afin de savoir si, en comparaison avec des sujets témoins, un facteur
génétique peut être impliqué dans l’incidence de la maladie.
Mais il existe aussi des recherches biomédicales où l’ADN des patients
est systématiquement stocké en vue d’une recherche génétique future
qui ne sera réalisée que lorsque l’évolution des connaissances et/ou
l’optimisation des techniques permettront d’étudier le rôle de facteurs
génétiques, isolés ou combinés à des facteurs environnementaux, dans
la survenue ou l’évolution de la maladie ainsi que dans la réponse des
patients aux traitements.
Pour toutes ces raisons, les banques d’ADN fleurissent en France, cha-
cun se constituant une sorte de “capital scientifique” qu’il compte bien
exploiter un jour en complément de ses observations cliniques. Or
cette situation pose bien évidemment des problèmes éthiques, légaux,
réglementaires. L’article de J.P. Demarez (pages 103-108) fait le point
sur les règles du droit français dans ce domaine et montre qu’il nous
faut apprendre à utiliser à la fois la loi Huriet-Sérusclat sur la protec-
tion des personnes et les lois dites de bioéthique en recherche géné-
tique clinique.
Parmi les problèmes pratiques qui nous semblent les plus fréquem-
ment posés, à nous investigateurs, j’ai sélectionné les questions sui-
vantes, auxquelles J.P. Demarez a accepté de répondre dans un texte
présenté en annexe de l’article et qui est intitulé “Questions de la
Rédaction” (pages 109-110).
!Quelle est l’autorité administrative compétente à laquelle doit être
déclaré tout projet de constitution d’une collection d’échantillons
biologiques ?
La réponse est intéressante puisqu’elle montre qu’en l’absence de
décret d’application de loi 96-452, cette autorité n’existe pas encore,
et qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer les biothèques en France.
"Peut-on envisager d’importer ou d’exporter des produits d’ori-
gine humaine à des fins scientifiques ? En d’autres termes, peut-on
établir des collaborations avec des laboratoires étrangers, afin soit
d’effectuer les recherches génétiques en France sur de l’ADN pro-
venant d’autres pays, soit de faire réaliser à l’étranger des recherches
génétiques sur de l’ADN prélevé en France ?
Cela est possible à condition d’obtenir du ministère chargé de la
Recherche les autorisations prévues par le décret 2000-156, en rem-
plissant le dossier de demande d’autorisation prévu par l’arrêté du
20 avril 2000 (Journal Officiel du 31 mai 2000).
#Quelle est l’information exacte à donner aux patients qui se
prêtent à une recherche biomédicale comportant une recherche
génétique ?
Il faut donner au patient une information “claire, intelligible à la per-
sonne à qui l’on s’adresse, et surtout loyale”. J.P. Demarez précise que
plutôt que d’entrer dans les détails des gènes qui feront l’objet de la
recherche, il est préférable d’expliquer la nature de la recherche, la
pathologie visée ou le facteur de risque considéré, la “possibilité d’avoir
éventuellement plusieurs gènes successifs dans un temps indéterminé
en fonction des progrès de la connaissance”, et d’envisager l’éventuel
“retentissement direct pour la personne ou pour sa famille des résul-
tats de l’évaluation portant sur ses propres matériaux biologiques”.
$Peut-on poursuivre pendant une durée indéterminée des
recherches génétiques sur ces prélèvements d’ADN ? Dans quelles
conditions doit-on redonner au patient une nouvelle information et
obtenir de lui un nouveau consentement ?
En simplifiant, on peut répondre que tant que la recherche est pour-
suivie dans le domaine de la pathologie qui a fait l’objet de l’infor-
mation initiale du patient et de son consentement, il n’y a pas lieu de
le solliciter à nouveau. En revanche, si la recherche génétique s’oriente
dans un tout autre domaine que celui primitivement envisagé, il faut
essayer de retrouver le patient, de lui fournir l’information complé-
mentaire et d’obtenir son consentement pour ces nouvelles recherches.
Cependant, “à l’impossible nul n’étant tenu”, si cette recherche du
patient n’aboutit pas, l’investigation génétique peut se poursuivre.
%Les recherches génétiques ne peuvent-elles être réalisées que sur
des échantillons totalement anonymisés, c’est-à-dire ne permettant
pas de retourner au dossier médical du patient ?
La loi prévoit que les informations directement ou indirectement nomi-
natives ne peuvent être utilisées en recherche biomédicale que si l’on
respecte les dispositions suivantes : l’information des intéressés et leur
consentement, la reconnaissance de leurs droits et la consultation du
Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de
recherche dans le domaine de la santé. Il est donc possible d’effectuer
des recherches sur des prélèvements non anonymisés.
Le droit français en matière de recherche génétique clinique est com-
plexe, car, comme l’écrit J.P. Demarez : “Le fait que les textes qui les
organisent aient été conçus indépendamment les uns des autres conduit
à un manque de cohérence et d’homogénéité”. Le respect simultané
de la loi Huriet-Sérusclat et des lois dites bioéthiques s’impose néan-
moins au médecin. Chaque protocole de recherche pose des problèmes
spécifiques qui doivent être clairement analysés par les investigateurs
avec l’aide des comités ad hoc, voire même de spécialistes juridiques
au fait de ces problèmes. Il faut aussi parfois faire face à des admi-
nistrations qui ont leur propre interprétation des textes de lois, laquelle
peut être erronée.
“Rien n’est simple” et “Tout se complique”, comme disait Sempé ! &
Génétique et recherche biomédicale :
les difficultés d’interprétation du droit français
Genetics and biomedical research : difficulties in understanding the French law
'P. J aillon*
*Service de pharmacologie, CHU Saint-Antoine, 75012 Paris.
I
1
/
1
100%