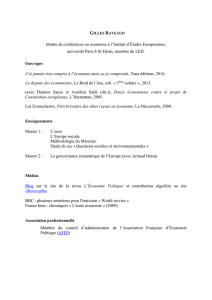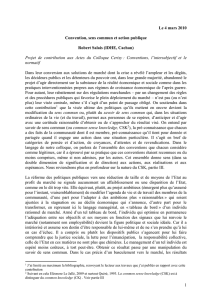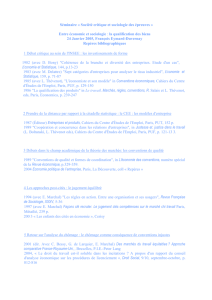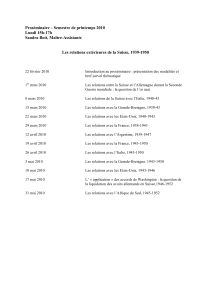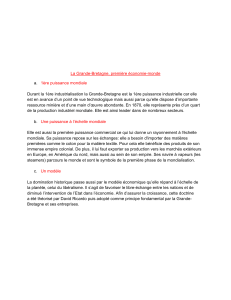Comparer l`incomparable ? Le sens du travail en - chu

Sociologie
du
travail
55
(2013)
152–171
Disponible
en
ligne
sur
www.sciencedirect.com
Comparer
l’incomparable
?
Le
sens
du
travail
en
France,
en
Allemagne
et
en
Grande-Bretagne
dans
l’entre-deux-guerres
Comparing
the
incomparable?
The
meaning
of
work
in
France,
in
Deutschland
and
in
Great-Britain
in
the
interwar
Robert
Salaisa,∗,b
aInstitutions
et
dynamiques
historiques
de
l’économie,
ENS-Cachan,
61,
avenue
du
président
Wilson,
94230
Cachan,
France
bCentre
Marc-Bloch,
Friedrichstrasse
191,
10117
Berlin,
Allemagne
Disponible
sur
Internet
le
27
mai
2013
Résumé
La
méthode
de
l’économie
des
conventions
repose
sur
un
questionnement
objectif
de
la
pragmatique
de
l’action
qui
se
déroule
en
situation.
Elle
cherche
ainsi
à
restituer
les
configurations
de
sens
qui
guident
les
acteurs
grâce,
aussi
bien,
aux
justifications
et
controverses
qu’aux
traces
incorporées
dans
les
objets
sociaux.
À
l’histoire
croisée,
elle
peut
donc
apporter
dans
la
comparaison
une
attention
plus
aiguë
aux
singularités
des
situations,
spécialement
dans
le
cas
de
l’Europe,
aux
singularités
nationales.
L’article
tente
de
le
démontrer
sur
les
configurations
de
sens
attribuées
à
la
relation
de
travail
en
Allemagne,
en
France
et
en
Grande-Bretagne
dans
l’entre-deux-guerres.
En
croisant
différents
domaines
et
sources,
il
suggère
que
ces
configurations
se
nouent,
respectivement,
autour
de
la
liberté
du
contrat,
de
la
liberté
d’association
et
de
la
dépendance
du
serviteur
envers
son
maître.
Pour
arriver
à
ce
résultat,
il
examine
comment
les
conceptualisations
de
la
relation
de
travail
mettent
en
rapport,
de
manière
propre
à
chaque
pays,
travail
et
produit
du
travail.
©
2013
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots
clés
:
Convention
;
Configuration
;
Relations
de
travail
;
Travail
;
Trajectoires
historiques
Abstract
The
economics
of
conventions
method
means
objectively
questioning
the
pragmatics
of
acts
done
in
given
situations.
It
does
so
by
attempting
to
reproduce
the
configurations
of
meaning
that
guided
the
actors,
i.e.
justifications
and
controversies
as
well
as
traces
left
in
social
objects.
A
comparison
can
therefore
contribute
∗Institutions
et
dynamiques
historiques
de
l’économie,
ENS-Cachan,
61,
avenue
du
président
Wilson,
94230
Cachan,
France.
Adresse
e-mail
:
0038-0296/$
–
see
front
matter
©
2013
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2013.03.015

R.
Salais
/
Sociologie
du
travail
55
(2013)
152–171
153
to
the
histoire
croisée
(“entangled
history”)
approach
a
better
understanding
of
the
uniqueness
of
situations,
and,
especially
in
the
case
of
Europe,
of
national
specifics.
We
try
to
demonstrate
this
here
by
studying
the
meanings
attached
to
labor
relations
in
Germany,
France
and
Great-Britain
between
the
two
world
wars.
Correlating
various
domains
and
sources
suggests
that
those
configurations
of
meaning
are
built,
respectively,
around
freedom
of
contract,
freedom
of
association
and
a
servant’s
reliance
on
the
master.
That
result
was
obtained
by
showing
that
the
way
labor
relations
are
conceived
creates
a
relationship
between
labor
and
the
product
that
is
particular
to
each
country.
©
2013
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Keywords:
Convention;
Configuration;
Labor
relations;
Work;
Historical
trajectories
Die
Spur
ist
Erscheinung
einer
Nähe,
so
fern
das
sein
mag,
was
sie
hinterliess
Die
Aura
ist
Erscheinung
einer
Ferne,
so
nah
das
sein
mag,
was
sie
hervorruft1.
W.
Benjamin
Les
soubresauts
actuels
de
la
construction
de
l’Europe
remettent
au
jour
les
idiosyncrasies
des
pays
qui
la
composent,
au
travers
de
leurs
difficultés
à
s’entendre
et
de
la
divergence
de
leurs
chemins.
Si
ces
singularités
prennent
racine
dans
les
trajectoires
sociohistoriques
nationales,
le
travail
n’est
pas
le
moindre
des
domaines
où
celles-ci
s’affirment.
Cet
article
entend
démontrer
que
l’approche
par
les
conventions
est
spécialement
adaptée
à
la
comparaison
et
à
la
mesure
des
singularités
sociohistoriques2,
notamment
dans
le
domaine
du
travail.
Nous
nous
concentrons
ici
sur
la
période
fondatrice
de
l’Europe
d’après-guerre,
c’est-à-dire
sur
l’avant-Seconde
Guerre
mondiale,
et
nous
nous
intéressons
aux
trois
pays
dominants
entre
lesquels
le
futur
de
l’Europe
s’est
très
largement
négocié
:
l’Allemagne,
la
France
et
la
Grande-Bretagne.
1.
Questions
de
méthode
1.1.
Comparer
les
questionnements
Les
recherches
méthodologiques
et
épistémologiques
ont
à
ce
jour
bien
cerné,
comme
le
montre
l’importante
contribution
de
Michael
Werner
et
Bénédicte
Zimmermann
(2004),
la
condition
essentielle
de
possibilité
de
la
comparaison,
celle
d’être
située
et
datée.
Il
faut
entendre
par
là,
d’une
part,
la
définition
d’un
objet,
issu
d’un
questionnement
précis,
d’autre
part,
l’unité
de
temps
et/ou
de
lieu
:
soit,
la
comparaison
de
plusieurs
pays
sur
une
même
période,
soit
de
plusieurs
périodes
pour
un
même
pays.
La
comparaison
opère
à
partir
d’une
coupe,
dans
le
temps
ou
dans
l’espace,
de
processus
sociohistoriques
continus
(c’est-à-dire
qui
n’ont
ni
origine,
ni
1Benjamin
W.
1983,
1987.
Das
Passagen-Werk.
Francfort,
Suhrkamp
Verlag,
p.
560.
2La
rédaction
de
cet
article
a
bénéficié
de
présentations
antérieures
et
de
discussions
lors
du
séminaire
de
méthode
du
Centre
Marc
Bloch
(Berlin,
21
juin
2010),
du
séminaire
du
Laboratoire
institutions
et
dynamiques
historiques
de
l’économie
(Paris,
11
janvier
2011)
et
des
premiers
Entretiens
Institut
d’études
avancées-Bureau
International
du
travail
«
Le
sens
du
travail
»
(Nantes,
31
mars
2011).
Il
s’agit
d’une
version
modifiée,
insistant
sur
la
question
de
la
comparaison,
de
Salais,
2011
«
Labour-Related
Conventions
and
Configurations
of
Meaning:
France,
Germany
and
Great
Britain
Prior
to
the
Second
World
War’
»
paru
en
2011
dans
le
dossier
coordonné
avec
R.
Diaz-Bone
«
Conventions
and
Institutions
from
a
Historical
Perspective
»,
Historical
Social
Review,
36(4).

154
R.
Salais
/
Sociologie
du
travail
55
(2013)
152–171
fin)
et
même
vivants
(dans
la
mesure
où
ils
relèvent
de
l’activité
humaine,
d’anticipations,
de
coordinations
et
de
conflits).
L’enjeu
est
de
comparer
des
dynamiques
singulières,
car
fortement
enracinées
dans
le
temps
et
dans
l’espace,
donc
de
comparer
l’incomparable.
Comme
dans
toute
chirurgie,
la
coupe
ne
doit
pas
tuer
le
patient
;
elle
doit
tenter
de
restituer
au
maximum
l’élan,
la
singularité
et
le
mouvement
du
processus,
sa
pragmatique
en
un
mot.
M.
Werner
et
B.
Zimmermann
ont
lancé
la
problématique
de
l’histoire
croisée
pour,
précisément,
tenter
de
dépasser
ce
qui
leur
paraît
une
limite
insurmontable
de
la
comparaison.
Ils
insistent
à
juste
titre,
pour
éviter
de
généraliser
un
cadre
d’analyse,
ou
de
privilégier
un
point
de
vue
national
(le
plus
souvent
celui
du
chercheur),
sur
la
nécessité
de
situer
les
points
de
vue
et
de
les
croiser,
d’étudier
l’impact
des
réceptions
et
des
influences
croisées,
y
compris
pour
les
réfuter.
Enfin,
ils
soulignent
le
danger
d’un
angle
d’approche
externe
en
surplomb,
qui
porte
toujours
en
lui
un
point
de
vue
normatif
spécifique.
À
la
réflexion,
il
nous
semble
(cela
n’apparaissait
pas
d’entrée
de
jeu)
que
l’économie
des
conventions
(EC)
apporte
à
la
méthode
comparative
la
possibilité
de
restituer
de
manière
objec-
tive
la
pluralité
des
points
de
vue,
du
moins
d’aller
au
plus
loin
qu’il
est
possible
dans
cette
direction.
Un
point
de
vue
se
compose
d’une
part,
d’un
lieu
d’où
l’on
voit
(le
point),
et
d’autre
part,
de
la
vue,
c’est-à-dire
d’une
représentation
spécifique
de
la
réalité
qui
nous
entoure.
Cette
vue
est
conventionnelle
au
sens
où
elle
est
formée
à
partir
des
conventions
que
l’acteur
sélec-
tionne
en
fonction
de
l’action
qu’il
entreprend.
C’est,
si
l’on
préfère,
un
questionnement
que
l’acteur
pose
sur
la
réalité
qui
l’entoure,
dont
il
attend
en
réponse
la
découverte
de
la
bonne
manière
d’agir
(bonne,
au
sens
où
cette
action
est
assurée
au
maximum
de
sa
réussite,
où
c’est
une
action
qui
convient).
Cela
n’a
rien
d’un
truisme,
car
à
partir
d’un
même
point
et
s’agissant
de
la
même
réalité
environnante,
une
pluralité
de
conventions
existe
pour
former
ces
attentes
sur
la
bonne
manière
d’agir.
David
Lewis
(1969),
un
des
inspirateurs
de
la
position
méthodologique
de
l’EC
le
souligne
dans
ses
exemples
(celui
de
la
conduite
automobile
notamment)
:
ce
n’est
qu’en
se
mettant
dans
la
position
du
conducteur
et,
en
quelque
sorte,
en
agissant
avec
lui
en
situation,
que
l’on
peut
découvrir
les
conventions
auxquelles
les
conducteurs
ont
recours
pour
former
leurs
attentes
mutuelles
et
se
coordonner.
Depuis
ce
lieu,
l’on
verra
le
système
de
conven-
tions
que
l’acteur
utilise
et,
en
faisant
de
même
avec
d’autres
lieux,
d’autres
temps
et
d’autres
acteurs
engagés
dans
un
cours
d’action
identique,
on
aura
accès
à
la
pluralité
des
conventions,
autrement
dit
des
vues
et
des
conceptions
propres
à
une
même
situation
et
à
un
même
problème
d’action.
On
le
sait
en
outre,
dans
une
approche
pragmatique
de
l’action
(Dodier,
1993),
la
situation
ne
se
limite
pas
aux
attentes
réciproques
;
elle
est
aussi
une
configuration
où
se
trouvent
et
agissent
d’autres
acteurs
et
des
objets.
Par
exemple,
il
y
a
des
signaux
divers
le
long
de
la
route
et
ce
que
fait
le
conducteur
d’en
face
compte
également.
L’enjeu
de
l’action
est
de
réussir
à
se
coordonner
avec,
comme
le
dit
Nicolas
Dodier
(1995),
«
toutes
ces
instances
».
Tout
système
de
conventions
s’étend
donc
à
la
qualification
des
objets
qui
entourent
l’acteur
;
il
est
important
pour
celui-ci
de
découvrir
les
appuis
que
ces
objets
lui
apportent
ou
l’orientation
qu’ils
suggèrent
quant
à
l’action
adaptée
à
entreprendre.
N.
Dodier
l’a
très
bien
montré
lorsqu’il
analyse
la
coordination
le
long
d’une
chaîne
de
montage.
Donc
que
comparer
dans
cet
article
?
Tout
simplement
les
conventions
ou,
si
l’on
préfère,
les
catégories
de
pensée
et
d’action
par
lesquelles
chaque
communauté
saisit
son
monde
du
travail.
La
contrainte
ainsi
posée
à
l’observateur
est
qu’il
puisse
disposer
d’un
questionnement
et
d’une
méthode
qui
lui
permettent
de
se
mettre
en
pensée
et
en
acte
dans
chacune
des
configurations
nationales,
et
d’en
dégager
chacune
des
conceptions
de
l’activité
de
travail,
pour
en
tracer
ensuite
la
comparaison.
Nous
allons
utiliser
une
formalisation
partant
de
l’activité
de
travail
comme

R.
Salais
/
Sociologie
du
travail
55
(2013)
152–171
155
réalisation3.
Elle
distingue
trois
moments
dans
l’activité
de
travail
:
l’engagement,
la
coordination
productive,
l’épreuve
de
réalité
du
produit
;
trois
moments
qui
sont
liés
de
manière
dynamique
au
sein
du
processus
de
réalisation.
On
verra
qu’elle
s’avère
discriminante,
les
conceptions
du
travail
se
focalisant
dans
chacun
des
trois
pays
étudiés
sur
un
moment
particulier
et
une
articulation
spécifique.
1.2.
Trace
et
configuration
de
sens
Se
pose
alors
la
question
du
matériau
empirique
sur
lequel
travailler
pour
«
extraire
»
les
conventions
à
l’œuvre
dans
chacune
des
configurations
nationales.
Pour
répondre
à
cette
question,
nous
utiliserons
ici
les
deux
concepts
de
trace
et
de
configuration
de
sens.
Le
paradoxe
méthodologique
est
que
les
conventions,
du
fait
même
d’être
inséparables
des
actions
qui
les
actualisent
en
situation,
ne
sont
pas
accessibles
à
l’observation,
sauf
circonstances
spéciales.
La
méthode
la
plus
évidente
a
priori
est
l’enquête
participante
:
le
chercheur
conduit
la
voiture
en
même
temps
que
l’observé.
C’est
impossible
dans
une
approche
historique
qui
porte,
par
nature,
sur
des
faits
passés.
Il
reste
deux
autres
voies
:
l’observation
des
situations
de
crise
qui
obligent
les
acteurs
à
produire
des
justifications,
autrement
dit
l’analyse
des
controverses
;
et
la
recherche
des
indices
laissés
par
les
conventions
au
sein
des
artefacts
que
leur
mobilisation
a
permis
d’élaborer,
autrement
dit
des
traces.
Nous
privilégions
dans
ce
qui
suit
la
recherche
des
traces
laissées
au
sein
des
artefacts
relatifs
au
travail.
La
liste
est
a
priori
longue
des
artefacts
sociaux
présents
:
les
écrits
théoriques
portant
sur
l’économie
et
la
société
;
la
statistique
;
le
droit
du
travail
et,
plus
largement
si
possible,
le
droit
économique
;
les
systèmes
de
négociation
collective
;
les
institutions
relatives
au
social
;
l’organisation
du
travail,
de
la
production
et
du
marché
;
les
standards
de
qualité
du
travail
et
des
produits,
voire
les
objets
techniques
(dont
la
forme
matérielle
incorpore
des
attentes
sur
la
fac¸on
dont
ils
doivent
être
utilisés
de
manière
efficace,
autrement
dit
exhibe
en
creux
un
modèle
cognitif
du
«
bon
»
travail).
Cette
méthode
se
combine
aisément
avec
l’analyse
des
controverses.
Le
droit,
spécialement
la
jurisprudence,
est
un
espace
de
controverses,
de
même
les
conflits
du
travail
ou
les
débats
théoriques.
Ce
que
nous
cherchons,
ce
sont,
en
reprenant
à
Norbert
Elias
le
concept
de
configuration,
les
«
configurations
de
sens
»
que
génèrent
les
conventions,
une
fois
celles-ci
installées
dans
le
jeu
social
national.
Ce
type
de
configuration
ne
détermine
pas
des
jeux
de
position
structu-
relle
d’acteurs
dans
un
champ.
Il
s’inscrit
et
se
distribue
dans
les
choses
et
les
institutions
et
constitue
un
répertoire
commun
accessible
à
chaque
acteur,
qui
y
puise
pour
donner
un
sens
pratique
aux
évènements
en
cours,
à
la
situation
et
aux
actions
des
autres,
dans
l’instant
et
le
lieu.
Ce
«
sens
»
a
une
double
dimension
;
il
est
à
la
fois
signification
(de
la
situation)
et
direc-
tion
(de
l’action
à
entreprendre).
Une
configuration
de
sens
a
ainsi
un
caractère
pragmatique.
Elle
permet
à
chacun
de
comprendre
et
d’agir,
donc
d’anticiper.
C’est
un
savoir
commun
que,
sans
y
penser
rationnellement
à
l’avance,
chacun
présuppose
connu
des
autres.
Une
configura-
tion
de
sens
permet
tout
à
la
fois
de
se
mettre
d’accord,
mais
aussi
de
débattre,
de
s’opposer,
y
compris
violemment,
à
partir
d’un
arrière-fond
(background)
partagé.
Chacun
peut
vérifier
que
cela
marche,
par
exemple
que
l’autre
agit
selon
ce
que
l’on
avait
anticipé
ou
du
moins
en
fournit
les
signes
attendus
—
en
régime
courant,
il
est
difficile
de
différencier
l’action
du
signe
3Nous
avons
élaboré
cette
formalisation
dans
Salais
(1989),
et
l’avons
explicitée
dans
Salais
et
Storper
(1993),
Storper
et
Salais,
1997,
puis
dans
Salais
(1998).

156
R.
Salais
/
Sociologie
du
travail
55
(2013)
152–171
–
et
cette
possibilité
est
pour
beaucoup
dans
la
stabilité
du
jeu.
Potentiellement
du
moins,
ce
jeu
laisse
ouvert
des
espaces
d’interprétation
et
d’innovation
(propres
à
la
liberté
humaine),
qui
peuvent
conduire
à
certains
moments
les
trajectoires
à
s’infléchir,
à
s’enrichir
ou
à
changer
de
cap.
Dans
cette
perspective,
et
de
par
la
répétition
du
même
problème,
les
artefacts
sociaux
qui
configurent
ces
situations
d’action
se
composent
de
la
sédimentation
des
systèmes
de
conventions
mobilisés.
Ils
se
constituent
ainsi
en
traces
qu’un
œil
exercé
(c’est-à-dire
muni
d’un
question-
nement
adapté)
repère
dans
le
paysage
qui
se
construit
autour
de
lui,
au
fur
et
à
mesure
qu’il
observe
et
recueille
les
faits.
Si
au
fil
des
regards
que
nous
portons
dans
notre
promenade,
les
traces
convergent,
nous
tenons
là
quelque
chose
de
la
nature
d’une
preuve
d’une
configuration
de
sens.
Ainsi
sera
notre
méthode,
qui
emprunte
donc
au
Walter
Benjamin
des
Passages
de
Paris.
Il
y
définit
ainsi
la
trace
:
«
Die
Spur
ist
Erscheinung
einer
Nähe,
so
fern
das
sein
mag,
was
sie
hinterliess
»
(«
La
trace
est
l’apparition
d’une
proximité,
quelque
lointain
que
puisse
être
ce
qui
l’a
laissée
»
qui
contraste
avec
l’aura
:
«
Die
Aura
ist
Erscheinung
einer
Ferne,
so
nah
das
sein
mag,
was
sie
hervorruft
»
(«
L’aura
est
l’apparition
d’un
lointain,
quelque
proche
que
puisse
être
ce
qui
l’évoque
»)4.
Tout
artefact
social
conjugue
ainsi,
dans
sa
forme
et
sa
consis-
tance,
le
proche
et
le
lointain.
Sa
matière
est
donc
historique
de
bout
en
bout
et,
de
ce
fait
accessible.
Cette
méthode
nous
prémunit,
semble-t-il,
contre
un
danger
de
la
méthode
de
l’histoire
croisée,
celui
de
se
focaliser
davantage
sur
des
problématiques
d’influence
et
de
réception
croisées,
au
risque
d’alimenter
à
son
insu
une
problématique
de
convergence
des
dynamiques
nationales
vers
un
modèle
commun,
donc
une
uniformisation
(dont
on
constate
dans
la
crise
européenne
actuelle
qu’elle
relève
plus
du
dogme
que
de
la
réalité).
Le
centrage
de
la
comparaison
sur
les
question-
nements
à
l’œuvre
dans
les
pragmatiques
nationales
d’action
et
de
réalisation
renforce
au
sein
de
l’histoire
croisée
la
vision
plus
juste
et
plus
réaliste
des
croisements
comme
confrontation
de
jugements
critiques
et
comme
réélaboration
autonome
à
partir
de
son
propre
point
de
vue.
Nous
en
verrons
dans
ce
qui
suit
plusieurs
illustrations.
Par
exemple,
les
industriels
du
tissage
des
pays
considérés
connaissaient
les
modes
de
calcul
des
rémunérations
employés
par
leurs
concurrents,
ce
qui
ne
les
empêchaient
pas
de
juger
que
leurs
conventions
en
la
matière
étaient
meilleures
que
les
leurs.
Tout
au
plus
pouvaient-ils
être
conduits
à
affiner
leurs
argumentaires
justificatifs
ou
à
intégrer
ici
ou
là
quelques
ajustements
incrémentaux.
De
même,
partir
des
singularités
rend
beau-
coup
plus
exigeante
la
caractérisation
d’une
inflexion
ou
d’un
changement
d’une
configuration
de
sens.
Il
est
clair
que
bien
des
questions
demeurent
:
•
celle
de
la
dynamique
intrapériode
ou,
pour
le
dire
différemment,
celle
des
découpages
tem-
porels
pertinents
pour
isoler
des
périodes
suffisamment
homogènes
;
•
celle
de
la
montée
en
généralité
vers
des
catégories
nationales.
Il
y
avait
dans
l’entre-deux-
guerres
(et
comme
il
y
a
toujours
aujourd’hui)
une
pluralité
des
conventions
du
travail
selon
les
types
de
produits,
de
secteurs,
de
territoires,
ce
qui
pose
la
question
de
la
montée
en
généralité.
Les
processus
de
montée
en
généralité
furent
dans
la
période,
spécifiques
à
chaque
pays
et
durent
beaucoup
au
type
d’État
et
de
politiques
publiques.
4Benjamin
W.
1983,
op.
cit.
[1]
(traduction
de
l’auteur).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%