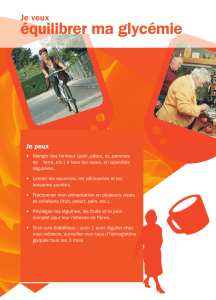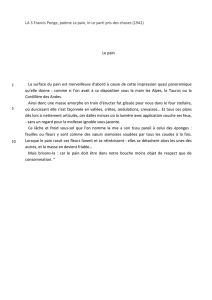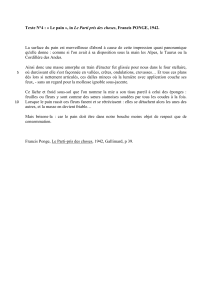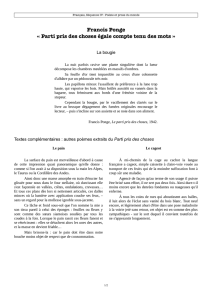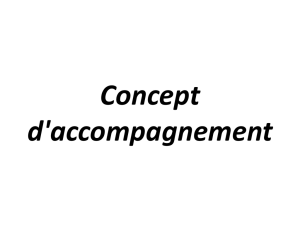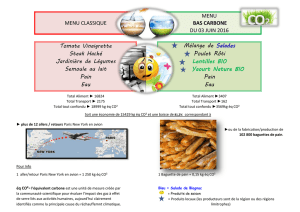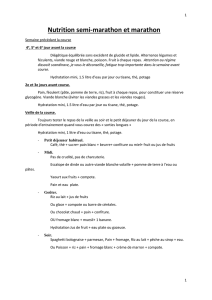Analyse Littéraire de « Le Pain » de Francis Ponge

« Le pain » , Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
-I-TRANFORMATION (TRANSFIGURATION) POETIQUE D’UN OBJET BANAL
Le pain : objet quotidien ( « donnez-nous notre pain quotidien ») mais qui a une dimension noble dans
l’imaginaire ( eucharistie +pain nourricier).
A. Description ordonnée et précise de l’objet. Suit l’ordre d’une démarche « savante » :
mouvement du texte va de l’extérieur ( 1er §) à l’intérieur : on passe de la surface du pain, au premier
alinéa, à « la masse amorphe » ( 2ème et 3ème §), et une fois à l’intérieur de cette masse, on passe du
macrocosme ( 2ème § ) au microcosme ( 3ème §) : souligner cette progression du texte , de § en §, puis
souligner que le texte explicite ce mouvement : l’adjectif « panoramique » implique un regard (
celui du lecteur/poète/consommateur de pain) englobant, les termes « tissus », « fleurs » et « feuilles »
impliquent un regard rapproché. Le texte se termine par l’ingestion du pain » : « pain » dans notre
bouche, objet de parole (poème) et de consommation.
-B-Passage du banal au poétique
dès le titre : un thème est indiqué par le titre, énoncé à nouveau ( confirmé) à la première ligne, puis
délaissé et textuellement transformé par :
-lexique
-images
-métaphores et comparaisons
ce lexique emprunte à la nature au sens large : géographie (1er §), géologie (2ème §), biologie et
botanique (3ème §) [citer le texte]
on soulignera le caractère commun de ce registre et son inadéquation par rapport au thème ( nature,
pour un objet artisanal et présenté aussi comme tel) .
on soulignera également l’amplitude, voire la variété de ce champ lexical :cette variété et ce champ
lexical donnent au pain son caractère grandiose : insolite, car le pain est un objet domestique ( petit) et
non cosmique ( immense)
effet de surprise le lecteur est appelé à voir différemment l’objet. Il est important de bien mettre
en évidence ici que le mot « panoramique » et le thème du regard, placent la transformation de l’objet
davantage dans la façon de voir du lecteur que dans une quelconque transformation « magique »
objective du pain.
mouvement inscrit dans le texte poétiquement à travers deux images :

« comme si l’on avait sous la main » ( petit) « Les Alpes » etc.( grand, immensité) :
disproportion de l’image, inadéquation. La locution « comme si » ne transforme pas l’objet, il
ne s’agit d’une métaphore ni d’une comparaison, mais d’un complément de manière. C’est
donc bien le regard et non la chose qui est concerné ici par le processus de transfiguration.
« four stellaire » : oxymore ( analogue de la disproportion, cf ci-dessus)
« surface » , terme « impropre », est un terme marqué qui contient une idée de vastitude, de
même « masse », également terme marqué ( pas seulement idée objective du volume et de son
poids, mais comme « surface » connotation superlative hyperbole.
Il y a une véritable gradation dans la succession de ces métaphores ; voir succession des
chaînes de montagne citées : sur le plan sonore ==> accroissement des volumes.
Transformation progressive de l’objet par une sorte de mimésis ( imitation) :la succession au
2ème § des « sommets et des creux » (citer le texte) reproduit la ligne de la chaîne montagneuse
et son ondulation ( citer le texte), qui met en mouvement, sous nos yeux, cette ligne.
B. Enchaînement des images et des métaphores
-démultiplication du singulier au pluriel : de la « surface » à la triple énumération des chaînes
montagneuses/ de la masse aux « crevasses », crêtes et ondulation au PLURIEL.
-des « sœurs siamoises » ( chiffre 2) au complément de manière « tous les coudes à la fois », qui
multiplie au-delà de « deux » les paires de siamoises, hyperbolique.
-souligner emploi des pluriels sans déterminant dans §4 qui a valeur superlative du pluriel (
« fleurs et feuilles »)
-enchaînement dans §3 de métaphores , chaîne dans laquelle le comparant du comparé précédent
devient comparé suivi d’un nouveau comparant etc. ( « mie »==> « éponge »==> « sœurs
siamoises » ) . Souligner le caractère hétéroclite des comparaisons==>l’objet « pain » est bien
transformé en objet poétique, une suite verbale de métaphores et de comparaisons où se perd le
référent ( le « pain) ».
-en filigrane : le mythe. La masse qui éructe « anime » (au sens propre, « donne du souffle, de la
vie, de l’anima) à la masse==> géant, cyclope, Vulcain ?
-II-MISE EN ABYME DU PROCESSUS DE CREATION POETIQUE
-A-Double opposition froid/chaud, mou /dur, -/+ ==> travail du potier, figure archétypale du
« créateur ».
« croûte » du pain dite « merveilleuse , à opposer à « lâche et froid sous-sol » , « mollesse
ignoble » : le « mou » revêt une connotation négative sur le plan moral (« lâche », « ignoble » et
esthétique .

Le passage du mou au dur est celui du passage par le feu « créateur » : l’image du « four stellaire »
et son artisan rendu absent par la forme passive du verbe « glisser « ( sans complément d’agent)
alignent ou superposent l’image du boulanger, du potier ( qui « façonne »),de l’ artisan, de
l’artiste ( « façonner » , c’est opposer la « forme » à l’absence de forme ( littéralement « a-
morphe ») et de dieu –démiurge : artisan au ciel avec les étoiles. Dieu créateur est dit
« plasmateur », transformant la terre, semi liquide, molle, en homme Adam ( Adam ;
étymologiquement : terre/glaise/boue) .
Passage du « mou » au « dur » : «amorphe »signifie à la fois « sans forme » et « mou »=/=
« dalles » ( minéral) « soudées » ( de solidus, solide).
Passage du sans forme au géométrique : « dalle ». Vocabulaire de l’architecture. L’adjectif
« articulé », comme le groupe complément de manière « avec application » suggèrent le
raffinement du geste artistique, l’artifice, le dessein (sic) de même que l’adverbe « nettement »
qui indique non la précision du travail mais celle de l’observateur pour qui le pain est objet du
regard-esthète. Passage du chaos (amorphe) au cosmos (=harmonieux, construit).
Vocabulaire du peintre (impressionniste) :« la lumière couche ses feux »
L’image des « sœurs siamoises » évoque un univers de prodiges, de monstruosités ( ce qui doit
être montré), de « merveilles » (1§), ce qui est digne d’être admiré ( mirarer==>
admirabilis==>merveilles). Objet du spectacle, de l’esthétique.
Assonances et allitérations ( « masse amorphe »/ « fleurs et feuilles »/ « friables »==> pain objet
sonore, c-à-d poétique.
-B-Le poème dans son propre déroulement donne à voir la fabrication puis la « fin » du
« pain »
Nous assistons en direct à la fabrication du pain. Dans le deuxième §, les actions sont données en
cours de réalisation (la masse amorphe est « en train d’éructer », aspect non sécant de la périphrase
« en train de+infinitif=action en cours de développement). 2§, l’ondulation citée est reproduite par
le mouvement du texte qui va de sommets en creux.
Du pain comme masse froide encore à cuire au pain « rassis » : vie et mort du pain au long des §
successifs.
Ainsi à la fin du § 3 le pain, friable, s’émiette sous la forme de trois petits points …de suspension.
Le pain comme le texte s’effrite. L’objet-texte prend fin.
Cette analogie qui débouche sur une opposition est contenue dans le double sens de « brisons-là »
et « dans notre bouche » : expression « briser-là » qui signifie « mettre fin à un discours ou un
dialogue » et… « rompre le pain »syllepse. La « bouche » est explicitement celle qui énonce le
poème ( « objet de respect », et qui « mange » la pain (« objet de consommation ») : à rapprocher
du « larynx » qui dans « L’Orange » énonce et avale le fruit.
Le thème de l’offrande du pain ( l’impression panoramique que la surface du pain « donne »/ « fut
glissé pour nous »/ « dans notre bouche » est présent tout au long du texte : voir sacrifice de
l’orange, eucharistie (pain et vin), plaisir du lecteur consommateur qui savoure l’objet poétique au
prix d’une destruction de l’objet réel ??? ( voir Le Portrait ovale).Ici, Ponge avec humour semble

plutôt vouloir restituer le pain réel plutôt que le pain « poétique » comme l’indique la fin du
poème.
1
/
4
100%
![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)