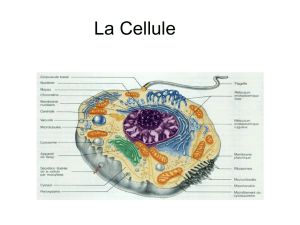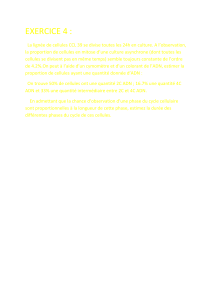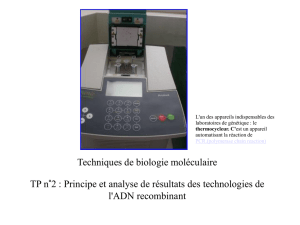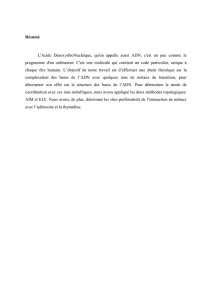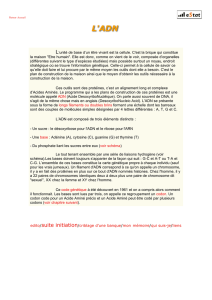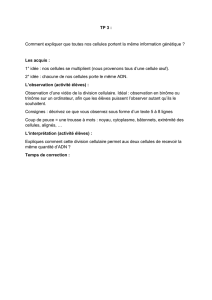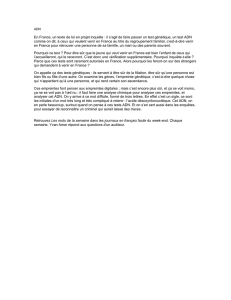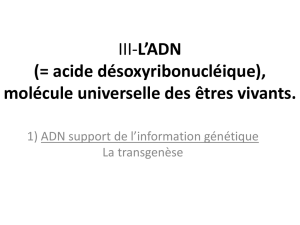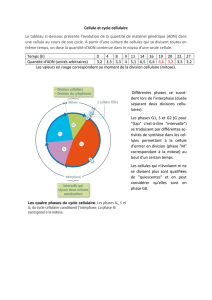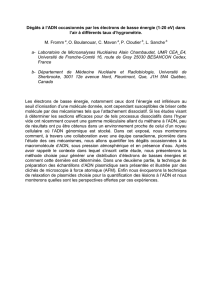Web 12 Fiche 12

1
Web 12 Fiche 12.1
CONJUGAISON INTER-SPÉCIFIQUE
L. PAOLOZZI
La capacité de conjugaison a été recherchée chez peu d’organismes. Cependant la vaste
diffusion des plasmides chez les procaryotes et la conservation des protéines impliquées dans
leur transfert suggèrent que ce mode de transfert d'ADN serait une fonction générale des
cellules procaryotes. Les possibilités d'échanges génétiques par conjugaison interspécifique sont
particulièrement intéressantes. D’une façon générale, la première phase des échanges génétiques
entre deux organismes peut être limitée par des barrières comme l’incompatibilité de surface des
deux cellules. Une fois celles-ci franchies, des barrières internes à la cellule réceptrice peuvent
intervenir, telles l'impossibilité de recombinaison et l'activité de systèmes de restriction (Chap.
12). En laboratoire, une conjugaison interspécifique a été mise en évidence entre Salmonella
typhimurium et E. coli, et entre E. coli et de nombreuses autres bactéries (Cyanobactéries,
Spirochètes, nombreuses Bactéries Gram+, Helicobacter pilori et Campylobacter). Une
conjugaison a aussi été observée entre E. coli et des cellules d'eucaryotes (Saccharomyces,
cellules Hela, et cellules ovariennes CHO K1 de cochon d’Inde). D’autres évidences de
conjugaison ont été enregistrées entre Agrobacterium tumefaciens (via son plasmide Ti) et
Saccharomyces cerevisiae. Plus récemment, G. Schroder et collaborateurs (2011) ont observé
un transfert d'ADN plasmidique de la bactérie pathogène Bartonella henselae à des cellules
endothéliales humaines en culture. Le système de sécrétion VirB/VirD4 de type IV de cette
bactérie est normalement utilisé pour transloquer de nombreux effecteurs qui permettent
d’établir une infection chronique chez les cellules hôtes. Le transfert de l’ADN par ce système
de translocation n’a pas de rôle dans la pathogenèse et serait un vestige d'un système de
conjugaison.
L’efficacité de ces échanges interspécifiques est très basse. Ainsi, la transmission d'un
marqueur génétique par conjugaison entre un Hfr de Salmonella et une F- d'E. coli est environ
105 fois plus basse que dans le croisement homospécifique E. coli x E. coli. Ces deux
organismes n'ont pourtant qu'environ 20 % de divergences de leurs séquences chromosomiques.

2
L’inactivation d’une des fonctions du système mut, qui contrôle la fidélité des appariements
entre filaments d’ADN homologues (Chap. 9 ; 11), conduit à augmenter cette fréquence d’au
moins 103 fois.
Ces observations soulèvent la question de l'existence de conjugaison inter-espèces en milieu
naturel. Seul est connu à cet égard le transfert du plasmide Ti entre Agrobacterium et différentes
plantes. Cependant deux conditions importantes incitent à considérer comme probable cette
capacité de transfert inter-espèces : le fait que le transfert conjugatif d’ADN procaryote à
d’autres espèces est rendu possible en laboratoire grâce à l'a-spécificité du transférosome ; et le
fait que les souches déficientes pour le système mut sont très fréquentes naturellement.
En ce qui concerne les Archaea, la conjugaison chez ces organismes a été observée entre
certains membres de ce domaine tels l’Archée halophile Halobacterium volcanii, et entre
souches isogéniques de l’hyper-thermophile Sulfolobus acidocaldarius. L'existence d'échanges
génétiques entre Bacteria et Archaea a été suggérée par comparaison des séquences nucléiques
entre organismes de ces deux domaines. Mais ce n’est que récemment que cette conjugaison
interdomaine a été obtenue dans les conditions de laboratoire. Des échanges ont en effet été
observés entre E. coli et l’Archée Methanococcus maripaludis pour cellule receveuse, avec une
fréquence de l’ordre 2 x 10-6. Le transfert du plasmide RP4 d’E. coli à Methanococcus exige un
contact entre les deux organismes et les fonctions plasmidiques oriT et tra. Le transfert est
insensible à la DNAse I. L'ensemble de ces caractéristiques sont classiques d'un processus de
conjugaison.
Bibliographie
Schroder G., Schuelein R., Quebatte M., Dehio C. 2011. Conjugative DNA Transfer into
Human Cells by the VirB/VirD4 type IV Secretion System of the Bacterial Pathogen Bartonella
henselae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108. 35 : 14643-14648

3
Web 12 Fiche 12.2
TRANSFERTS GÉNÉTIQUES HORIZONTAUX
EN CONDITIONS NATURELLES
L. PAOLOZZI
La notion de flux génétique entre micro-organismes vivant dans les conditions naturelles a été
initialement abordée en considérant la diffusion des plasmides auto-transmissibles et
mobilisables chez les Bactéries isolées dans différents environnements. La présence dans toutes
les niches écologiques d’ADN libre et d'un grand nombre de phages rend possible l'existence de
processus de transformation et de transduction. D’autre part, la possibilité d’échanges
génétiques inter-espèces par conjugaison réalisée en laboratoire (Web 12 Fiche 12.1) a
fortement alimenté l’idée de la présence de TGH dans la nature. Les preuves expérimentales
solides soutenant cette hypothèse ont été pendant longtemps très pauvres. Toutefois, depuis plus
d’une vingtaine d’années, l’intérêt pour une série de problématiques liées à la biosécurité et au
contrôle de la diffusion des déterminants responsables de la résistance aux antibiotiques a joué
un rôle déterminant dans la recherche de TGH dans la nature. De nombreuses expériences ont
été construites dans le but de déceler du transfert génétique horizontal au sein de populations
bactériennes dans leur environnement naturel, et d’en évaluer l’incidence. Du point de vue
méthodologique, ces études utilisent les connaissances sur le TGH établies dans les conditions
de laboratoire pour les transférer à l’étude expérimentale d’écosystèmes modèles. Ces études
peuvent se baser sur des expériences conduites au niveau de microcosmes ou dans des systèmes
in situ, reconstituant l’habitat naturel. Les résultats obtenus ont confirmé que des transferts par
conjugaison, transformation et transduction se produisent dans les milieux naturels. L'efficacité
des différents types de transfert dans les conditions environnementales diffère fortement de
celles observées en laboratoire.

4
LES MÉTHODOLOGIES D’ÉTUDES
Les microcosmes sont des micro-environnements constitués d'échantillons de terre ou d’eau
provenant d'habitats variés ; les échantillons de terre sont prélevés soit dans des sols, cultivés ou
non, soit dans la rhizosphère, soit dans des boues activées ; les échantillons d’eau, douce ou
salée, peuvent provenir de fleuves, lacs, mer mais aussi des égouts. Ces microcosmes sont
utilisés en laboratoire soit sous forme de milieux stérilisés, auxquels on inocule ensuite la ou les
souches de micro-organismes à étudier, soit tels quels, c’est-à-dire non stériles, pour l'étude de
leur population. Dans ce dernier cas, chaque cellule de l’inoculum participe à un réseau
complexe d’interactions avec le microbiote de l’échantillon, reproduisant, totalement ou
presque, les conditions originales. Les microcosmes sont certes plus complexes en composition
chimique et en structure que les milieux de culture utilisés en laboratoire. Mais ils ne
parviennent cependant pas à mimer totalement la complexité de l’environnement, en raison de
ses fluctuations, difficiles à reconstituer, et de l’action (synergique) des différents paramètres.
Ils sont toutefois utiles pour comprendre les facteurs naturels qui limitent ou favorisent les
échanges génétiques, et l’étendue de ces échanges. Contrairement aux systèmes naturels, ils
permettent de faire varier un seul paramètre, chimique ou physique, à la fois (température, pH,
oxygénation, lumière, facteurs nutritionnels ajoutés, etc.) pour en mesure l'impact.
Une condition plus proche des conditions naturelles est celle des systèmes dits in situ, qui
consistent à inoculer dans un microcosme artificiel établi en laboratoire les organismes à
étudier, puis à les réintroduire dans l’habitat de provenance. Pour ces études in situ, ont été
développés un certain nombre d’appareils (connus sous les appellations de Membrane-Filter
Chambers, Membrane Diffusion Chambers, Environmental Test Chambers). Il s’agit de
conteneurs stérilisables (les chambres) d’une dizaine de cm de longueur, dans lesquels on
introduit l’échantillon d'organismes (par exemple Bactéries donatrices et/ou réceptrices pour la
conjugaison ou la transformation) ou de cellules hôtes et de leurs phages (pour la transduction).
Les ouvertures de la chambre sont contrôlées par des filtres de porosité appropriée empêchant le
passage des micro-organismes tout en permettant les échanges chimiques entre l’intérieur et
l’extérieur. L'appareil est immergé dans le site à étudier (lac, fleuve, mer, etc.), où il est exposé
aux conditions physico-chimiques (luminosité, température, pH, composition chimique,
présence d’agents toxiques, etc.) de ce site, et à leurs fluctuations. Des prélèvements peuvent
être réalisés grâce à des dispositifs d’accès à l’intérieur de la chambre.
RECHERCHE DE PROCESSUS DE CONJUGAISON
Des processus de conjugaison ont été identifiés dans plusieurs conditions environnementales.
Leur efficacité dépend des caractéristiques propres à la machinerie de transfert d’ADN ainsi que
de l'état physiologique des cellules. Ces deux éléments peuvent être influencés par de nombreux
facteurs biotiques et abiotiques de l’environnement, qui interviennent aussi bien au niveau des
possibilités de contact des cellules conjugantes que sur leur physiologie.

5
État physiologique et disponibilité en nutriments
Un facteur important de l’environnement agissant sur le transfert conjugatif est la disponibilité
en nutriments. Le taux de transfert d’ADN plasmidique chez différentes souches de
Pseudomonas est influencé positivement par le taux de croissance de la cellule donatrice, alors
qu’il semble indépendant de celui de la cellule réceptrice. De même, chez E. coli, la capacité du
donneur à transférer peut être inhibée par une carence préalable au croisement, et chez Vibrio,
aucune activité de croisement n’est détectée quand les cellules, donatrices ou réceptrices, ont
subi une carence avant leur mise en contact.
Généralement, le transfert d’ADN par conjugaison exige l’expression de gènes tra, laquelle
est finement régulée (Chap. 12). Pour certains plasmides, cette expression peut être induite par
des facteurs de l’environnement. C’est le cas, par exemple, du plasmide Ti d’A. tumefaciens,
dont les gènes tra sont contrôlés par la densité en cellules porteuses du plasmide (selon un
mécanisme de quorum sensing, Chap. 14), et induits par des substances émises par la plante.
Paramètres biotiques influant sur l'efficacité de conjugaison
De nombreuses études ont mis en évidence que le transfert conjugatif au sein d'une espèce est
influencé négativement par la présence dans l’environnement, d'autres communautés
bactériennes indigènes. Lorsque les Bactéries sujets d'étude sont inoculées dans un microcosme,
leurs interactions avec les autres micro-organismes peuvent conduire à des compétitions, à des
formes variées d’antagonismes, ou au parasitisme. Elles peuvent aussi être victimes de la
prédation par d’autres organismes. Dans ces conditions, la diminution de l’activité métabolique
et de la capacité de survie de l’inoculum peut influencer négativement la réussite du transfert
conjugatif, jusqu’à l’annuler complètement. C'est la raison pour laquelle certaines espèces ne
montrent aucune trace de transfert dans des échantillons in situ, alors qu'elles sont très efficaces
après inoculation dans le même échantillon préalablement stérilisé.
Ainsi le transfert de plasmides de souches de Pseudomonas aeruginosa dans une eau de lac
est inexistant en présence de la communauté indigène, et efficace dans cette même eau après sa
stérilisation. La stérilisation pourrait avoir un double effet : d’une part éliminer les compétitions,
mais aussi enrichir le milieu en rendant disponibles les nutriments libérés par les organismes
morts.
La présence d’une rhizosphère peut jouer un rôle positif important dans le transfert
conjugatif. Cet effet a été expliqué par le fait que les racines exsudent des produits tels
qu’amino-acides et sucres, qui sont utilisables par les autres micro-organismes. Des nutriments
peuvent aussi provenir de la mort et de l’autolyse des cellules racinaires. La surface des racines
peut, pour ces raisons, constituer un micro-habitat qui aide à maintenir proches les cellules
candidates au transfert, tendant à favoriser la formation de micro-colonies qui pourraient
faciliter le contact entre cellules, et donc la conjugaison. Dans ce sens, il a été observé chez les
Pseudomonades que les transferts étaient fortement compromis, jusqu'à la limite du détectable,
dans des sols non plantés. Le transfert du plasmide RP4 de Pseudomonas spp., ainsi que la
survie du donneur et du receveur, diminuent significativement avec l’augmentation de la
distance séparant ces bactéries de la surface des racines de plants de blé.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%