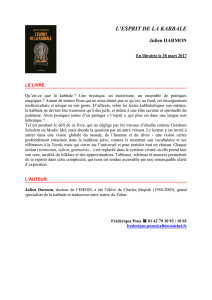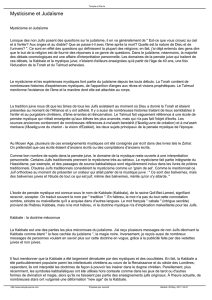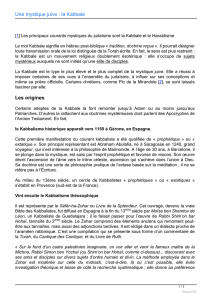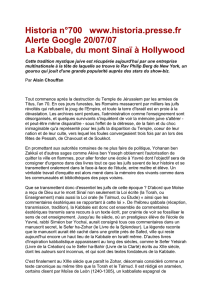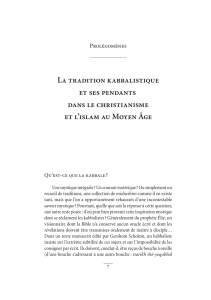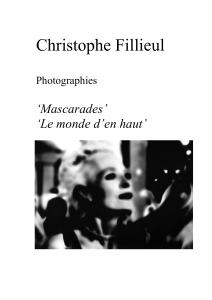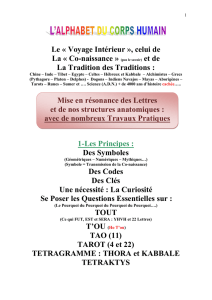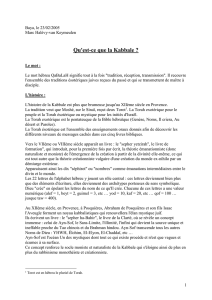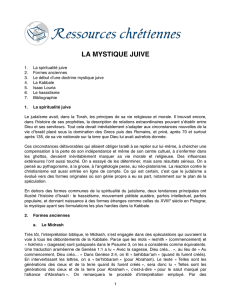Le Kabbalah Centre : entre tradition et New Age En février et mars

Le Kabbalah Centre : entre tradition et New Age
En février et mars derniers, plusieurs membres de la famille Berg, leaders
spirituels du Kabbalah Centre, rendaient visite au jeune Kabbalah Centre de
Moscou et à sa « communauté kabbalistique », qui existe depuis un peu plus
d’un an. L’occasion pour les dirigeants du KC d’inaugurer de nouveaux
bâtiments en plein centre de Moscou et de constater l’expansion du
mouvement en Russie. « Nouveau mouvement religieux » pour les uns,
« secte » pour les autres, le Kabbalah centre jouit d’une importante visibilité
dans le paysage de la spiritualité contemporaine. Si le mouvement, fondé dans
les années 1960 aux Etats-Unis par Philip Berg, trouve son origine dans le
judaïsme, il a su, par une constante réélaboration de son discours, atteindre un
public bien plus large, au-delà de l’appartenance religieuse.
Le Kabbalah Centre se présente comme une association dont le but est de rendre la
kabbale accessible, compréhensible et utilisable dans la vie quotidienne. Dans son
chef, la kabbale est définie comme une sagesse ancienne qui fournit des instruments
pratiques pour atteindre le bonheur et un épanouissement durables. Si l’on ne peut
manquer de discerner là un vocabulaire teinté de New Age, historiquement, les
choses s’avèrent plus complexes. L’association tire son nom du terme hébreu
kabbalah qui, dans l’histoire du judaïsme, désigne l’ensemble des textes et des
pratiques qui constituent l’ésotérisme juif. Traditionnellement, ces textes se
présentent sous la forme de commentaires des Ecritures et s’adressent à des juifs
religieux, rompus à l’étude du corpus traditionnel et de son commentaire, observant
l’ensemble des commandements de la loi juive.
Dans ses divers outils de communication, particulièrement bien affûtés, on lit que le
Kabbalah Centre se réclame de Yehudah Ashlag, rabbin et kabbaliste polonais, issu
d’une famille hassidique. Ashlag est célèbre pour avoir initié une vaste entreprise de
diffusion de la kabbale, à travers la publication de commentaires et de traductions de
textes classiques de la kabbale en hébreu moderne. Contrairement à ce que mettra
plus tard en place le Kabbalah Centre, l’œuvre d’Ashlag s’adressait avant tout à des
Juifs, idéalement à des Juifs pieux, pratiquants. Dans les années 1960, alors que le
mouvement prend son essor sous l’égide de Philip Berg, le public visé est élargi non
seulement aux Juifs non pratiquants, mais aussi aux non Juifs. C’est là le versant
plus universaliste du Kabbalah Centre, ce qui en fait un « Nouveau Mouvement
religieux » qui confine au New Age.
Ainsi, dans la première introduction à l’édition bilingue du Zohar hébreu/anglais,
Philip Berg réfute l’idée – « populaire » selon lui – que le peuple juif aurait été élu à
l’exclusion des autres. La révélation s’adresse à tous. Dès lors, si la référence à ce
qui constitue le judaïsme est bien présente (son corpus littéraire, ses membres
fondateurs, sa tradition), l’ensemble des termes sont investis de significations
nouvelles, plus fédératrices. Ainsi le terme « juif » en vient à désigner toute personne
qui se comporte d’une manière généreuse, tolérante et sensible, qui agit de manière
divine, avec compassion envers toutes les créatures de Dieu. Les événements de
l’histoire biblique sont réinterprétés en termes de « Lumière », d’épanchement plus
ou moins important de celle-ci, voire de son retrait. Le vocabulaire religieux
traditionnellement lié à la kabbale est évacué au profit d’une théorie au service du
bien-être de l’individu et, par extension, de la société.

Comme l’a montré Jody Myers (Kabbalah and the Spiritual Quest. The kabbalah
Centre in America, 2007), les adhérents au KC se répartissent schématiquement en
trois cercles concentriques. Le cercle le plus extérieur rassemble des personnes en
quête spirituelle qui adoptent une sorte de philosophie kabbalistique. Pour elles, la
kabbale est un mode d’explication du monde et de son fonctionnement et de la place
qu’y occupe l’homme. Ces membres du KC viennent d’horizons religieux divers et
n’ont pas de part active dans le Centre. Le deuxième cercle compte des personnes
qui intègrent plus profondément les doctrines du KC et pratiquent un certain nombre
de rituels (comme la méditation sur les lettres hébraïques, le fait de boire de l’eau
« kabbalistique » ou de porter un bracelet rouge). Enfin, dans le cercle intérieur, on
trouve des personnes pratiquant tous les rituels mis en place par le KC, y compris de
nombreuses mitsvot (commandements de la loi juive) et les fêtes religieuses juives.
D’après Myers, ce sont principalement des personnes d’origine juive, majoritairement
des Israéliens, qui pratiquent une « drôle de forme de judaïsme ».
Historiquement, la séparation de la kabbale d’avec l’ensemble du judaïsme
traditionnel date de la Renaissance. Parallèlement à une kabbale qui demeure dans
le sein de l’orthodoxie juive naît une nouvelle forme de kabbale, sous l’égide de
penseurs chrétiens. Cette « kabbale chrétienne » devient, comme le montre Joseph
Dan dans son Kabbalah, une composante à part entière de la culture spirituelle et
philosophique européenne. Depuis la Renaissance jusqu’à l’occultisme du 19e siècle,
la kabbale côtoie une série d’autres courants qualifiés d’ésotériques tels que
l’astrologie, l’hermétisme ou l’alchimie. La prouesse du Kabbalah Centre est, à mon
sens, de se situer au croisement de deux traditions. D’une part, la tradition juive, en
se réclamant de la pensée et du travail du rabbin Yehuda Ashlag et en faisant
référence à l’histoire biblique et, d’autre part, la kabbale de type New Age, dans ce
qu’elle a de plus universaliste.
Les rencontres qui se sont déroulées à Moscou en février et mars derniers
fournissent un bon exemple de cette maîtrise de la communication dont font preuve
les dirigeants du KC. Monica Berg, un des piliers de la communication du Kabbalah
Centre, a prononcé une conférence sur la question des problèmes relationnels,
proposant au public des outils pratiques pour les surmonter. Par ailleurs, des lectures
collectives du Zohar ont eu lieu qui ont rassemblé quelques 250 personnes. Enfin,
Michael Berg a dirigé, face à l’ensemble de la communauté de Moscou, la lecture de
la section hebdomadaire de la Torah, pratique commune à l’ensemble des
communautés juives.
Entre tradition religieuse et universalisme New Age, le Kabbalah Centre a, depuis sa
fondation, toujours su naviguer entre les besoins spirituels divers exprimés par la
société occidentale. Une manière aussi de conserver un public tenté par les
nouvelles spiritualités d’origine orientale qui, elles aussi, fleurissent sur le marché du
spirituel. Il s’agit ici de mouvements que l’historien des religions aura à cœur de
suivre, pour prendre le pouls de notre société.
1
/
2
100%