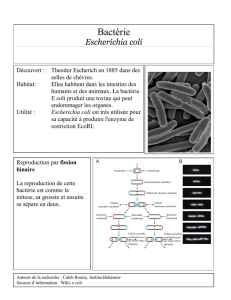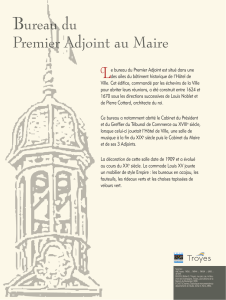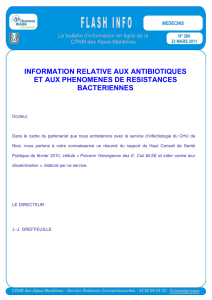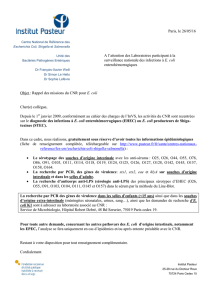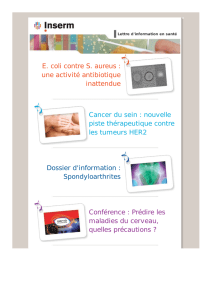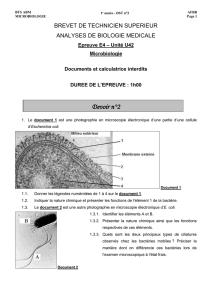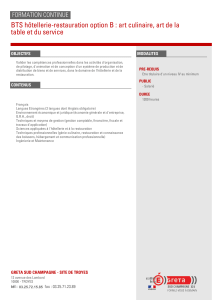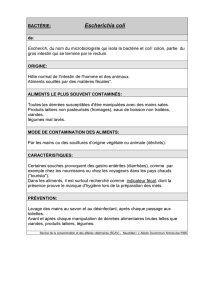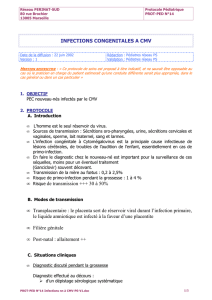DYNAPRESS 2013-2014 pour site internet

Epidémiologie des infections urinaires communautaires dans l’Aube en 2013
L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) représente de loin le premier examen microbiologique prescrit. Près de 30%
des urocultures sont positives selon les critères du référentiel de microbiologie (REMIC) 2010 ce qui en fait un examen à fort
potentiel diagnostique.
Du 15 mai au 30 octobre 2013, nous avons isolé 3612 microorganismes des urines de patients ambulatoires c’est-à-dire non
hospitalisés dans un établissement de santé privé ou publique ou résidents dans un EHPAD.
La répartition observée des microorganismes est proche de celle retrouvée dans les études en France ou à l’étranger avec une
prévalence de 68% d’E.coli, de 14% des autres entérobactéries et de 3% de S. saprophyticus (fig.1). La prévalence urinaire du
Streptocoque B (3,5%) est proche des données de l’ONERBA (Observatoire national de l’épidémiologie de la résistance
bactérienne) (3). Cette répartition des microorganismes reste la même au fil des années au contraire de la résistance aux
antibiotiques qui évolue rapidement ces dernières années.
La dernière enquête Transville de 2012 organisée par l’ONERBA sur la résistance en ville de 16328 souches d’E. coli isolées des
urines (2) montre que la résistance d’E. coli dans l’Aube est comparable aux données nationales (fig. 2 et 3). Au niveau national,
près de 5% des souches d’E. coli sont résistantes aux céphalosporines de 3
ème
génération (3,6% dans l’Aube) et 3,8% des souches
d’E.coli isolées sont productrices de BLSE (2,7% dans l’Aube). Cette proportion est en constante augmentation depuis 2003 où
moins de 1% des souches d’E. coli étaient productrices de BLSE (1). Ces souches productrices de BLSE sont souvent résistantes
aux quinolones. Ainsi dans l'Aube, la résistance aux fluoroquinolones semble se stabiliser aux alentours de 10% mais reste
légèrement plus élevée que la moyenne de l’étude ONERBA. La sensibilité aux furanes et à la fosfomycine qui reste supérieure à
98% doit continuer d'interpeller les prescripteurs sur l'efficacité de ces deux molécules.
Tous germes confondus (entérobactéries, staphylocoques, entérocoques, streptocoques,...) isolés des urines, la résistance à la
fosfomycine est de 9,3%, aux furanes de 8,3%, au cotrimoxazole de 24,7% et à l’ofloxacine de 19,8%. La proportion de bactéries
multiréristantes retrouvées dans les urines est de 2,93% dont 93% d’entérobactéries productrices de BLSE, 6% de S. aureus
résistant à la méticilline (SARM) et 1% d’entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC).
Selon l’ONERBA et la SPILF (société de pathologie infectieuse de langue française), les recommandations concernant le
traitement de première intention des infections urinaires ne sont aujourd’hui pas remises en question, mais seront à reconsidérer
en fonction de l’évolution du taux d’E. coli BLSE identifiés au sein des infections à E. coli observées dans la communauté.
Concernant les infections urinaires, il convient, autant que faire se peut, de privilégier le recours à des antibiothérapies
documentées et de limiter le recours aux antibiothérapies probabilistes ; ainsi, en ce qui concerne la prise en charge de cystites
compliquées, mais en l’absence de tout signe de gravité, il peut être envisagé de retarder la mise en route de l’antibiothérapie pour
pouvoir disposer préalablement d’un antibiogramme.
Concernant les pyélonéphrites et les prostatites, le traitement probabiliste de référence est aujourd’hui une C3G (parentérale) ou
une fluoroquinolone (per os ou parentérale uniquement chez l’adulte). Les recommandations prévoient l'ajout d'un aminoside pour
les formes les plus sévères d'infections urinaires communautaires (sepsis grave, pyélonéphrites sur obstacle, nouveau-nés et
nourrissons de moins de 3 mois…) ; cet ajout sécurise en partie le risque d'échec en cas d’E. coli BLSE, les souches françaises
restant sensibles aux aminosides dans environ 50 % des cas.
Références : (1) De Mouy D, Janvier F, Mérens A, Arzouni J-P, Bouilloux J-P, Dinnat-Courtiols N, Dubouix-Bourandy A, Fabre R, Gontier P, Grillet N, Noël C,
Payro G, Pfeffer J ,Thierry J. Sensibilité d'Escherichia coli aux quinolones et aux céphalosporines de troisième génération dans les infections urinaires
communautaires : étude AFORCOPI-BIO 2011, RICAI 2012 ; (2)
Caillon J, Gueudet T, Mérens A, enquête transville 2012, RICAI 2013 ; (3)Diagnostic et
antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires chez l’adulte ; AFSSAPS 2008
SOMMAIRE du DYNAPRESS hiver 2013 :
• Epidémiologie des infections urinaires dans l’Aube
• CMV et grossesse
• Quelle place pour les anticoagulants oraux non AVK
Retrouvez les précédents numéros sur www.dynalab.fr

Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire
du 1er RAM POUILLOT-MAIRE JEANNE D’ARC PASTEUR de BAR-SUR-AUBE
15 Bd du 1er RAM 41 Avenue du 1er mai 7 rue Jeanne d’Arc 88 avenue Pasteur 12 rue Thiers
10000 TROYES 10000 TROYES 10000 TROYES 10000 TROYES 10200 BAR-SUR-AUBE
Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire
de BAR SUR SEINE de ROMILLY NOGENT SUR SEINE du VAL
16 av. Gal Leclerc 51 rue Carnot 23 rue de l’Hôtel Dieu 4 rue du Val
10110 BAR-SUR-SEINE 10100 ROMILLY 10400 NOGENT SUR SEINE 77160 PROVINS
FOR-MU-4.4.1-023-01
Figure 1 : répartition des microorganismes isolés des ECBU (données : Dynalab, 2013)
Figure 2 : résistance bactérienne comparée au sein d’E coli (données : Dynalab, 2013 et Onerba, 2013)
Figure 3 : résistance bactérienne auboise au sein d’E.coli (données : Dynalab 2013)

FOR-MU-4.4.1-023-01
Cytomégalovirus (CMV) et grossesse
L'infection à cytomégalovirus est la cause la plus courante d'infection intra-utérine, se manifestant dans de 0,2% à 2,2% de toutes les
naissances vivantes, et constitue une cause courante de la surdité de perception et de la déficience mentale. Le cytomégalovirus
humain (CMV) appartient à la famille des Herpesviridae. C'est un virus enveloppé à ADN qui reste en latence dans l'organisme
après la primo-infection. Des réactivations asymptomatiques permettent au virus d'être excrété parfois pendant de longues périodes
et assurent , ainsi, sa transmission.
La primo-infection est symptomatique dans 10% des cas, traduite par un syndrome mononucléosique pseudo grippal ou à type
d'angine fébrile avec inversion de la formule leucocytaire, une élévation des transaminases accompagne des adénopathies voire une
hépatosplénomégalie.
La transmission materno-foetale se produit au cours de la grossesse ou au moment de l'accouchement. La maladie des inclusions
cytomégaliques du foetus et les séquelles neuropsychiques ou sensorielles surviennent surtout si la mère fait une primo-infection au
cours de la grossesse. Une réactivation d'une infection latente peut également se traduire par une contamination foetale, mais le
risque infectieux est faible du fait de la présence des anticorps maternels et seulement 1% des enfants infectés présenteraient des
séquelles.
En pratique courante, le diagnostic sérologique détecte la présence d'IgG et d'IgM par des techniques immunoenzymatiques,
(nomenclature B90) et permet essentiellement de préciser un statut sérologique. L'interprétation de ces tests est difficile car les
réactivations et parfois des surinfections s'accompagnent d'une élévation du taux d'IgG sur deux prélèvements successifs et
fréquemment d'une réapparition des IgM. Une remontée du taux d'IgG peut correspondre à une réactivation polyclonale contre
plusieurs Herpesvirus (réactions "croisées). On peut avoir recours à la mesure de l'avidité des anticorps IgG (analyse hors
nomenclature 43 euros à ce jour). Une avidité supérieure à 80% permet d'exclure une infection de moins de trois mois (chiffres
valables pour le réactif actuellement le plus utilisé : Vidas-Biomérieux)
Le diagnostic d'infection foetale à CMV est évoqué sur des signes échographiques et d'anomalies de développement intra-utérin du
fœtus. Une sérologie CMV négative permet d'exclure ce diagnostic. En revanche si elle est positive, quel que soit le profil
sérologique, une amniocentèse est indiquée pour rechercher le CMV dans le liquide amniotique.
Après avoir fait l'objet de controverses animées, le dépistage sérologique systématique du CMV au cours de la grossesse n'est
pas recommandé ni par le CNGOF (College National des Gynécologue-Obstétricien Français), ni par l'HAS.
Les arguments avancés sont le coût du dépistage, mais surtout un bénéfice attendu trop faible au regard des inconvénients générés.
Le bénéfice attendu est la diminution difficilement quantifiable, du nombre d'enfants nés infectés qui développeront des séquelles
neurosensorielles graves. Les inconvénients attendus par le dépistage de masse sont : une augmentation des prélèvements foetaux,
une augmentation des interruptions médicales de grossesse sur des pronostics incertains, et une angoisse constante générée chez les
couples concernés par un diagnostic prénatal. A ces arguments il faut ajouter qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons pas de
traitement ayant démontré son efficacité.
La transmission du CMV se fait par contacts inter-humains directs et le virus pénètre par voie buccale ou génitale, Il n'existe pas de
vaccin qui permette de prévenir l'infection chez la femme séronégative. La stratégie actuelle se base donc sur des mesures de
prévention primaire pour les femmes enceintes en contact avec de jeunes enfants.
Conseils d'hygiène pour éviter une infection à CMV : 1- Se laver les mains fréquemment
2- Porter des gants pour changer l'enfant,
3- Ne pas embrasser l'enfant sur la bouche
4- Ne pas utiliser le même linge de toilette
5- Ne pas boire ou manger avec les ustensiles de l'enfant,
Sources : Evaluation de l'intérêt du dépistage de l'infection à Cytomégalovirus chez la femme enceinte en France ANAES,Septembre 2004-Infection à
cytomégalovirus pendant la grossesse, sirective clinique de la SOGC Avril 2010-Diagnostic et suivi virologiques des infections à cytomegalovirus : applications à la
femme enceinte et au patient greffé par V Venard, A Le Faou feuillets de biologie mars 2007-Comment interpréter les sérologies au cours de la grossesse par
R,Levy,A,Berlioz-Arthaud,P,Thulliez, E,Camus feuillets de biologie mars 2009,

Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire
du 1er RAM POUILLOT-MAIRE JEANNE D’ARC PASTEUR de BAR-SUR-AUBE
15 Bd du 1er RAM 41 Avenue du 1er mai 7 rue Jeanne d’Arc 88 avenue Pasteur 12 rue Thiers
10000 TROYES 10000 TROYES 10000 TROYES 10000 TROYES 10200 BAR-SUR-AUBE
Laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire
de BAR SUR SEINE de ROMILLY NOGENT SUR SEINE du VAL
16 av. Gal Leclerc 51 rue Carnot 23 rue de l’Hôtel Dieu 4 rue du Val
10110 BAR-SUR-SEINE 10100 ROMILLY 10400 NOGENT SUR SEINE 77160 PROVINS
FOR-MU-4.4.1-023-01
Quelle place pour les anticoagulants oraux non antivitamine K
Trois anticoagulants oraux non antivitamine K (NACO) sont actuellement disponibles en tant qu'alternative aux AVK pour le
traitement de la fibrillation auriculaire non valvulaire : l’apixaban (Eliquis®), le rivaroxaban (Xarelto®) et le dabigatran
(Pradaxa®). Les recommandations de la Haute Autorité de Santé et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament rappellent que
les AVK sont la référence dans la prévention des accidents thrombo-emboliques en cas de fibrillation auriculaire, et que les
anticoagulants oraux non AVK représentent une alternative, car :
- On ne dispose d’aucun moyen de mesurer en pratique courante le degré d’anticoagulation qu’ils induisent car les tests
d’hémostase courants ne reflètent pas le niveau d’anticoagulation, et l’absence de surveillance biologique de routine ne doit pas
amener à banaliser le traitement anticoagulant
- Il n’existe pour l’instant pas d’antidote en cas de surdosage
- Du fait de la brièveté de leur demi-vie, plus courte que celle des AVK, leur action est très sensible à l’oubli d’une prise.
Contrairement aux AVK, l’absence de test biologique de routine avec ces nouveaux anticoagulants ne permet pas de contrôler
l’observance au traitement.
Les NACO sont aussi susceptibles d’induire des hémorragies graves en cas de surdosage. Les facteurs de risque de saignement sont:
- Insuffisance rénale chronique : une altération de la fonction rénale augmente leur taux plasmatique et le risque hémorragique. Le
dabigatran est contre-indiqué en cas de clairance de la créatinine (ClCr) < 30 mL/mn. Le rivaroxaban n’est pas recommandé en cas
de ClCr < 15 mL/mn ; il doit être utilisé avec prudence si ClCr est comprise entre 15 et 29 mL/mn.
- Âge > 75 ans
- Poids < 60 kg
Malgré l’impossibilité de surveiller le degré d’anticoagulation, une surveillance biologique des NACO est recommandée :
Fréquence Conditions
Fonction
rénale
Fonction
hépatique
Hémoglobine
Ava
nt mise en route du traitement
Tous patients
X X X
Chaque année au moins,
et en cas d’événement intercurrent
Tous patients
X X X
Tous 6 mois
Âge > 75 ans
;
Poids < 60 kg
;
ClC
r initiale entre 30 et 60 ml/min
X
Tous 3 mois
ClC
r initiale < 30 ml/min X
Sources : Recommandations HAS 07/2013 : Fibrillation auriculaire non valvulaire, Quelle place pour les anticoagulants oraux non antivitamine K. Point
d’information AFSSAPS 04/2012 : Les nouveaux anticoagulants oraux (dabigatran et rivaroxaban) dans la fibrillation auriculaire : ce qu’il faut savoir. ANSM
09/2013 : Nouveaux anticoagulants oraux : Mise en garde sur les facteurs de risque hémorragiques
Dosage de PSA
Depuis le 06/11/2013, une nouvelle technique de dosage de PSA est utilisée dans nos laboratoires, qui présente une corrélation très
satisfaisante avec la technique précédente (r = 0.99). S’agissant de 2 techniques de dosage différentes, le compte-rendu de résultat
n’affiche pas l’antériorité d’un dosage effectué avec la technique antérieure.
Renseignements cliniques et analyses de microbiologie
Afin d’orienter au mieux les cultures bactériennes, les patients seront bientôt sollicités pour l’obtention de renseignements cliniques
et thérapeutiques grâce à un formulaire joint au flacon de recueil pour examens microbiologiques.
1
/
4
100%