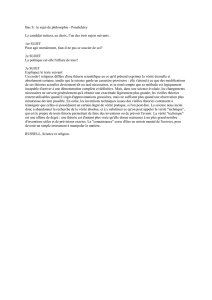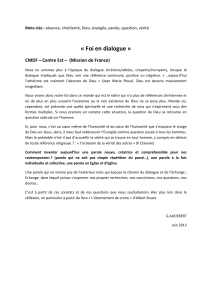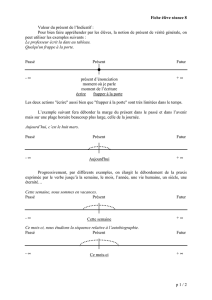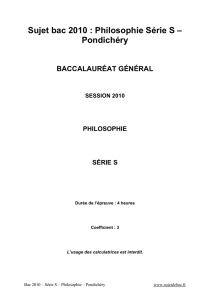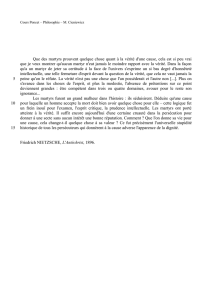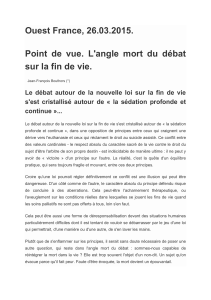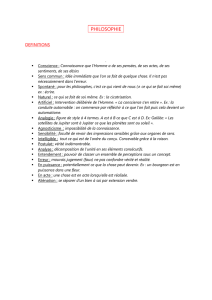Importer - L`économie demain

Précis d’économie objective / Propositions premières de science économique /
Chapitre 1 – L’économie
1.1. La pensée économique doit utiliser des définitions recevables en
mathématique des ensembles finis.
Les dictionnaires, lexiques et glossaires renseignent sur des acceptions qui ne sont pas, le
plus souvent, des énoncés conformes à la définition de la définition en mathématique des
ensembles finis.
1. La définition de la définition en mathématique des ensembles finis tient en
trois propositions.
1) Un ensemble fini est définissable en extension ou en compréhension.
2) Une définition en extension énumère tous les objets qui font partie de l’ensemble
considéré.
3) Une définition en compréhension énonce une propriété ou des propriétés que tous les
éléments de l’ensemble considéré et eux seuls possèdent.
2. On doit s’attendre à ce que les définitions des objets et des actes
économiques soient pour la plupart en compréhension.
L’énoncé d’une définition en compréhension peut être souvent imbriqué à une
énumération partielle. Exemple : les richesses économiques sont les produits du travail
humain, tels que des outils, des aliments et des vêtements, qui s’échangent le plus souvent
contre une quantité de monnaie et pour le reste directement entre elles. L’énumération
partielle pourrait être le début d’une définition en extension si tous les outils, tous les
aliments et tous les vêtements faisaient l'objet d’échanges économiques. Or ce n’est pas le
cas à cause de ceux que leurs propriétaires ont produit et dont ils gardent pour eux l’usage,
entre autres raisons. Par ce genre d’impossibilité, en économie les définitions recevables
en logique des ensembles finis sont pour la plupart en compréhension. Cette fatalité
accroît la nécessité d'apporter dans cette discipline un grand soin au préalable de la
mathématique littéraire.
3. Les définitions recevables en logique des ensembles finis, les autres
observations du réel et le raisonnement usent de conventions sémantiques.
C’est pourquoi la pensée économique n’est portée à son plus haut point de rigueur qu’en
faisant explicitement état des conventions majeures de dénomination qu’elle utilise. Les
clauses verbales les plus typiques de la théorie économique sont réputées être « toutes
choses égales par ailleurs » et « tôt ou tard ». En fait, la clause la plus nécessaire à
l’élaboration de la théorie économique authentiquement scientifique est : « convenons
d’appeler… » — suivi d’un mot ou d’une expression — « l’ensemble… » — suivi d’une
définition recevable en logique des ensembles finis.

4. En dépit de la propension au relativisme, le principe de la recherche de la
vérité est simple.
Une théorie est une suite d’énoncés qui expriment une relation entre plusieurs termes.
Autrement dit, une théorie est une suite de propositions. Une proposition qui décrit un
aspect du réel est vraie quand cette description est conforme aux faits. Une théorie, si
partielle soit-elle, est elle-même complètement vraie quand aucune de ses propositions
n’est contredite par une proposition vraie, que cette dernière fasse ou non partie de la
théorie exposée. Karl Popper a fait figurer Un complément à la critique du relativisme
(1961) à la fin de La société ouverte et ses ennemis. [1] On y lit :
« La principale maladie philosophique de notre temps est le relativisme intellectuel
et le relativisme moral qui, au moins pour une part, en découle. Par relativisme, ou
scepticisme si l’on préfère ce terme, j’entends la doctrine selon laquelle tout choix
entre des théories rivales est arbitraire : soit parce que la vérité objective n’existe
pas ; soit parce que, même si l’on admet qu’elle existe, il n’y a en tout cas pas de
théorie qui soit vraie, ou (sans être vraie) plus proche de la vérité qu’une autre ; soit
parce que, dans les cas où il y a deux théories ou plus, il n’existe aucun moyen de
décider si l’une est supérieure à l’autre. / … / Certains des arguments invoqués à
l’appui du relativisme découlent de la question même : " Qu’est-ce que la vérité ? ", à
laquelle le sceptique convaincu est sûr qu’il n’y a pas de réponse. Mais, à cette
question, on peut répliquer d’une façon simple et raisonnable – qui ne satisferait
probablement pas notre sceptique – qu’une affirmation ou un énoncé sont vrais si,
et seulement si, ils correspondent aux faits. [2] / Que veut dire " correspondre aux
faits " ? Bien qu’un sceptique ou un relativiste puisse trouver aussi impossible de
répondre à cette question qu’à la précédente, c’est en réalité aussi facile et même
presque banal. Par exemple, tout juge sait bien ce qu’un témoin entend par vérité :
c’est justement ce qui correspond aux faits. / … / Il faut distinguer nettement entre
savoir ce que signifie la vérité et avoir un moyen, un critère, pour décider si un
énoncé est vrai ou faux. / … / La plupart d’entre nous ne connaissent pas les critères
qui permettent de savoir si un billet de banque est authentique ou faux. Mais, si nous
trouvions deux billets portant le même numéro, nous aurions de bonnes raisons de
déclarer que l’un des deux [au moins] est faux : assertion qui ne serait pas privée de
signification par l’absence d’un critère d’authenticité. / … / C’est, à mon avis,
l’exigence d’un critère de la vérité qui a fait croire à tant de philosophes qu’il était
impossible de répondre à la question : " Qu’est-ce que la vérité ? ". Mais l’absence de
ce critère ne rend pas la notion de vérité dénuée de sens, pas plus que l’absence d’un
critère de la bonne santé ne rend dénuée de sens la notion de santé. En l’absence de
tout critère, un malade peut chercher à retrouver la santé, et un homme qui s’est
trompé rechercher la vérité. / Un des résultats directs des travaux de Tarski sur la
vérité est le théorème logique : il ne peut y avoir de critère général de la vérité. Ce
théorème est fondé, et il repose sur la notion même selon laquelle la vérité est la
correspondance avec les faits : c’est-à-dire sur une notion pour laquelle nous n’avons
pas de critère. L’exigence déraisonnable des philosophies du critère, si on l’avait
respectée en l’occurrence, nous aurait empêchés à jamais d’aboutir à ce résultat

logique – qui est d’une grande importance. / … / Certes, il y a dans le scepticisme et le
relativisme un fond de vérité, à savoir qu’il n’existe pas – en effet – de critère général
de la vérité. Mais on n’a pas le droit d’en conclure que le choix entre des théories
rivales est arbitraire. Cela veut simplement dire que nous pouvons nous tromper
dans ce choix : que nous sommes faillibles. / … / C’est une illusion de croire à la
certitude scientifique et à l’autorité absolue de la science ; la science est faillible
parce qu’elle est humaine. Mais cela ne donne pas raison au scepticisme ni au
relativisme. Nous pouvons nous tromper, certes ; il n’en résulte pas que le choix que
nous faisons entre plusieurs théories est [inévitablement] arbitraire, que nous ne
pouvons apprendre, et nous rapprocher de la vérité. »
5. La sélection des idées scientifiques est, sur le long terme, rationnelle.
Début 2008, Raymond Boudon a enrichi la collection encyclopédique Que sais-je ?
Presses Universitaires de France par Le relativisme. [3] Le constat qu’il n’y a pas de critères
généraux du vrai et de la scientificité y est exposé, avec une référence philosophiquement
plus prestigieuse et didactiquement plus savoureuse à colporter que celle utilisée par
Popper dans l’extrait cité ci-dessus. Boudon le fait dans un passage [4] qui vaut d’être ici
entièrement cité (les notes de bas de page sont des ajouts pour le besoin de la présente
citation, les soulignements sont de l’auteur cité) :
« Deux arguments principaux peuvent être opposés au relativisme cognitif. [5]
« 1 / Comme l’indique Kuhn, [6] la sélection des idées scientifiques fait apparaître sur le
court terme l’action de facteurs irrationnels. Cela n’exclut pas que, sur le long terme,
cette sélection soit rationnelle. Lavoisier a objectivement raison contre Priestley, même
si la discussion de la théorie du phlogistique [7] de Priestley fait apparaître que les prises
de position des hommes de science impliqués dans le débat furent souvent inspirées par
des motivations de caractère irrationnel. C’est donc seulement si l’on néglige la
distinction entre le court et le long terme que l’on peut appliquer le principe du tiers
exclu [8] et déclarer que la discussion entre savants n’étant pas exclusivement
rationnelle, la sélection des idées scientifiques doit être tenue pour irrationnelle. Mais,
dès lors que l’on prend cette distinction en compte, la question de savoir si les
discussions entre savants sont rationnelles ou non est disqualifiée de par sa formulation
même.
« 2 / Il en va de même s’agissant des conséquences qui ont été tirées de l’impuissance
de la philosophie des sciences à déterminer les critères de démarcation entre science et
non science. On n’a jamais réussi à identifier les critères en question. Mais on peut
appliquer à la scientificité une remarque décisive de Kant sur la vérité [9] ; ce n’est pas
parce qu’il n’existe pas de critères généraux du vrai que celui-ci n’existe pas. Rechercher
les critères généraux du vrai, ironise-t-il, c’est chercher à traire un bouc. Pourtant, la
vérité n’est pas une illusion.
« Kant veut dire qu’il n’existe pas d’ensemble fini de critères qu’on pourrait appliquer
à la manière d’une checklist pour déterminer si une théorie est vraie. En revanche, on
peut, dans bien des cas, trancher avec certitude en faveur d’une théorie contre une

autre. C’est ce que nous enseigne l’histoire des sciences. On peut accepter la théorie
proposée par Torricelli et Pascal du phénomène physique qui devait donner naissance
au baromètre et rejeter les théories d’inspiration aristotélicienne parce que la première
rend mieux compte des phénomènes observés et n’introduit pas l’idée que la nature
aurait horreur du vide. Dans d’autres cas, ce sont d’autres critères qui permettront de
trancher entre théories concurrentes. Ainsi, les critères qui permettent de choisir entre
les théories expliquant l’extinction des dinosaures sont pour partie différents de ceux
qui permettent de trancher entre les théories de Priestley et de Lavoisier. C’est bien
parce qu’il est possible de déterminer à partir de raisons solides si l’on doit préférer
une théorie à une autre que certaines théories disparaissent irréversiblement au profit
de théories jugées préférables au vu de critères bien définis et variables d’un cas à
l’autre.
« On peut appliquer à la scientificité la remarque de Kant sur la vérité. Il n’y a pas
davantage de critères généraux de la scientificité que de la vérité. Dès que des théories
peuvent donner lieu à des comparaisons aboutissant à un arbitrage indiscutable, elles
donnent le sentiment d’être scientifiques. Mais il est difficile d’aller au-delà dans la
précision. Il n’y a pas de critères généraux de la scientificité, mais la scientificité
existe. »
6. Ce qui vaut pour la vérité et la scientificité vaut pour l’objectivité.
La conséquence la plus dommageable de la négation de la possibilité pour la
connaissance d’accéder au réel est d’éliminer du champ de conscience la culture des
vertus de l’objectivité. Cette régression est empirée par l’attribution indue, mais de règle
en économie politique subjective, d’une valeur d’échange économique à la connaissance
en elle-même, autrement dit au savoir en lui-même (plus à ce sujet au chapitre suivant).
7. En économie aussi, la prétention du pur descriptif d’abord est fallacieuse.
Dans Le relativisme dont deux pages viennent d’être citées, Raymond Boudon, au début
de son troisième chapitre, titré Expliquer les croyances, pose la question : « Faut-il accepter
d’autre part l’opposition souvent proclamée entre connaissance normative et
connaissance descriptive ? ». Tout au moins en théorie économique, le descriptif est très
souvent, voire toujours, du normatif, positif ou négatif. De toute façon, décrire est en soi
préconiser de voir les choses ainsi et, dans les affaires économiques, de les administrer en
fonction de ce qu’on tient, explicitement ou implicitement, pour normal et anormal. Vouer
en premier lieu la théorie économique — la science économique, le socle de l’économie
politique — à la description afin d’en assurer la scientificité ? Il est en réalité impossible de
s’y tenir, cependant qu’y prétendre est nécessaire pour faire passer des préjugés pour des
explications et du particulier pour du général, tout en donnant l’impression de s’en tenir à
des considérations impartiales.
8. De la pseudo-définition est indispensable pour se laisser aller à ses
partialités.
L’usage de définitions recevables en logique des ensembles finis s’impose à la théorie
économique pour les mêmes raisons qu’en d’autres disciplines. La négligence de ces

raisons est cependant particulièrement tentante dès qu’il est question d’économie. Cette
négligence est, en effet, indispensable pour se laisser aller à ses partialités alors qu’elles
participent étroitement à ce que je suis ou crois être au quotidien. C’est pourquoi les
dépasser est toujours difficile et même souvent impossible. Le subjectivisme économique,
dans ses déclinaisons tant individualistes que collectivistes, a besoin de pseudo-définitions
pour paraître rationnel.
9. Les pseudo-définitions font le lit des pétitions de principe.
La pseudo-définition favorise la pétition de principe, à savoir le raisonnement qui tient
pour vrai ce qu’il s’agit de démontrer. [10] L’effort d’attention aux faits nécessité par la
définition, au sens de ce concept en logique mathématique, ouvre la voie de la
démonstration alors que la pétition de principe obstrue cette voie. Prenons un exemple. Je
tiens pour vrai que la loi de l’offre et de la demande régit principalement la formation de
tous les prix. J’en tire des courbes et des équations, et d’autres sortes de considérations,
puis je (me) dis qu’il est « donc » bien vrai, alors que je ne l’ai pas démontré, que la loi de
l’offre et de la demande régit principalement la formation de tous les prix. L’évitement de
cette pétition de principe vient de lui-même dès que l’attention a été assez aiguisée par
l’effort de vraies définitions. L’entendement ne laisse alors plus échapper que :
1) « principalement » ne signifie pas « complémentairement » ; 2) c’est de tous les prix et
non pas d’une partie d’entre eux dont il s’agit. Ce « principalement » et ce « tous » ne sont
pas conformes aux faits.
10. Soit une denrée agricole dont le prix baisse quand son offre excède sa
demande et monte dans le cas contraire.
Le constater n’empêche nullement de se demander : qu’est-ce qui détermine la valeur
objective d’échange de cette denrée quand il n’y a ni excès ni insuffisance de son offre sur
sa demande ? [11] Même question autrement formulée : que représente la valeur
objective d’échange à partir de laquelle il y a éventuellement sous enchérissement ou
surenchérissement ? La réponse à cette question achève l’évitement de la pétition de
principe de la loi de l’offre et de la demande censée régir principalement la formation de
tous les prix. Une théorisation au moyen de pseudo définitions, de pétitions de principe et
d’abus de tiers exclu [12] conforte des préjugés qui en retour facilitent son accréditation.
Les allégations sur ce que la théorie économique ne peut pas avoir de commun avec les
« sciences dures » sont irrecevables au regard de ce que ces sciences admettent de
méthodologiquement plus élémentaire : savoir de quoi au juste il est question.
11. La mathématique de la science économique est d’abord littéraire.
En économie notamment, mieux valent des concepts sans équations de docteur en
physique que toutes les équations que l’on voudra traitant de notions. La définition de la
définition est un instrument mathématique logiquement indispensable au bon usage du
reste de la palette des outils mathématiques dont, en premier lieu, la règle de trois. Le
choix de mots et l’assemblage de phrases est un exercice mathématique, où l’on s’efforce
au maximum d’exactitude et de complétude dans l’observation dont on est capable, ainsi
qu’au minimum de non contradictions, de pétitions de principe et d’autres sophismes. S’y
adonner en tant qu’auteur et lecteur est faire de la mathématique littéraire.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%