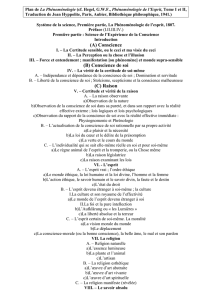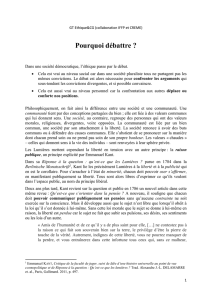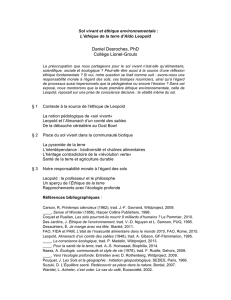soi-même comme un autre

PAULRICŒUR
SOI-MÊME
COMME UN
AUTRE
ÉDITIONS DU SEUIL
27, rue Jacob, Paris VF

L'ORDRE PHILOSOPHIQUE
SOUS LA DIRECTION DE
FRANÇOIS WAHL
ISBN 2-02-011458-5
© Éditions du Seuil, mars 1990, à
l'exception des langues anglo-saxonnes.
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
A FRANÇOIS WAHL
en témoignage de reconnaissance et d'amitié

REMERCIEMENTS
Mes premiers remerciements vont à l'université
d'Edimbourg dans la personne de son Chancelier qui m'a
conféré l'honneur de prononcer en 1986 les Gifford Lec-
tures sous le titre On Seljhood, the Question of Personal
Identity. C'est de ces conférences que sont issues les
études ici publiées.
J'exprime également ma gratitude au professeur
Spae-mann de l'université de Munich, qui m'a permis de
donner, la même année, une seconde version des
conférences initiales dans le cadre des Schelling
Vorlesungen.
Je remercie en outre le professeur Bianco de l'univer-
sité de Rome « La Sapienza », qui m'a offert l'occasion
de développer la partie éthique de mon ouvrage, dans le
cadre de l'enseignement qu'il m'a confié en 1987.
Je suis reconnaissant à mes amis Jean Greisch et
Richard Kearney de m'avoir permis d'esquisser les
considérations ontologiques sur lesquelles s'achève mon
travail, dans le cadre de la « décade de Cerisy » qu'ils ont
organisée et présidée durant l'été 1988.
Enfin, je veux dire à François Wahl, des Éditions du
Seuil, ma profonde gratitude pour l'aide qu'il m'a appor-
tée dans la composition et la rédaction de ce livre. Ce
dernier, comme mes précédents travaux édités par lui,
est redevable, au-delà de ce que je puis exprimer, à son
esprit de rigueur et à son dévouement à l'écriture.

PRÉFACE
La question de l'ipséité
Par le titre Soi-même comme un autre, j'ai voulu désigner le point de
convergence entre les trois intentions philosophiques majeures qui ont
présidé à l'élaboration des études qui composent cet ouvrage.
La première intention est de marquer le primat de la médiation
réflexive sur la position immédiate du sujet, telle qu'elle s'exprime à la
première personne du singulier: «je pense», «je suis». Cette première
intention trouve un appui dans la grammaire des langues naturelles
lorsque celle-ci permet d'opposer « soi » à « je ». Cet appui prend des
formes différentes selon les particularités grammaticales propres à
chaque langue. Au-delà de la corrélation globale entre le français soi,
l'anglais self, l'allemand Selbsl, l'italien se, l'espagnol simismo, les
grammaires divergent. Mais ces divergences mêmes sont instructives,
dans la mesure où chaque particularité grammaticale éclaire une partie du
sens fondamental recherché. En ce qui concerne le français, « soi » est
défini d'emblée comme pronom réfléchi. Il est vrai que l'usage
philosophique qui en est fait tout au long de ces études enfreint une
restriction que les grammairiens soulignent, à savoir que « soi » est
un pronom réfléchi de la troisième personne (il, elle, eux). Cette
restriction toutefois est levée, si on rapproche le terme « soi » du terme «
se », lui-même rapporté à des verbes au mode infinitif- on dit : « se
présenter », « se nommer ». Cet usage, pour nous exemplaire, vérifie
un des enseignements du linguiste G. Guillaume ', selon lequel c'est à
l'infinitif, et encore jusqu'à un certain point au participe, que le verbe
exprime la plénitude de sa signification, avant de se distribuer entre les
temps verbaux et les personnes grammaticales ; le « se » désigne alors le
réfléchi de tous les pronoms personnels, et même de pronoms
impersonnels, tels que « chacun », « quiconque », « on », auxquels il
sera fait fréquemment allusion au cours de nos investigations. Ce
détour
1. G. Guillaume, Temps et Verbe, Paris, Champion, 1965.
11

SOI-MÊME COMME UN AUTRE PRÉFACE
par le « se » n'est pas vain, dans la mesure où le pronom réfléchi « soi »
accède lui aussi à la même amplitude omnitemporelle quand il
complète le «se» associé au mode infinitif: «se désigner soi-même »
(je laisse provisoirement de côté la signification attachée au « même »
dans l'expression « soi-même »). C'est sur ce dernier usage - relevant
sans conteste du « bon usage » de la langue française ! - que prend
appui notre emploi constant du terme « soi », en contexte
philosophique, comme pronom réfléchi de toutes les personnes
grammaticales, sans oublier les expressions impersonnelles citées un
peu plus haut. C'est, à son tour, cette valeur de réfléchi
omnipersonnel qui est préservée dans l'emploi du « soi » dans la
fonction de complément de nom : « le souci de soi » - selon le titre
magnifique de Michel Foucault. Cette tournure n'a rien d'étonnant,
dans la mesure où les noms qui admettent le « soi » à un cas indirect sont
eux-mêmes des infinitifs nominalisés, comme l'atteste l'équivalence des
deux expressions : « se soucier de soi(-même) » et «le souci de soi ». Le
glissement d'une expression à l'autre se recommande de la permission
grammaticale selon laquelle n'importe quel élément du langage peut
être nominalisé : ne dit-on pas « le boire », « le beau », « le bel
aujourd'hui » ? C'est en vertu de la même permission grammaticale que
l'on peut dire « le soi », alignant ainsi cette expression sur les formes
également nominaiisées des pronoms personnels dans la position de sujet
grammatical : « le je », « le tu », « le nous », etc. Cette nominalisation,
moins tolérée en français qu'en allemand ou en anglais, ne devient
abusive que si l'on oublie la filiation grammaticale à partir du cas
indirect consigné dans l'expression « désignation de soi », elle-même
dérivée par première nominalisation de l'infinitif réfléchi : « se désigner
soi-même ». C'est cette forme que nous tiendrons désormais pour
canonique. La seconde intention philosophique, implicitement
inscrite dans le titre du présent ouvrage par le biais du terme « même »,
est de dissocier deux significations majeures de l'identité (dont on va dire
dans un moment le rapport avec le terme « même »), selon que l'on
entend par identique l'équivalent de Y idem ou de Vipse latin.
L'équivocité du terme « identique » sera au cœur de nos réflexions sur
l'identité personnelle et l'identité narrative, en rapport avec un caractère
majeur du soi, à savoir sa temporalité. L'identité, au sens d'idem,
déploie elle-même une hiérarchie de significations que nous
expliciterons le moment venu (cinquième et sixième études), et dont la
permanence dans le temps constitue le degré le plus élevé, à quoi
s'oppose le différent, au sens de
12
changeant, variable. Notre thèse constante sera que l'identité au sens
àUpse n'implique aucune assertion concernant un prétendu noyau non
changeant de la personnalité. Et cela, quand bien même l'ipséité
apporterait des modalités propres d'identité, comme l'analyse de la
promesse l'attestera. Or l'équivocité de l'identité concerne notre titre à
travers la synonymie partielle, en français du moins, entre « même » et
« identique ». Dans ses acceptions variées1, «même» est employé
dans le cadre d'une comparaison ; il a pour contraires : autre,
contraire, distinct, divers, inégal, inverse. Le poids de cet usage
comparatif du terme « même » m'a paru si grand que je tiendrai
désormais la mêmeté pour synonyme de l'identité-ù/em et que je lui
opposerai l'ipséité par référence à l'identité-/p.se. Jusqu'à quel point
l'équivocité du terme « même » se reflète-t-elle dans notre titre Soi-même
comme un autre ? Indirectement seulement, dans la mesure où «
soi-même » n'est qu'une forme renforcée de « soi », l'expression «
même » servant à indiquer qu'il s'agit exactement de l'être ou de la chose
en question (c'est pourquoi il n'y a guère de différence entre « le souci de
soi » et « le souci de soi-même », sinon l'effet de renforcement qu'on
vient de dire). Néanmoins, le fil ténu qui rattache « même », placé après
« soi » à l'adjectif « même », au sens d'identique ou de semblable, n'est
pas rompu. Renforcer, c'est encore marquer une identité. Ce n'est pas le
cas en anglais ou en allemand où same ne peut pas être confondu avec
self, der die, dasselbe, ou gleich, avec Selbst, sinon dans des philosophies
qui dérivent expressément la seljhood ou la Selbstheit de la mêmeté
résultant d'une comparaison. Ici, l'anglais et l'allemand sont moins
sources d'équivoque que le français.
La troisième intention philosophique, explicitement incluse, celle-ci,
dans notre titre, s'enchaîne avec la précédente, en ce sens que
Viàenlitè-ipse met en jeu une dialectique complémentaire de celle de
l'ipséité et de la mêmeté, à savoir la dialectique du soi et de Vautre que
soi. Tant que l'on reste dans le cercle de Pidentité-mêmeté, l'altérité de
l'autre que soi ne présente rien d'original : « autre » figure, comme on a
pu le remarquer en passant, dans la liste des antonymes de « même », à
côté de « contraire », « distinct », « divers », etc. Il en va tout
autrement si l'on met en couple l'altérité avec l'ipséité. Une altérité qui
n'est pas - ou pas
1. Le Robert place en tête des significations de l'adjectif « même » l'identité
absolue (la même personne, une seule et même chose), la simultanéité (dans le
même temps), la similitude (qui fait du même le synonyme de l'analogue, du
pareil, du semblable, du similaire, du tel que), l'égalité (une même quantité de).
13
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
1
/
214
100%