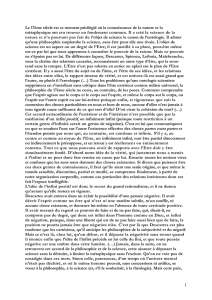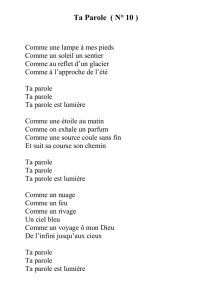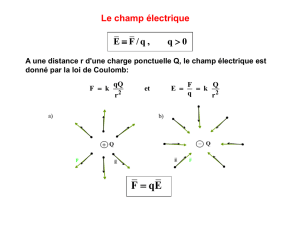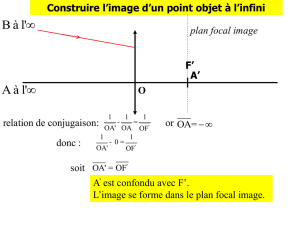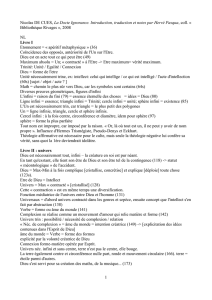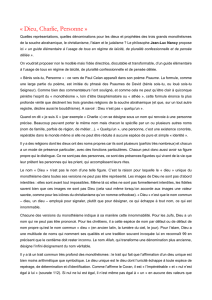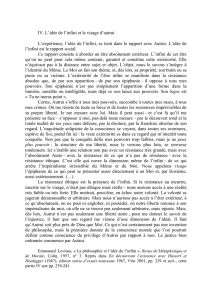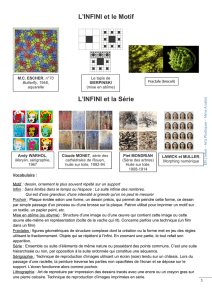le devoilement rationnel du sens

1
LEDEVOILEMENTRATIONNELDUSENS
«Croirepourcomprendre,comprendrepourcroire»
StAugustin
A.MENDIRI

3
L’AVENTURE DE LA RAISON
Il convient tout d’abord de préciser ce que nous entendons par l’Etre. L’Etre renvoie à
l’ensemble de la réalité, autrement dit à la fois à ce qui apparaît et à ce qui est vraiment, au-
delà des apparences. La présence de l’Etre est un grand mystère. Qui ne s’est jamais interrogé
sur cette présence et n’en a pas été saisi d’étonnement n’a pas l’âme d’un philosophe. La
présence de l’Etre suscite cette question, éternellement d’actualité, soulevée par Leibniz au
XVII° siècle : « Pourquoi existe quelque chose plutôt que rien ? ». Cette question peut en
entraîner une autre : l’Etre a- t-il un commencement ? Cette question a-t-elle un sens ?
Examinons un moment cette question du commencement de l’Etre. Pour ce faire nous
disposons d’une faculté que nous appelons la raison, c’est-à-dire la pensée logique, la pensée
qui se refuse à émettre des contradictions. La raison est la faculté de référence de l’activité
philosophique depuis que celle-ci est née en Grèce voici plus de vingt-cinq siècles. Si nous
disons que la civilisation grecque de cette époque a inventé la philosophie, c’est dans la
mesure où elle semble être la première civilisation qui ait fait confiance en la seule raison afin
de répondre aux grandes questions que se pose l’homme.
Expliquons-nous sur ce statut de la raison. S’il est une discipline où la raison règne en
maître et sans aucune contestation possible, ce sont les mathématiques et c’est là d’ailleurs
l’origine de la fascination que celles-ci ont exercé et exercent peut-être encore sur la pensée
philosophique. Les Grecs de cette époque ont en effet également inventé les mathématiques.
Cette affirmation peut légitimement surprendre. Car, incontestablement, les nombreuses
civilisations qui ont précédé la Grèce du V° siècle av. JC, sont les auteurs de remarquables
réalisations architecturales, de calendriers, de cartes terrestres, maritimes, du ciel, toutes
choses qui présupposent des connaissances mathématiques. Alors au nom de quoi ce
privilège accordé à la Grèce du V° siècle av. JC ?
Les grecs ont inventé la démonstration. Démontrer une proposition revient à établir par le
raisonnement que cette proposition peut se ramener à des propositions antérieurement
démontrées. Certes, si nous remontons ainsi la chaîne des démonstrations, force est de
constater que l’esprit doit s’arrêter à des propositions premières échappant à la démonstration.
Notre propos ne consiste pas ici à réfléchir sur la nature exacte de ces propositions premières
ni sur le paradoxe sur lequel sont fondées les mathématiques, définies comme la science de la
démonstration dont le point de départ est constitué de propositions indémontrables.
Car ce qui nous intéresse dans l’immédiat c’est le rôle que jouent la démonstration et la
raison au sein des mathématiques. Jusqu’aux Grecs, les connaissances mathématiques
relevaient de pratiques empiriques, c’est-à-dire de pratiques fondées sur l’expérience prise au
sens large, sur l’observation, sur les tâtonnements des essais et des erreurs, sur des mesures.
La nouveauté introduite par les Grecs est d’avoir montré qu’une proposition est vraiment de
nature mathématique qu’à partir du moment où elle peut faire l’objet d’une démonstration.
Les Grecs ont inventé les mathématiques car ils ont inventé la démonstration.

4
Or, la démonstration ne s’appuie que sur les ressources de la seule raison. C’est d’ailleurs là
que se situe sa difficulté majeure pour les apprentis en la matière. De jeunes collégiens
comprennent souvent difficilement qu’il convient de démontrer des propriétés de figures ou
de nombres qui semblent parfois évidentes à la simple observation. Les mathématiques sont
vraiment l’empire de la raison.
Ce détour par les mathématiques se justifie car il en va de même concernant la philosophie.
Si on s’accorde pour dire que cette discipline consiste à s’interroger et à réfléchir sur les
grandes questions que peut se poser l’homme, il peut sembler étonnant que la naissance de
cette démarche soit fixée si tardivement, à savoir il y a seulement vingt-cinq siècles, sur les
bords de la Méditerranée, en Grèce. L’humanité a dû se poser de telles questions dès l’aube de
son apparition sur cette planète, dès que la conscience s’est fait jour.
Evidemment, il ne viendrait à l’idée de personne de contester cela. Mais force est de
constater que les réflexions conduites par les civilisations antérieures à la Grèce antique
étaient essentiellement alimentées par de grandes religions ou par des conceptions morales.
Les religions reposent sur des traditions venues du fond des âges, sur des expériences
spirituelles effectuées par des méditants persuadés d’être entrés en contact au sein de leur vie
intérieure avec des forces ou une présence qui les dépassent et qui sont le signe ou le
témoignage de la divinité, de la source et du sens de toutes choses. Certes, la réflexion entre
bien en ligne de compte, mais force est de constater que les affirmations émises, les croyances
proposées ne reposent pas sur la seule autorité de la raison.
L’ambition des intellectuels Grecs du V° siècle av. JC, c’est précisément de ne faire
confiance qu’en la seule raison afin de répondre aux interrogations de l’humanité à propos
des grandes questions métaphysiques que se pose l’homme, si nous appelons métaphysique
cette démarche consistant à poser et à tenter de répondre par la seule raison aux questions
soulevées par les religions et plus largement par tous les courants spirituels, fussent-ils
agnostiques ou athées.
Dès lors, si nous pouvons dire que les Grecs de cette époque ont inventé la philosophie,
c’est exactement pour la même raison que nous leur avons attribué l’invention des
mathématiques, à savoir la confiance et le rôle exclusif accordés à la raison afin de conduire
ces entreprises intellectuelles respectives. Les questions que se pose l’homme ne devaient plus
relever de la croyance, religieuse notamment, mais d’un savoir. L’intérêt majeur du rôle de la
raison consistait dans l’universalité potentielle des conclusions auxquelles elle permettait
d’aboutir.
En somme, la raison a conduit à l’invention de deux nouvelles disciplines, à savoir les
mathématiques et la philosophie, mais son mérite est d’avoir donné naissance à l’idée
d’humanité, d’universalité de l’homme au-delà des différentes cultures, d’universalité de la
vérité, objet d’un savoir et non de croyances. De plus, de manière encore plus noble, la
confiance dans la raison libérait l’homme de la confiance qu’il devait accorder à autrui afin de
parvenir à la vérité. Le bon usage de la raison le rendait entièrement libre d’accéder à la
vérité par lui-même. La raison faisait entrer la vérité et la liberté du sujet dans une
communauté de destin.

5
Cette confiance accordée à la raison conduisait donc à une très haute idée de l’homme.
Pourtant, les millénaires qui ont suivi ont conduit tout à la fois à déchanter concernant ses
capacités à répondre aux questions métaphysiques et dans le même temps ont
considérablement renforcé la confiance qu’on pouvait lui accorder dans le domaine
scientifique et technique.
Rappelons schématiquement de quoi il s’agit. L’histoire de la philosophie est marquée par
une succession de systèmes de pensée très divers dans leurs conclusions, aucun d’entre eux ne
s’étant trouvé à même de s’imposer à tous les esprits, comme c’est le cas pour les
mathématiques et aujourd’hui à propos de l’activité scientifique. En effet, à partir du XVII°
siècle, l’humanité a connu une seconde révolution intellectuelle avec l’invention de la science
moderne, invention où le rôle des mathématiques a encore été déterminant.
Il faut dire que jusqu’à cette époque, les mathématiques étaient considérées comme une
science abstraite, entièrement rationnelle mais étrangère à la nature physique, et les sciences
de la nature comme une activité concrète, essentiellement fondée sur l’observation attentive
et rigoureuse de la nature. Or, Galilée notamment ainsi que les principaux physiciens du
XVII ° siècle, ont inventé la science moderne dès lors qu’ils ont repris à leur compte
l’intuition de Platon, elle-même inspirée par Pythagore et qui consistait à penser que le
monde était structuré mathématiquement. Les mathématiques se présentaient comme le
langage même de la nature.
En conséquence, les mathématiques, science des formes et des nombres et des relations
entre les figures et les nombres, proposaient à la physique ou science de la matière en
mouvement des structures au sein desquelles semblaient se couler les phénomènes naturels.
C’est cette alliance historique entre les mathématiques et les sciences de la nature qui est à
l’origine de la science moderne et qui lui doit ses développements considérables au XX°
siècle, notamment avec Einstein et sa théorie de la relativité, véritable géométrisation du réel
physique.
Ainsi, les mathématiques ne sont plus réduites aux opérations, somme toute limitées de
simples mesures, mais sont-elles la colonne vertébrale de tout savoir scientifique. Rappelons,
afin d’illustrer le propos, que sans la géométrie de Riemann, pour laquelle il n’y a que des
courbes dans l’espace qu’il prend en considération, la physique de la relativité pour laquelle
toute masse crée une courbe de l’espace, n’aurait pas pu trouver le langage adéquat pour être
écrite.
Or, nul ne doute de la véracité et de l’efficacité de la science moderne et contemporaine.
Cette efficacité est amplement vérifiée par ses applications techniques. Par exemple,
l’industrie nucléaire civile et l’armement nucléaire n’auraient pu voir le jour sans les
conclusions et l’avancement de la science théorique sur la composition atomique de la
matière. Mais avons-nous affaire ici à un savoir incontestable ou plus précisément à un savoir
authentique sur la nature du réel, savoir que la philosophie aurait été incapable d’établir ?
Avant d’apporter une réponse à cette question, revenons sur l’impuissance proclamée de la
philosophie à aboutir à un savoir qui fasse l’accord des esprits à propos des grandes questions

6
métaphysiques portant entre autres choses sur les origines ultimes du monde, sur son sens
éventuel, sur l’existence de Dieu, sur la nature intime du réel, sur nos destins individuels, sur
la mort, sur la présence du « Mal » et a contrario de la beauté, du plaisir, des satisfactions de
toutes sortes etc.
Face à cette impuissance, la raison s’est parfois résolue à l’expliquer, à la théoriser
rationnellement. Telle fut l’entreprise de Kant au XVIII° siècle. Si la raison a échoué dans ce
type d’entreprise métaphysique alors qu’elle a démontré avec éclat sa fécondité en matière
mathématique et scientifique, c’est simplement parce qu’elle n’est pas faite pour cela. Son
usage en matière métaphysique est stérile et illégitime. La raison, par l’intermédiaire de
l’entendement ou de la faculté de comprendre, ne peut raisonner de manière féconde que sur
des données offertes à son intuition entendue ici comme perception. Je puis utiliser mes
facultés de l’esprit pour affirmer que si j’échauffe une barre de fer, elle va se dilater car la
cause (l’échauffement) et l’effet (la dilatation) font l’objet d’une intuition sensible.
En revanche si je dis que tout a une cause, donc que le monde a une cause et que cette
cause est Dieu, mon raisonnement tourne à vide car ni le monde dans sa totalité ni Dieu ne
sont des données de l’intuition sensible. L’entreprise métaphysique est vaine. La raison pure,
c’est-à-dire la raison livrée à ses seules ressources, ne peut délivrer aucun savoir. Mais au-
delà du fait qu’il s’agit d’une interprétation de l’échec de la métaphysique parmi d’autres,
doit-on en conclure que désormais seule l’activité scientifique détient le monopole du savoir
et a vocation à terme à répondre à toutes nos questions, y compris les questions de nature
métaphysique ?
Cette croyance dans le pouvoir illimité de la science, qui a donné naissance au courant dit
positiviste, est empreinte, selon nous, d’une grande naïveté. Notre jugement ne repose pas
seulement sur son égale impuissance que l’entreprise philosophique à répondre aux questions
métaphysiques. Car l’examen des conditions et des limites du savoir scientifique, et qui fait
l’objet de ce qu’on appelle l’épistémologie ou réflexion sur la connaissance, relativise
considérablement la nature du savoir délivré par la science.
Nous rappellerons à cet effet trois limitations fondamentales de ce type de savoir. En
premier lieu, les vérités scientifiques, celles qui portent sur l’explication des phénomènes, bref
sur les théories, sont des vérités provisoires. Elles n’ont de sens que par rapport au niveau du
réel que l’on est à même de prendre en considération, grâce à nos moyens techniques
d’expérimentation, aux outils mathématiques dont nous disposons, au savoir antérieur dont
nous sommes tributaires. C’est ainsi que pour s’en tenir à un exemple spectaculaire, la
physique classique de Newton considérait et vérifiait que la masse d’un corps, c’est-à-dire sa
quantité de matière, était constante alors que la théorie de la relativité d’Einstein établit
théoriquement et expérimentalement que la masse croît avec la vitesse.
En second lieu, nous ne savons pas si nos explications ou nos théories doivent être
considérées comme de simples interprétations humaines du réel ou bien si elles
correspondent de manière plus ou moins éloignée mais fidèle quant à la direction prise, au
réel lui-même. Einstein, reprenant en cela une image proposée par Descartes, comparait les
données de l’expérimentation aux éléments du cadran d’une montre mécanique. Nous
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%