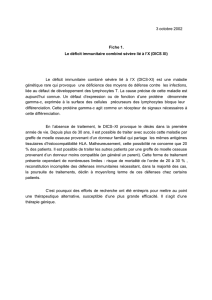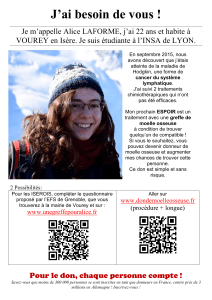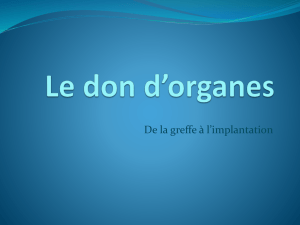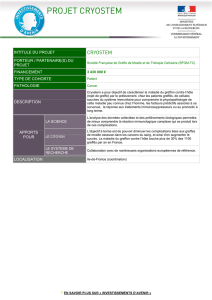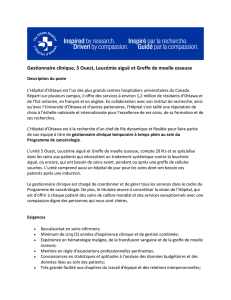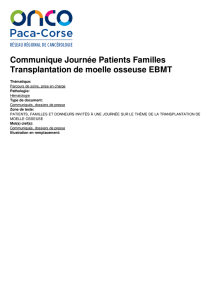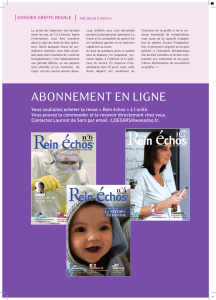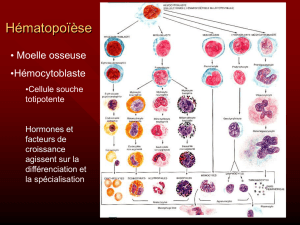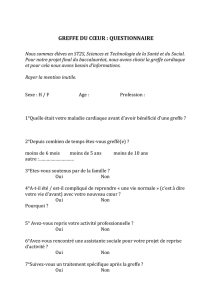echerche - Banque de données en santé publique

ECHERCHE
Hélène AUDEBERT, cadre infirmier enseignantHélène AUDEBERT, cadre infirmier enseignant
Chantal FISCHER, infirmièreChantal FISCHER, infirmière
Florence SORDES-ADER, docteur en PsychologieFlorence SORDES-ADER, docteur en Psychologie
CHU TOULOUSE
L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR
ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE
RÉSUMÉ
SUMMARY
Dans le cadre législatif, l’allogreffe de moelle osseuse
est considérée comme une transplantation d’organes.
Elle consiste à «remplacer une moelle malade ou
déficiente par une moelle saine prélevée sur un don-
neur vivant compatible ».
Ce traitement a des répercussions importantes pour
le patient. Va t-il trouver dans son entourage, les res-
sources lui permettant de gérer les transformations
imposées par la greffe de moelle
?
L’information peut
être alors une réponse aux besoins du malade.
Notre étude s’est appuyée sur des questionnaires
adressés à 55 adultes allogreffés. Les résultats ont
permi de mettre en évidence le moment le plus pro-
pice
à l’information, la personne la plus apte à la
donner, le contenu précis et la manière la plus adap-
tée aux besoins du patient.
From a legislative point of view, the allograft of bone
marrow is considered as an organ transplant.
It
consists
in
«replacing
a diseased or
deficient
marrow
with a healthy marrow removed on a compatible
living
donor.»
This treatment has
significant
repercussions
for the
patient. Will he find, in his
circle,
the
resources
which Will enable him to face the changes imposed
by the marrow graft? The information
cari
then be a
way to meet the needs of the patient.
Our study is based on questionnaires sent to 55
adults who underwent an allograft. Thanks to the
results, we
could
highlight the most favourable
moment for information, the person most capable of
giving it, the precise content and the way best suited
to the needs of the patient.
Mots Clés : Information, Allogreffe de moelle
osseuse, Ressource.
Key words : Information, Allograft of bone marrow,
Resource.
Recherche en soins infirmiers
No
55
-
Décembre 1998

ECHERCHE
L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR
ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE
INTRODUCTION
La greffe de moelle osseuse est un traitement long et
lourd pour lequel nous pressentions l’importance des
conséquences physiques et psychologiques pour le
patient. En effet, les conditions d’hospitalisation et
l’isolement de la famille sont des facteurs de stress évi-
dents.
Le maintien pour quelques mois en environnement sté-
rile puis protégé, entraîne une séparation longue des
proches. Elle implique une mobilisation plus impor-
tante des soignants.
L’information peut, alors, s’avérer être non seulement
un prétexte à la communication, mais également un
moyen de donner des repères au malade.
Notre objectif est, alors, de donner une information
personnalisée et adaptée aux besoins du patient pour
lui permettre de faire face à sa nouvelle situation. Nous
avons donc envisagé différents cadres conceptuels :
-
d’un point de vue médical, nous avons défini ce que
sont la moelle osseuse et la greffe de moelle!fôle,
déroulement médico-technique);
-
au niveau infirmier, nous avons mis en évidence les
diagnostics infirmiers en matière de greffe de moelle
osseuse. Des domaines ont été envisagés : physique,
psychologique, rôle socio-familial et professionnel ;
-d’un point de vue psychologique, les moyens de faire
face et les ressources des patients sont évoqués;
-
au niveau juridique, nous avons réalisé un bilan des
droits des malades et devoirs des soignants en matière
d’information ;
-
nous avons ensuite tenté de délimiter les critères
d’une information aidante.
Cette démarche nous amène à poser plusieurs hypo-
thèses que nous tâcherons de vérifier. Nous envisa-
geons l’information comme une ressource, une aide
pour le futur allogreffé de moelle osseuse. Dans cette
mesure, il apparaît qu’une information précoce laisse
plus de temps au patient pour s’adapter et que, plus
celui-ci possédera d’éléments, plus il aura de res-
sources pour faire face à sa nouvelle situation. Enfin,
pour favoriser la prise en charge du futur greffé et pour
l’aider à mobiliser les ressources nécessaires, il est
important d’associer les proches aux moments d’infor-
mation.
CHAPITRE 1
1. OBJET DE L’ÉTUDE
1
.l.
Problématique
Nos préoccupations et celles des équipes soignantes
sont liées aux difficultés rencontrées sur le terrain. Les
greffés posent de nombreuses questions, à plusieurs
équipes différentes. Le personnel évoque le manque de
temps pour informer le patient, ainsi que le manque de
connaissances
(cc
je ne dis pas car je ne sais pas
))).
En
outre, nous nous trouvons dans l’impossibilité d’éva-
luer ce que le malade sait. Est-il suffisamment informé
1
Quelles informations lui donner pour l’aider
?
Faut-il
informer aussi les proches
?
Nous avons recherché les documents qui pouvaient
répondre à ces attentes. II existe de nombreux livrets
d’information aux patients aplasiques. Des travaux ont
été réalisés afin de définir les différents stress liés à la
greffe de moelle et évaluer les réactions de ces malades
(M. LUSSIER, 1984). Cependant, nous n’avons retrouvé
aucune publication sur des travaux concernant les
informations qui pourraient aider les greffés de moelle
osseuse.
Notre champ d’investigation s’est limité à la population
des greffés de TOULOUSE, mais elle peut intéresser
tous les patients ayant reçu une greffe allogénique. La
progression du nombre de greffes effectuées donne une
dimension particulière à ce problème. Toutes les per-
sonnes qui vont évoluer autour du patient sont concer-
nées et impliquées par l’information : familles, person-
nel soignant intra et extra-hospitalier.
1.2. Thème
Ce travail est basé sur l’expérience d’anciens greffés de
moelle osseuse. Nous avons dégagé de cette dernière
l’impact de l’information apportée par les soignants.
Ce sujet peut avoir une influence importante dans la
pratique des Soins Infirmiers. Outre la possibilité de
réfléchir à la pratique de notre rôle éducatif, il peut
amener à l’élaboration de nouveaux outils d’informa-
tion et à l’amélioration des conditions dans lesquelles
elle est dispensée. Cette démarche permettrait dans un
premier temps de savoir où en sont les patients par rap-
32
Recherche en soins infirmiers N” 55
-
Décembre 1998

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR
ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE
port aux informations données. Une meilleure prise en
charge à l’hôpital et au domicile pourrait être alors
assurée. Ces derniers éléments peuvent être, éventuel-
lement, des pistes de réflexions ultérieures.
2. CADRE CONCEPTUEL
2.1. La moelle osseuse
«C’est un organe indispensable à la survie. La moelle
osseuse est responsable de la fabrication du sang et du
système immunitaire
»
(Pr E. GLUCKMAN, 1986, p.29).
Elle est située au niveau des os longs et des os plats.
Elle est le lieu de synthèse des cellules circulant dans le
sang. II s’y produit, en effet, une prolifération de cel-
lules mères appelées cellules souches pluripotentes. En
se divisant, elles donnent naissance à d’autres cellules
souches pluripotentes ainsi qu’à d’autres éléments qui
vont se multiplier. Après maturation et passage dans le
sang, ils donneront des cellules sanguines matures et
différenciées. Ce phénomène de division et de matura-
tion est appelé Hématopoïèse.
Ces cellules, lors de leur maturation, vont acquérir des
compétences particulières. Les hématies vont assurer le
transport de l’oxygène vers les différents tissus. Les pla-
quettes maintiennent un équilibre entre le risque
hémorragique et le risque de thrombose. Les globules
blancs sont chargés de la lutte contre les infections.
Sont aussi fabriquées des cellules dites immunocompé-
tentes : les lymphocytes. Ceux-ci vont permettre à l’or-
ganisme de reconnaître des cellules qui ne lui appar-
tiennent pas et de détruire ces éléments étrangers.
La moelle osseuse, par le rôle hématopo’iétique qu’elle
exerce, est un organe primordial. Toute déficience dans
son fonctionnement peut être lourd de conséquences.
Selon les cellules atteintes et le siège de la proliféra-
tion, on distingue plusieurs pathologies
hématolo-
giques. Nous pouvons les différencier selon quatre
groupes
-
les lymphomes malins,
-
les leucémies aiguës,
-
les syndromes myéloprolifératifs,
-
les syndromes lymphoprolifératifs.
2.2. La greffe de moelle osseuse
Définition
Une allogreffe de moelle osseuse consiste à
«
rem-
placer une moelle malade ou déficiente par une
moelle saine prélevée sur un donneur compatible»
(Dr H. ESPEROU-BOURDEAU,1994, p. 1851).
Cette greffe allie plusieurs particularités :
-
c’est une technique simple, il s’agit de réinjecter par
voie intraveineuse une moelle prélevée par ponction
osseuse. Elle sera ensuite filtrée et concentrée avant
la transfusion
-
c’est une greffe qui pose des problèmes importants du
point de vue immunologique. On introduit effective-
ment chez un receveur des cellules immunitaires
d’un
donneur. Cela peut entraîner le phénomène suivant :
les cellules du donneur reconnaissent celles
du receveur comme étrangères et induisent une réac-
tion appelée «maladie du greffon contre
l’hôte»
(G.V.H. = Graft Versus Host). Cette réaction peut être
aujourd’hui encore une cause d’échec de la greffe de
moelle; l’existence d’un donneur compatible dans la
fratrie est la condition optimale pour une greffe. Lors
d’absence de donneur familial, une recherche peut être
effectuée au sein des fichiers de donneurs volontaires.
-
lorsque la greffe allogénique de moelle est établie
durablement, elle aboutit à un chimérisme
hémato-
logique. Les cellules qui circulent chez le receveur
sont celles du donneur. On peut observer, selon les
cas, la présence de marqueurs chromosomiques
sexuels différents et le changement de groupe san-
guin A, B, 0.
Déroulement de la greffe de moelle
La greffe de moelle osseuse est le traitement de choix lors
de nombreuses pathologies hématologiques. Nous pou-
vons diviser ce traitement en quatre étapes spécifiques :
-
la première est la phase de bilan et de conditionne-
ment à la greffe. II s’agit de s’assurer que le patient est
prêt à recevoir cette moelle. Les médecins évaluent
alors le rapport risque
/
bénéfice. Le conditionnement
pré-greffe peut varier en fonction de la pathologie de
départ, mais associe généralement chimiothérapie et
radiothérapie. Le but est de supprimer les possibilités
de rejet de greffe et, dans le cas des leucémies, de
détruire toutes les cellules malades résiduelles.
-
la seconde étape concerne la greffe elle-même et la
période à l’unité stérile. Elle dure environ de JO (jour
de la greffe) à
J~O
post-greffe. La moelle prélevée le
33
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998

jour même sur un donneur sain, sera filtrée puis
injectée sur une voie veineuse périphérique. Suit,
alors, une période d’aplasie profonde pendant
laquelle les risques principaux seront infectieux et
hémorragiques. Vers j15, nous observerons les pre-
miers signes de prise de moelle (amorce de sortie
d’aplasie) accompagnés des premières manifestations
de la réaction du greffon contre l’hôte. II s’agit d’une
particularité de la greffe de moelle : ce n’est pas le
receveur qui rejette l’organe greffé, mais les cellules
greffées qui rejettent le receveur.
-
la troisième période concerne le passage en chambre
protégée et la convalescence. Elle s’étend de
J31
à
Jl
00. Durant cette période, le greffé apprend à se sur-
veiller et à respecter certaines règles indispensables
d’hygiène, d’alimentation, de prise du traitement...
Les risques principaux à cette étape sont : la réactiva-
tion d’une G.V.H., les infections liées à des germes
tels que le C.M.V., le pneumocystis, l’aspergillus,
I’herpès. Le greffé est surveillé en hospitalisation de
jour et est réhospitalisé au moindre signe critique.
-
la dernière étape se situe après la sortie de l’hôpital.
C’est une période longuement espérée par le patient.
Les difficultés déjà citées restent toujours présentes.
S’ajoutent principalement le risque de rechute de la
maladie hématologique qui survient le plus souvent
dans l’année qui suit la greffe.
Retentissement sur la personne soignée
On ne peut pas envisager la greffe de moelle sous le
seul angle technique et médical. La greffe induit des
changements au niveau de la personne «entité phy-
sique et psychologique», et aussi au niveau de
I’indi-
vidu doté d’un rôle familial, social et professionnel.
Les modifications sont d’ordre physiques et physiolo-
giques : alopécie, amaigrissement, altération de I’inté-
grité de la peau et des muqueuses, risques d’insuffi-
sance rénale, hépatique et respiratoire.
Elles entraînent une perturbation de l’image corporelle.
Le patient manifeste sa peur liée à la prise de
conscience qu’un échec peut survenir. Le doute majore
son stress, son angoisse : il ne prend plus d’initiatives,
ne fait plus de projets, il a le sentiment de ne plus être
maître de sa vie. II est à la disposition des soignants, de
la structure hospitalière.
Des liens particuliers peuvent apparaître entre le rece-
veur et le donneur lorsque celui-ci appartient à la fra-
trie. Une connivence s’installe, parfois au détriment du
reste de la famille qui se sent exclue de la relation.
La longue absence du patient au sein de la structure
familiale et professionnelle, va l’exclure d’un groupe
qui s’est modifié sans lui. II n’en est plus le pilier. Le
patient greffé va vivre cela en spectateur : il se sent
dépossédé du rôle qu’il s’attribuait auparavant. La vie
s’est poursuivie sans lui. Cette «mise en veilleuse» va
se prolonger avec un sentiment d’incompréhension de
part et d’autre.
Les incidences au niveau du couple vont être majorées
du fait de la perturbation de la sexualité. Elle est due
d’une part aux effets du traitement (stérilité, diminution
de la libido), et d’autre part à la modification de
l’image corporelle.
Tous les phénomènes cités vont aboutir à une remise
en question complète de l’individu et des valeurs aux-
quelles il s’accroche, et perturbent l’estime de soi.
C’est dans tout ce ressenti complexe et douloureux
qu’il va appréhender sa sortie, nécessitant une aide de
la part du soignant. L’information peut-elle apporter
une réponse à ses difficultés
?
2.3. l’information
L’information au malade est insérée dans le contexte
de la communication. Or, un système de communica-
tion
n’est jamais parfait, particulièrement en
Hématologie où les problèmes soulevés sont liés à la
nature même de cette spécialité : la greffe de moelle
osseuse est le seul espoir face à une mort proche et
lointaine à la fois. Le malade est le récepteur d’un
double message : d’une part l’espoir affiché et d’autre
part une mort annoncée. La communication ne sera
jamais idéale : la qualité même du message émis n’a
pas pour corollaire la qualité du message reçu, car
I’in-
formation ne tombe jamais en terrain neutre.
Si les mots ont un sens, si les non-dits ont leur sens, ils
vont provoquer chez le patient des réactions diverses.
Quelles sont elles
?
La quête d’information réduit le sentiment d’incerti-
tude : pour CASSILETH
(1980),
les patients qui souhai-
tent le maximum d’informations, bonnes ou mauvaises,
ont davantage d’espoir en la guérison que ceux qui
n’en souhaitent pas. L’information renforcerait l’espoir
aux dépens des incertitudes.
l’information permet de regagner le contrôle sur les
évènements : le sentiment de perte de contrôle déci-
sionnel sur les évènements paraît corrélé aux senti-
ments de dépendance, abandon, vulnérabilité, incerti-
tude du malade.
L’angoisse est générée par le haut degré d’incertitude
lors du départ au domicile : clairement informé, le
34
Recherche en soins infirmiers
No
55
-
Décembre 1998

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR
ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE
malade va pouvoir reprendre une forme de maîtrise sur
son corps et son histoire, en n’étant plus simple objet
de soin.
C’est cette maîtrise là, parfois imaginaire, qui l’aidera
«à
lutter contre l’angoisse, ce qui procure un apaise-
ment, même si cela ne suffit pas à éliminer la souf-
france» (Y. BRUNO, 1990).
l’information est le support d’une relation : le malade
va pouvoir exprimer ses sentiments dans un climat
empathique. L’expression empathique des sentiments
faciliterait l’ajustement à la maladie.
Le malade essaie de trouver un nouveau sens à sa
maladie pour mieux la contrôler. La relation
empa-
thique permet de découvrir à deux des solutions qui
n’apparaissent pas jusqu’alors au patient seul : I’infor-
mation mobilise les ressources et la volonté du malade.
Dans la notion d’information, s’inscrit le sens du dia-
logue. En fait, l’information véridique
«
n’est pas une
fin en soi, c’est un des moyens d’établir une relation
authentique de collaboration sécurisante, ce qui est
nécessaire au traitement des personnes en détresse
»
(B. HCERNI, 1995).
L’information jouera un rôle croissant dans la relation
au patient, si l’on considère mieux la qualité de vie de
ces personnes malades.
II existe de nombreux obstacles à l’information :
-d’ordre structure1 : les locaux sont-ils adaptés
?
-d’ordre organisationnel : y a t-il suffisamment de
temps pour les soins d’éducation et de prévention à
coté des soins techniques
3
Prépare t-on la sortie du
malade
?
-
d’ordre pragmatique : les techniques de communica-
tion peuvent-elles uniquement s’acquérir par la for-
mation
?
-d’ordre relationnel : certaines difficultés tiennent à la
personnalité des malades, altérée ou non par la mala-
die. Tous les patients n’ont pas le désir ou la capacité
de participer à la décision médicale qui pourtant les
concerne.
Les soignants, quant à eux, sont confrontés à une
double contrainte, liée au message transmis : informer
nécessairement d’une part, et garder l’espoir d’autre
part. La distance pour aider le malade est difficile à
définir.
«
Un médecin informe bien un malade lorsque celui-ci
est prêt à l’entendre
»,
mais la communication n’est pas
simple car
«
le médecin doit dire ce qu’il n’a pas envie
de dire à quelqu’un qui n’a pas envie de l’entendre»
(N. ALBY, 1991). II faut évaluer l’information néces-
saire à chaque patient. La hiérarchie doit faire place à
un travail d’équipe.
II n’y a pas de règle entre «tout dire
»
et
«
ne rien dire»,
il y a l’information nécessaire mais forcément blessante
pour les uns, restrictive pour les autres. II faut un grand
respect des malades.
Les malades vont mieux quand ils peuvent élaborer
une vérité supportable pour eux. L’information doit
préserver la relation soignant-malade et être suppor-
table pour chacun d’eux. A l’espoir affiché de conve-
nance, de façade, viendra se substituer une relation
plus authentique de confiance.
Au piège de la question faut-il dire la vérité au malade
1
s’agissant de maladie grave, toute parole peut être une
bombe qui explose en faisant beaucoup de mal autour
d’elle. Ainsi, l’information a ses exigences.
Selon TATOSIAN (1990), l’information devrait être
-adaptée : à la situation du moment; au malade selon
ce qu’il est, selon ses besoins fondamentaux et ce
qu’il attend des soignants.
-
cohérente : dans le temps, au moment favorable pour
le patient; au niveau des différentes équipes de soins :
cela nécessite une grande disponibilité, une sou-
plesse d’adaptation et un travail de transmission
constant de toute l’équipe.
-progressive : les personnes ont besoin de temps. II
faut leur laisser le temps d’assimiler, et selon les
besoins, répéter l’information.
-
non désespérante : l’information est raccordée au
vécu, à l’histoire de chacun, ce qui lui donne son
sens et cette vérité là devient une vérité supportable
pour le malade lui-même.
-
partagée : l’information donnée au malade doit être
de façon égale donnée aux familles. L’information est
un travail d’équipe et pour cela, il faut former les
informateurs et étudier le fonctionnement des institu-
tions de soins et de leurs partenaires extra-hospita-
liers.
Ces critères d’exigence de l’information vont nous per-
mettre d’analyser les besoins des patients, futurs gref-
fés de moelle osseuse.
35
Recherche en soins infirmiers
No
55
-
Décembre 1998
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%