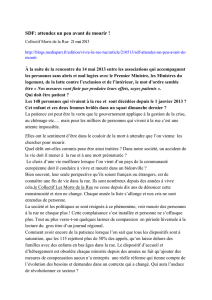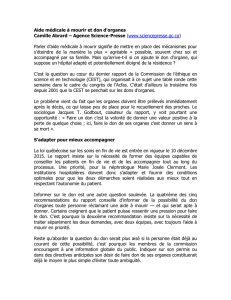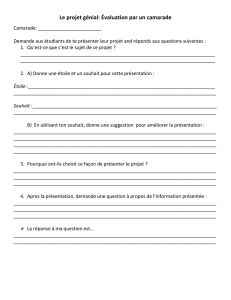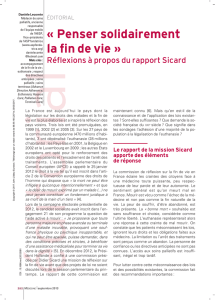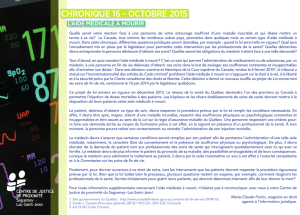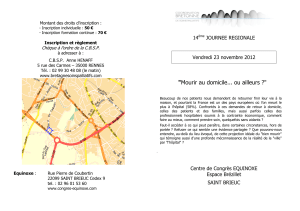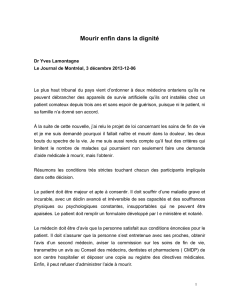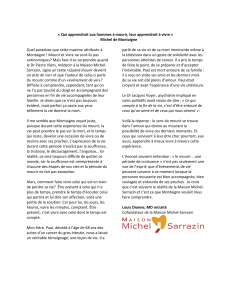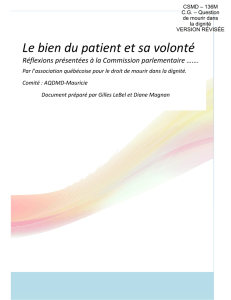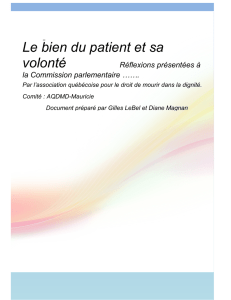Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

Les facteurs facilitant
le maintien à domicile
du patient en fin de vie
État des lieux, 81 % des Français
souhaiteraient pouvoir mourir à domicile
Selon une étude sur la qualité de la fin de vie menée dans quarante pays en
2010, la France se situe en douzième position, dix-septième position pour la
qualité de la fin de vie et vingt-troisième position pour l’accès aux soins
palliatifs [1].
Selonlecentred’épidémiologie sur les causes médicales de décès en
France (CépiDC) en 2008, 58 % des décès sont survenus en établissement
hospitalier, 27 % à domicile et 11 % en maison de retraite. La majorité
des Français, 81 % selon un sondage sur un échantillon de 1 500
personnes bien portantes en 2010, souhaiteraient pouvoir mourir chez
eux [2]. Il existe donc véritablement un contraste franc entre le désir des
malades de mourir chez eux et la réalité d’une majorité de décès à
l’hôpital.
Un médecin généraliste accompagne en moyenne un à trois patients en fin
de vie chaque année, la proportion de médecins généralistes formés aux
soins palliatifs étant encore faible [1]. Ces soins demandent souvent
beaucoup d’énergie, de temps, et n’ont pas de cotation spécifique dans le
système de rémunération à l’acte.
Selon les statistiques du CépiDC [1], les hommes meurent plus à l’hôpital que
les femmes. En maison de retraite, il y a logiquement plus de décès de
femmes, celles-ci étant les principales occupantes de ces lieux. Les personnes
mariées meurent plus souvent à l’hôpital que les divorcées et les célibataires.
Les personnes âgées de plus de 90 ans meurent plus à domicile que les plus
jeunes.
Les décès à l’hôpital concernent plus les patients atteints de cancers, AVC,
maladies respiratoires, digestives et neurologiques dégénératives (SLA,
SEP) ; les décès à domicile concernent plus les malades atteints de
maladies cardio-circulatoires, maladie de Parkinson, troubles psychiatri-
ques. On peut expliquer ceci par la technicité plus importante et les
possibilités thérapeutiques accrues pour les cancers, la difficulté parfois de
passer en « phase palliative ». Le plan gouvernemental « AVC » a
augmenté la prise en charge hospitalière de ces maladies, et donc les
décès hospitaliers.
Pouvoir permettre à un proche de rester chez lui jusqu’au bout, si c’est son
souhait, représente un engagement moral qui n’est pas toujours facile à
tenir tant il est difficile de voir souffrir quelqu’un qu’on aime, que ce soit une
souffrance physique, psychique, existentielle...
Face à ce constat nous avons voulu étudier quels pourraient être les facteurs
favorisant ou limitant les possibilités de fin de vie à domicile chez des
patients atteints de maladie chronique. Nous avons réalisé une étude
descriptive des facteurs influant la fin de vie et le décès à domicile chez
95 patients décédés en Gironde en 2012.
Recherche en soins primaires
VIE PROFESSIONNELLE
ÉDECINE
86 MÉDECINE Février 2016
François Pétrègne, Yves Montariol,
Catherine Prabonneau, Sylvie
Duhamel, William Durieux
Universit
e de Bordeaux, D
epartement de
m
edecine g
en
erale, 146 rue L
eo Saignat,
33000 Bordeaux
Tir
es à part : F. P
etrègne
Résumé
Selon le centre d’épidémiologie sur les
causes médicales de décès en France en
2008, 58 % des décès sont survenus en
établissement hospitalier, 27 % à
domicile et 11 % en maison de retraite.
La majorité des Français souhaiteraient
pouvoir mourir chez eux : 81 % selon
un sondage sur un échantillon de 1 500
personnes bien portantes en 2010. Il
existe donc véritablement un contraste
franc entre le désir des malades de
mourir chez eux et la réalité d’une
majorité de décès à l’hôpital.
Mots clés
accompagnement de la fin de la vie ;
directives anticipées.
Abstract. Factors facilitating the
patient to stay at his home in the end
of his life
According to the Epidemiology Centre
on the medical causes of death in
France (INSERM) in 2008, 58% of
deaths occurred in hospital, 27% at
home and 11% in retirement home.
The majority of the French would like
to die at home: 81% according to a
survey on a sample of 1,500 people in
good health in 2010 [2]. There is
therefore a truly sharp contrast
between the desire of patients to die at
home and the reality of the majority of
deaths at hospital.
Key words
hospice care; advance directives.
DOI: 10.1684/med.2016.23
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Matériel et méthode
Nous avons réalisé une enquête rétrospective en inter-
rogeant un échantillon de médecins généralistes de
Gironde sur leur dernier patient décédé [3].
La méthode retenue a été une analyse quantitative des
données d’un questionnaire élaboré suite à une revue de
la littérature et des tests sur des médecins témoins.
L’échantillon comportait 95 patients, 57 décédés à
domicile et 38 à l’hôpital. L’analyse statistique visait à
comparer les patients décédés à domicile et à l’hôpital
selon certains critères pouvant influer sur le lieu de décès.
Nous avons choisi de ne pas différencier les domiciles
privés des maisons de retraites, celles-ci étant le véritable
lieu de vie de la personne âgée.
L’objectif principal de cette enquête était donc de mettre
en évidence des éléments pouvant expliquer « le con-
traste » entre la volonté d’une majorité de Français de
mourir chez eux et la prédominance des décès hospitaliers.
L’objectif secondaire était de pouvoir faire des proposi-
tions concrètes pour améliorer les souhaits des individus.
Nous voulions avant tout pouvoir faire des propositions
afind’améliorer les conditions de prise en charge des
patients en fin de vie, et certains paramètres nous sont
apparus peu modifiables : caractères sociologiques (sta-
tut matrimonial, isolement, origine ethnique, niveau
socio-économique et catégorie socio-professionnelle),
caractères liés à la maladie, l’évolution de la société dans
son approche de la mort...
Sur un total de 1 410 médecins généralistes en Gironde,
193 ont été tirés au sort. Après contact téléphonique, 167
ont accepté de participer. Le recueil de données s’est
effectué entre le 17 février et le 7 mars 2012.
Résultats
Sur 167 envois, nous avons reçu 80 questionnaires papier et
20 réponses par Internet (tableau 1). Le taux de réponse est
Tableau 1. Circonstances du décès en fonction du contexte et des souhaits exprimés des patients concernant leur fin de vie
Variable Modalité Effectif OR 95 % IC
Formation en SP Médecin formé ou non 33/62 0,58 0,25-1,38
Distance cabinet–hôpital
y
<10 km / > 10 km 60/35 2,56 1,09-6,05
Âge du patient
y
> 65 ans/31-64 ans 94 3,87 1,37-10,94
Genre du patient Femme/Homme 94 1,38 0,60-3,15
Durée d’évolution de la maladie >6 mois/<6 mois 95 0,90 0,33-2,44
Maladie cancéreuse
y
Oui/Non 61 0,40 0,16-0,99
Maladie neurologique Oui/Non 17 0,94 0,32-2,74
Maladie cardiovasculaire Oui/Non 28 1,61 0,64-4,08
Souhait du malade sur son lieu de décès
y
Domicile/Hôpital ou pas
de souhait exprimé
60/34 8,43 3,02-25,47
Souhait du malade sur son lieu de décès
y
Domicile/Pas de
souhait exprimé
60/27 5,99 2,04-18,74
Souhait du malade sur son lieu de décès Domicile/Hôpital 60/7 INF *
Présence de famille, entourage Oui/Non 83/12 2,35 0,69-8,04
Présence d’infirmiers Oui/Non 67/28 0,77 0,31-1,93
Patient en HAD Oui/Non 22/73 1,58 0,58-4,34
Patient suivi par un RSP Oui/Non 23/72 0,52 0,20-1,34
Présence d’aides-soignants Oui/Non 23/72 0,66 0,25-1,69
Présence d’auxiliaire de vie/aide-ménagère Oui/Non 38/57 0,86 0,38-1,99
Présence d’un kinésithérapeute Oui/Non 40/55 0,84 0,36-1,92
Présence d’un psychologue Oui/Non 6/89 0,65 0,12-3,40
Consignes en cas d’absence Oui/Non 63/28 0,79 0,31-1,99
Téléphone personnel du MT Oui/Non 19/76 0,90 0,32-2,49
Trousse d’urgence à domicile Oui/Non 14/81 0,87 0,28-2,75
Prescriptions anticipées personnalisées Oui/Non 54/41 0,93 0,41-2,13
y
Variables pour lesquelles il y a une différence significative entre les groupes « décès à domicile » et « décès à l’hôpital ».
*INF : la totalité des patients souhaitant décéder à l’hôpital y étant morts, il n’y a aucun cas contraire (mort à domicile chez un patient souhaitant
mourir à l’hôpital), et dans cette étude le calcul de l’Odds ratio n’était pas possible.
MÉDECINE Février 2016 87
VIE PROFESSIONNELLE
Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

donc de 59,9 %. Après élimination des réponses non
exploitables, il restait 95 réponses. Les 95 médecins
interrogés ont en moyenne 52,9 ans, il s’agit d’hommes
dans 78,9 % des cas, et de femmes dans 21,1 %, dont 63,2 %
d’entreeuxsontinstallésàmoinsde10kmdel’établisse-
ment hospitalier le plus proche, et 36,8 % à plus de 10 km.
L’étude a concerné 52,1 % de femmes et 47,9 %
d’hommes. Aucun patient concerné par cette enquête
n’était âgé de moins de 30 ans, 21,3 % avaient entre 31 et
64 ans et 78,7 % avaient plus de 65 ans.
60 % des patients sont décédés à domicile ou en maison
de retraite (soit 57 cas) et 40 % dans un établissement
hospitalier (soit 38 cas).
Les causes de décès
Les patients décédés étaient atteints de cancer dans
64,2 % des cas, de maladie cardiovasculaire dans 29,5 %
des cas, de maladie neurologique dans 17,9 % des cas et
d’une autre pathologie dans 5,3 % des cas. Les autres
maladies citées étaient : l’insuffisance respiratoire, mixte
ou post-BPCO.
La durée d’évolution de leur maladie avant le décès a été
de moins de 6 mois dans 22,1 % des cas, et plus de 6 mois
dans 77,9 % des cas.
Concernant leur souhait sur leur lieu
de décès
70,6 % des patients (67) s’étaient exprimés, majoritaire-
ment pour finir leurs jours chez eux dans 63,2 % des cas, à
l’hôpital dans 7,4 % des cas. 29,4 % des patients (28) n’ont
pas exprimé leur volonté. Tous les patients souhaitant
mourir à l’hôpital (7) y sont décédés. 78 % des patients (74)
souhaitant mourir à domicile y sont décédés. Quant à ceux
qui n’ont pas exprimé de volonté particulière, ils sont morts
àl’hôpital pour 64 % d’entre eux (18).
Concernant leur accompagnement
à domicile
87,4 % des malades étaient entourés de membres de la
famille et/ou d’un entourage amical, 24,2 % étaient suivis
par un réseau ou une équipe mobile de soins palliatifs,
23,2 % bénéficiaient de l’HAD.
Les circonstances de l’hospitalisation
–Sur 38 hospitalisations, le décès est survenu au bout de
moins d’une semaine dans 59,5 % des cas, et plus d’une
semaine dans 40,5 % des cas.
–Dans 68,4 % il y avait des symptômes difficiles à
contrôler, dans 52,6 % une souffrance des aidants
familiaux, dans 13,2 % le patient était trop isolé, dans
2,6 % il y a eu des difficultés à trouver des collaborateurs
paramédicaux, dans 10,5 % ce sont d’autres raisons qui
ont motivé l’hospitalisation (nécessité d’amputation, AVC
et altération importante de l’état général, arrêt cardio-
respiratoire survenu tôt dans l’évolution de la maladie,
isolement du médecin traitant, nécessité de ponctions
pleurales itératives, détresse respiratoire).
–Les patients porteurs de cancer étaient les plus
nombreux, et sont morts autant à domicile qu’àl’hôpital
(odds ratio : 0,40 ; IC 95 % : 0,16-0,99). En revanche les
patients qui n’avaient pas de cancer sont beaucoup plus
souvent morts à domicile. Dans cette étude, les patients
cancéreux avaient donc moins de chance de mourir à
domicile que les patients non cancéreux.
Les patients ayant exprimé le souhait de mourir à
domicile avaient beaucoup plus de chance de mourir
effectivement chez eux que ceux n’ayant pas exprimés de
souhait.
Le fait d’exprimer un souhait de lieu de décès est donc
dans cette étude un critère primordial, puisque tous les
patients souhaitant mourir à l’hôpital y sont décédés, et
que la grande majorité de ceux souhaitant finir leurs jours
à domicile ont pu le faire.
Discussion
Malgré le souhait d’une majorité de Français de mourir à
domicile (EHPAD inclus), ils ne sont finalement que
37,1 % à le réaliser en 2010) [4].
Les médecins généralistes sont impliqués dans la gestion
de la fin de vie à domicile ; ils suivent une à trois situations
en moyenne par an [5].
Une récente revue de la littérature a analysé les facteurs
influençant le lieu de décès qui peuvent être classés en
trois catégories :
–des facteurs sociodémographiques et personnels (sexe,
âge, état matrimonial, soutien de la famille, préférence
du patient, niveau d’études) ;
–des facteurs épidémiologiques (la cause du décès,
l’évolution de la pathologie, le statut fonctionnel du
patient) ;
–des facteurs « écologiques » (caractère rural/urbain,
densité hospitalière, niveau d’équipement en maison de
retraite et offre de soins de proximité) [6].
D’autres facteurs possiblement associés au lieu de décès
de patients cancéreux ont été rapportés : les croyances, la
culture, l’ethnie, la relation avec les soignants, le type de
tumeur, le soutien familial, le support sanitaire [7].
La préférence du patient pour le domicile était l’un des
facteurs associés au décès au domicile [8]. Selon une revue
de la littérature publiée en 2000, la préférence des
patients pour le domicile comme lieu de décès variait de
48 à 100 % [6].
Dans notre étude nous avons mis en évidence des
éléments qui influencent le décès à domicile :
–le souhait exprimé par le malade de finir ses jours à son
domicile ;
–un patient âgé de plus de 65 ans ;
Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie
88 MÉDECINE Février 2016
VIE PROFESSIONNELLE
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

–un patient n’étant pas atteint de cancer ;
–un cabinet médical peu éloigné du centre hospitalier le
plus proche (moins de 10 km) ;
–la présence de la famille ;
–un patient en HAD ;
–le souhait exprimé par le malade de finir ses jours à son
domicile.
Nous avons vu que selon un sondage de 2010 [2]
s’intéressant à des personnes bien-portantes, 82 % des
Français souhaitaient finir leurs jours chez eux. Mais il a
déjà aussi été démontré que la volonté de mourir chez soi
pouvait varier selon les stades de la maladie [9] et les
conditions de la fin de vie : disponibilité d’aidants
familiaux, symptômes difficiles à contrôler, angoisse...
Il est important de recueillir le souhait du patient
notamment dans les directives anticipées [5]. Dans notre
étude, les patients qui avaient exprimé le désir de mourir
chez eux avaient quasiment 6 fois plus de chance de voir
ce souhait exaucé que ceux qui n’avaient pas fait part
d’un souhait particulier et qui sont morts à l’hôpital dans
63 % des cas.
Un patient âgé de plus de 65 ans
Dans notre étude, les patients âgés de plus de 65 ans,
avaient presque 4 fois plus de chance de mourir chez eux
que les patients plus jeunes.
Pour autant, dans la littérature, l’âge ne semble pas être
un facteur majeur influençant les lieux de décès sauf pour
les 90 ans et plus où une majorité d’entre eux meurent à
domicile [2].
On peut penser que la mort d’un proche est certainement
plus facile à accepter lorsque celui-ci est âgé, ceci étant
dans l’ordre des choses, et pour les patients plus jeunes,
l’entourage sollicite les médecins pour les hospitaliser.
Un patient atteint de cancer
Notre étude a retrouvé que le fait d’être atteint de cancer
est un facteur favorisant le décès à l’hôpital. Nous
n’avions pas fait de différence entre les différents
cancers. Dans les études à notre disposition, les résultats
sont variables.
72,8 % des patients présentant une tumeur maligne
décèdent à l’hôpital contre 24,5 % à domicile [2].
L’âge en général plus jeune des patients cancéreux peut
également expliquer une hospitalisation terminale,
l’entourage ayant plus de difficulté à accepter la mort
de leur proche, et souhaitant faire « tout ce qui est
possible », même à la fin.
On peut aussi penser que l’évolution des cancers est
souvent plus rapide que celle des autres pathologies. Il est
donc plus difficile d’anticiper la prise en charge et de
prévoir un maintien ou un retour à domicile dans les
meilleures conditions.
Un cabinet médical peu éloigné
du centre hospitalier le plus proche
(moins de 10 km)
Notre étude a retrouvé que le fait d’habiter à proximité
d’un hôpital favorisait le décès à domicile. Les patients
des médecins situés à moins de 10 km d’un hôpital
avaient en effet environ 2,5 fois plus de probabilité de
mourir chez eux que les autres. Dans d’autres études on
retrouve des résultats inverses [10].
On peut supposer que l’entourage familial serait plus
susceptible de s’occuper de son proche à domicile quand il
se sentirait rassuré de la proximité d’un hôpital qui
pourrait prendre le relais en cas d’épuisement. Ce
point reste cependant à confirmer par des études
complémentaires.
Présence de la famille
Il semble logique qu’il y ait plus de facilité à finir ses jours
chez soi lorsqu’on est entouré. Cet élément a déjà été
prouvé, avec certaines nuances selon les études [11].
Différentes études soulignent l’effet positif de vivre avec
plusieurs personnes chez soi, c’est-à-dire pas seulement
en couple [12]. Une mésentente familiale, des difficultés
de communication entre soignants et entourage, une
méconnaissance ou un déni du pronostic, une famille
éloignée géographiquement sont des facteurs limitant le
maintien au domicile [13].
Les proches deviennent aidants ; sans eux rien n’est
possible avec un investissement jusqu’àl’épuisement ; ils
sont au cœur de l’accompagnement de la fin de vie à
domicile [4].
Patient en HAD
L’HAD médicalise le domicile et impose un rythme [14].
L’entourage peut quitter son rôle de soignant, et mieux
profiter des derniers moments de leur proche mourant,
en évitant l’épuisement. Le malade et sa famille
ressentent une sécurité qui apaise ces moments difficiles
[15].
Grande et al.[16] ont montré que les utilisateurs de soins
à domicile sont plus susceptibles de finir leurs jours chez
eux que les non-utilisateurs.
Fort de cet éclairage le médecin généraliste pourra
choisir, comprendre, mettre tout en œuvre pour la
réussite de cette aventure dans l’accompagnement de
fin de vie.
C
onclusion
La relation médecin-malade est particulière en médecine
générale : au fil des ans se tisse une relation de personne
à personne, avec une connaissance profonde du patient,
qui amène le médecin à l’accompagner à domicile
Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie
MÉDECINE Février 2016 89
VIE PROFESSIONNELLE
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

jusqu’au bout selon ses souhaits, avec d’autant plus de
succès que le patient est âgé de plus de 65 ans et qu’il
n’est pas atteint de cancer [17].
La situation des patients en fin de vie est de nos jours
caractérisée par une complexité médico-psycho-sociale.
Il s’agit le plus souvent d’un travail de coordination,
collectif en équipe (patient en HAD et présence de la
famille), en continuité de la prise en charge « curative ».
Il est nécessaire d’anticiper et organiser la prise en charge
palliative à domicile afin de prévenir les hospitalisations
intempestives en cas d’urgence. Cet enchaînement
constitue un processus décisionnel qui comporte un
temps de délibération collégiale. « La délibération remet
en cause le risque d’une éthique de la conviction et nous
initie à une éthique de la discussion. »[5].
Ce type de pratique a aussi des répercussions positives
pour le médecin :
–Satisfaction d’avoir réalisé une tâche noble et utile,
d’avoir respecté un contrat moral avec le patient.
–Valorisation de la pratique médicale, travail enrichis-
sant sur le plan humain et personnel, par le partage du
même combat avec le malade, son entourage et les
collaborateurs.
–Reconnaissance de la famille.
Parler de la mort, écouter le malade, prévenir l’épuise-
ment de l’entourage, assurer la continuité de la prise en
charge, anticiper l’évolution de la maladie sont des
perspectives à développer dans cette prise en charge.
Chaque praticien choisira ses limites au maintien à
domicile en sachant que l’échec lorsqu’il survient peut
être lié à des conditions aléatoires, certains événements
intercurrents imprévisibles échappant parfois à la mise en
place des meilleures conditions. La modification de la
loi concernant la fin de vie irait dans le sens d’une
application plus importante des directives anticipées, et
renforcerait le rôle de la personne de confiance et ainsi le
choix du patient de mourir à domicile.
~Liens d’intérêts : les auteurs déclarent n’avoir aucun
lien d’intérêt en rapport avec l’article.
RÉFÉRENCES
1. Observatoire national de la fin de vie (ONFV). Fin de vie, un premier état des lieux.
2011. http://www.onfv.org/rapport-2011-un-premier-etat-des-lieux/.
2. Observatoire national de la fin de vie (ONFV). Fin d’un tabou ! La mort, la finde
vie, le deuil, ma mort, ça concerne et intéresse les Français. 2010. http://www.onfv.
org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport_ONFV_2011.pdf.
3. Prabonneau C. Facteurs favorisant la fin de vie à domicile chez des patients
atteints de maladies chroniques. Etude rétrospective quantitative auprès de 95
médecins généralistes de Gironde. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2013.
4. Observatoire national de la fin de vie. Rapport 2012. Vivre la fin de vie chez soi. La
Documentation Française, 2013. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/sto-
rage/rapports-publics/134000186.pdf.
5. Richard JF. Fin de vie à domicile. Rev Prat MG 2014 ; 916 : 166-7.
6. Gauthier G, Bernard E, Darrieux JC. Fin de vie à domicile et préférence pour un
lieu de décès : revue de la littérature. Exercer 2015 ; 118 : 52-60.
7. De Hennezel M. La mort intime. Paris : Robert Laffont, 1995.
8. Grimault T. La mort à domicile : étude d’une population de 73 patients décédés
au cours d’une hospitalisation à domicile [Thèse d’exercice]. Dijon : Université de
Bourgogne ; 2008.
9. Townsend J, Frank AO, Fermont D, Dyer S. Terminal cancer care and patients’
preference for place of death : a prospective study. BMJ 1990 ; 301 : 415-7.
10. Chvetzoff G, Garnier M, Pérol D, et al. Factors predicting home death for terminally
ill cancer patients receiving hospital-based home care : the Lyon comprehensive cancer
center experience. J Pain Symptom Manage 2005 ; 30 : 528-35.
11. Gomes B, Higginson IJ. Factors influencing death at home in terminally ill patients
with cancer : systematic review. BMJ 2006 ; 332 : 515-8.
12. McWhinney IR, Bass MJ, Orr V. Factors associated with location of death (home or
hospital) of patients referred to a palliative care team. Can Med Assoc J 1995 ; 152 :
361-7.
13. Vantomme C. Difficultés des médecins généralistes dans la prise en charge au
domicile de patients en soins palliatifs : enquête auprès de 268 médecins généralistes
dans le Val de Marne. [Thèse Médecine]. Paris-Est Créteil, 2007.
14. Lussignol-Beaupoil A. Soins palliatifs à domicile : le médecin généraliste et les
attentes de l’aidant [Thèse Médecine]. Lyon, 2010.
15. Lasserre H. Les besoins des proches de patients en soins palliatifs à domicile :
enquête auprès de quinze personnes après le décès d’un proche pris en charge
par l’Hospitalisation à domicile à Dax (Landes). [Thèse Médecine]. Grenoble,
2010.
16. Gran de GE, Addington-Hall J, Todd CJ. Place of death and access to home care
services : are certain patient groups at a disadvantage? Social Science and Medicine
1998 ; 47 : 565-79.
17. Le Taillandier de Gabory J-B. Le médecin généraliste et la fin de vie à domicile
[Thèse Médecine]. Bordeaux, 2001..
Les facteurs facilitant le maintien
à domicile du patient enfin de vie
Les patients âgés de plus de 65 ans ont presque 4 fois
plus de chances de mourir chez eux que les patients
plus jeunes.
Le fait d’être atteint d’un cancer est un facteur
favorisant le décès à l’hôpital.
Le fait d’habiter à proximité d’un hôpital (moins de
10 km) favoriserait le décès à domicile.
Les patients qui ont exprimé par avance le désir de
mourir chez eux ont quasiment 6 fois plus de chances
de voir ce souhait exhaussé que ceux qui n’avaient fait
part d’aucun souhait particulier.
Une application plus importante des directives anti-
cipées renforcerait le rôle de la personne de confiance
et ainsi le choix du patient de mourir à domicile.
Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie
90 MÉDECINE Février 2016
VIE PROFESSIONNELLE
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
1
/
5
100%